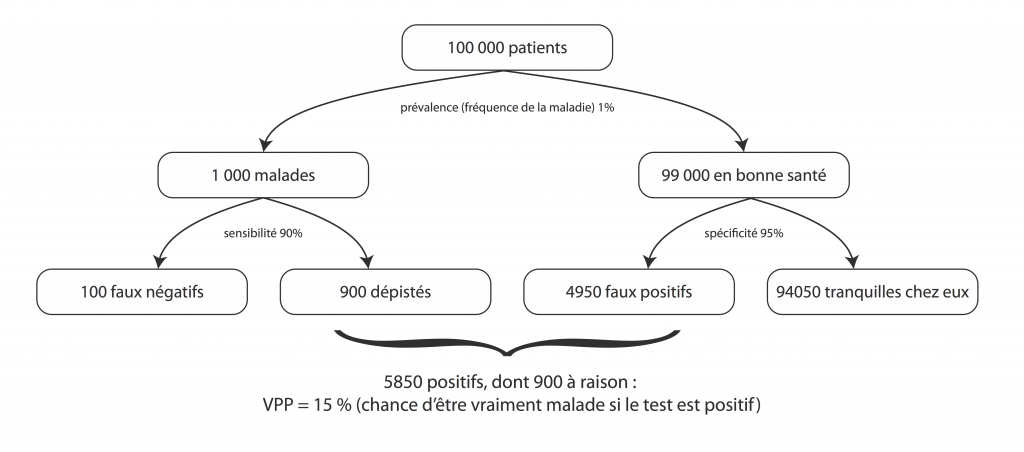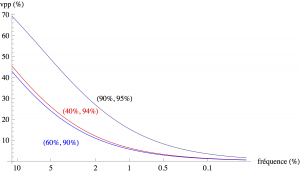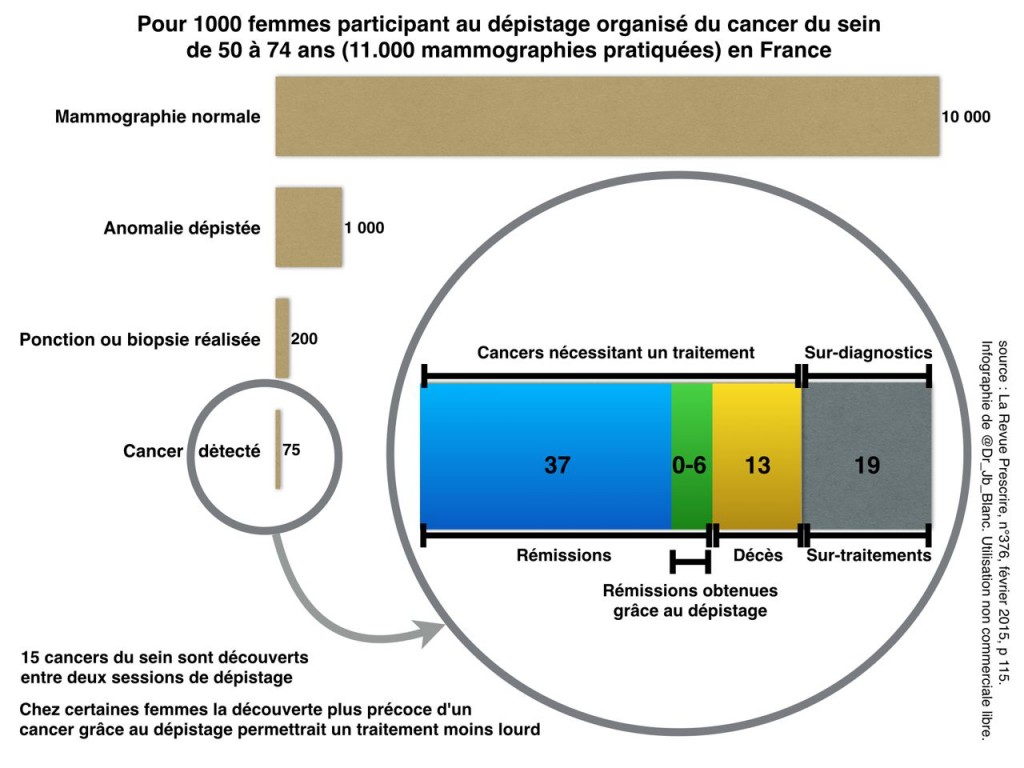Et mes fesses, elles sont roses, mes fesses ?
19 juin, 2016
C’est très compliqué, d’expliquer pourquoi dépister un cancer ne sauve pas forcément de vies, et pourquoi ne pas dépister peut parfois le faire.
D’abord parce que c’est tout à fait contre intuitif.
C’est facile, joli et surtout rassurant de se dire « On passe un examen pour chercher un cancer, pis si on en trouve un on peut le traiter avant qu’il ne soit trop tard. » C’est super séduisant, ça paraît absolument logique. Alors qu’expliquer le contraire, c’est relou, ça demande des maths et des stats et des raisonnements chiants. Et puis on n’a pas très envie d’y croire, même quand on a tout lu avec les sourcils froncés et tout compris. On a vite envie de revenir à la logique intuitive, de dire « Oui ok c’est bien beau tout ça mais c’est rien que des stats, et moi je ne suis pas une stat. »
Ensuite parce que c’est la seule partie visible de l’iceberg.
On connait tous, de près ou de loin, quelqu’un qui a été sauvé par le dépistage d’un cancer.
On a tous un exemple pour dire « Oui bah peut-être mais en attendant, si ma tante avait pas passé de mammographie, on aurait jamais trouvé son cancer et maintenant elle va très bien et elle est très reconnaissante qu’on lui ait sauvé la vie » ou malheureusement pour dire « Oui bah peut-être mais en attendant, ma tante s’est pas fait dépister et elle a eu un cancer et elle est morte. »
Et ça fausse la vision.
Parce que précisément on ne peut voir que ça : on ne peut voir que ce qui se passe, et on ne peut pas voir ce qui ne se passe pas. Du coup, aucun patient ne viendra jamais me dire « Ohlala docteur merci tellement de ne pas m’avoir dépisté quand j’avais 60ans, je ne serais plus là pour vous remercier si vous l’aviez fait », parce qu’on ne peut pas savoir.
Et ça renforce encore cette impression intuitive que le dépistage, ça doit forcément marcher : c’est absolument logique que ça marche ET on a des exemples sous les yeux de gens pour qui tout porte à croire que ça a marché.
Et pourtant, en médecine, on essaie de baser nos attitudes sur des faits, sur des études.
Avant de donner un médicament, on essaie de prouver qu’il est efficace, et qu’il apporte le plus souvent plus de bien que de mal quand on le prescrit. (Bon, on foire souvent, hein. Mais dans l’idée, on est censés essayer de le faire.)
C’est la « balance bénéfice-risque ». On essaie de fonctionner comme ça le plus souvent possible, parce que précisément les « Moi j’ai l’impression que ça marche sur mes patients » et les « Ca semblerait logique que ça marche donc ça devrait marcher », bin c’est pas suffisant.
Et hélas, on a de plus en plus de grosses études, avec des gros effectifs et des longues années de recul qui viennent nous mettre sous le nez les unes après les autres ce résultat dérangeant : la plupart de nos stratégies de dépistages précoces des cancers ne sauvent pas de vie.
Et croyez le bien, ça ne me réjouit pas plus que vous.
Du coup, avec mon ami physicien-qu’est-plus-balaise-que-moi-en-pubmed-et-en-lectures-critiques-d’articles, on va essayer de se fader un billet long et chiant pour essayer d’expliquer un peu tout ça, et où on en est aujourd’hui de ce qui a l’air de sauver des vies ou pas.
Parce que face aux Octobres Roses, aux Novembres Marron et autres campagnes médiatiques qui coûtent un bras (souvent intéressé, le bras…) et s’immiscent chez vous par la télé et les journaux en sortant les violons et en jouant sur votre peur, plus on est nombreux à essayer de faire entendre les voix de la raison opposées, mieux c’est.
(Vous trouverez en bas d’article tout un tas d’autres références d’autres articles sur d’autres blogs qui traitent du même sujet.)
A/ INTRODUCTION
D’abord, on va commencer par schématiser le processus de dépistage, tel qu’il est pratiqué la plupart du temps. L’idée est la suivante :
Vous passez un examen peu invasif (c’est-à-dire peu dangereux, qui ne fait pas trop mal, qui n’a pas trop de risques de complications) et si possible un minimum fiable.
Cet examen ne cherche pas le cancer directement, mais un signe dont on sait qu’il est souvent lié au cancer. (une image moche à la mammographie, une anomalie sur une prise de sang, du sang dans les selles).
Si cet examen revient positif, c’est-à-dire s’il trouve une anomalie, on se dit qu’il y a peut-être un cancer, et on passe à un examen plus performant mais souvent plus invasif (une biopsie, une coloscopie).
Si ce deuxième examen revient lui aussi positif, on pose le diagnostic de cancer et on vous propose un traitement.
Encore une fois, ça paraît beau et logique.
Le souci, c’est qu’aucun des maillons de cette chaîne n’est infaillible, et que les erreurs mises bout à bout peuvent aboutir des trucs pas sympas, qui viennent tout encafouiller notre jolie logique instinctive.
Les failles sont les suivantes :
1/ Les examens préliminaires peuvent se tromper (souvent) et occasionner des complications (rarement).
2/ Les examens de confirmation peuvent se tromper (plus rarement) et occasionner des complications (plus souvent).
3/ Certains cancers peuvent guérir tout seul ou évoluer tellement lentement qu’on mourra d’autre chose avant qu’ils ne se manifestent.
4/ Les traitements proposés pour les cancers peuvent occasionner des complications (très souvent), qui peuvent être graves (souvent) voire mortelles (rarement).
5/ Nos outils pour mesurer l’impact et le bénéfice d’un dépistage sont bourrés de failles eux-aussi.
Dans la première partie, je vais juste poser le raisonnement. Avec des chiffres inventés et faux, juste pour l’illustration. Les vrais chiffres viendront dans la deuxième partie…
1/ Les examens préliminaires peuvent se tromper.
On va entamer gaiement avec un peu de stats. Ça s’appelle le théorème de Bayes, et je vous jure que c’est plus rigolo que ce la formule en donne l’impression :

Oui hein ? Promis.
Bon. Prenons un examen médical. Un examen de dépistage, tiens, au hasard. Qui doit répondre par Oui ou par Non à la question « Y a-t-il un signe de cancer ? ».
Vous le savez, aucun examen n’est fiable à 100%. Il peut toujours y avoir des ratés, même pour les examens très performants. Ce raté peut prendre deux formes :
– vous avez une anomalie et pourtant l’examen ne trouve rien et revient négatif : c’est ce qu’on appelle un « faux négatif »
– vous n’avez rien et pourtant l’examen trouve quelque chose et revient positif : c’est un « faux positif ».
La probabilité qu’a l’examen de bien trouver l’anomalie s’il y en a une s’appelle la sensibilité.
La probabilité qu’a l’examen d’être normal quand il n’y a pas d’anomalie s’appelle la spécificité.
Prenons un test super performant, avec 90% de sensibilité (= si on fait passer le test à 100 personnes malades, il aura raison et trouvera une anomalie pour 90 d’entre elles) et 95% de spécificité (= le test aura raison et sera négatif chez 95% des personnes non malades).
Ces critères de sensibilité et de spécificité répondent à la question : « Si je suis malade, est ce que le test le voit ? », autrement dit « Est-ce que ce test est balaise ou pas ? ».
Mais la vraie question qui nous intéresse, en pratique, en tant que patient et en tant que médecin, c’est pas « Si je suis malade, est ce que le test le voit ? » puisqu’on ne le sait pas, si vous êtes malades, justement. (Si on le savait on serait pas là à vous emmerder à passer des examens. Ce qu’on veut savoir, c’est pas si le test est balaise, c’est si vous êtes malade.)
La vraie question qui nous intéresse va dans l’autre sens, c’est : « Si le test dit que je suis malade, est-ce qu’il a raison ? ». Et ce n’est pas du tout la même question.
La probabilité que vous ayez vraiment une anomalie si le test dit qu’il y en a une, ça s’appelle la valeur prédictive positive. (VPP pour les intimes).
La probabilité que vous n’ayez pas d’anomalie si le test dit que tout va bien, ça s’appelle la valeur prédictive négative (VPN).
Intuitivement, on a tendance à confondre les deux questions et les deux réponses.
Si on dit « Le test a 90% de chances d’être positif si vous êtes malade », on a tendance à croire que « si le test est positif, c’est qu’on a 90% de risque d’être malade », et bin (roulements de tambours) figurez-vous que non dites donc ! Et loin, loin, loin s’en faut.
Parce que la VPN et la VPP ne dépendent pas que de la balaisité du test. Elles dépendent aussi fortement de votre probabilité AU DÉPART d’avoir la maladie, c’est à dire qu’elles dépendent aussi de la fréquence de la maladie et de vos propres facteurs de risques. Plus la maladie est rare, plus la probabilité au départ que vous soyez malade est faible, moins le test sera performant.
Et comme une bonne illustration vaut un bon steak, voyons ça ensemble.
Reprenons notre test super balaise de tout à l’heure. 90% de sensibilité, 95% de spécificité.
Prenons une maladie assez fréquente, qui touche une personne sur 100.
Faisons passer le test à 100 000 personnes.
Voilà. Sur les 5850 personnes inquiétées par un test positif, 4950 sont saines.
Si votre test revient positif, vous n’avez que 15% de risque d’être malade (et donc 85% de risque d’avoir été inquiété à tort).
Pour un test excellent et une maladie pas si rare que ça.
Plus la maladie est rare, plus la VPP devient pourrie. Par exemple, pour une maladie qui touche une personne sur 1000, toujours avec le même test (90% de sensibilité, 95% de spécificité), elle chute à 1,8%.
Et ça, c’est juste pour une fois. Passez le test tous les deux ans pendant 10 ans, votre probabilité d’être un jour inquiété à tort passe grosso modo à 95%.
2/ Les examens de confirmation peuvent se tromper et ou causer des complications
a) Parce que oui, même une biopsie peut se tromper. Rien n’est fiable à 100%, jamais.
Je vous renvoie à cet article de Dominique Dupagne sur le sujet.
Une biopsie, grosso modo et de façon imagée, ça revient à mettre des cellules au microscope, et demander à un gars si elles sont jaunes (saines) ou rouges (cancéreuses). Même si le type au microscope est très fort, il y aura toujours des cellules orange / orange foncé pour lesquelles il sera difficile de trancher: la sensibilité et la spécificité d’une biopsie, même si elles sont très bonnes, ne sont pas à 100%, voilà, bravo, vous avez tout compris.
Juste pour s’amuser, reprenons les 5900 personnes de tout à l’heure, parmi lesquels, souvenez-vous, seulement 900 sont malades. Admettons pour être super larges que la sensibilité et la spécificité sont de 99% pour l’examen au microscope de leurs biopsies (et arrondissons un tout petit peu les calculs de trois fois rien parce que sinon ça devient illisible)
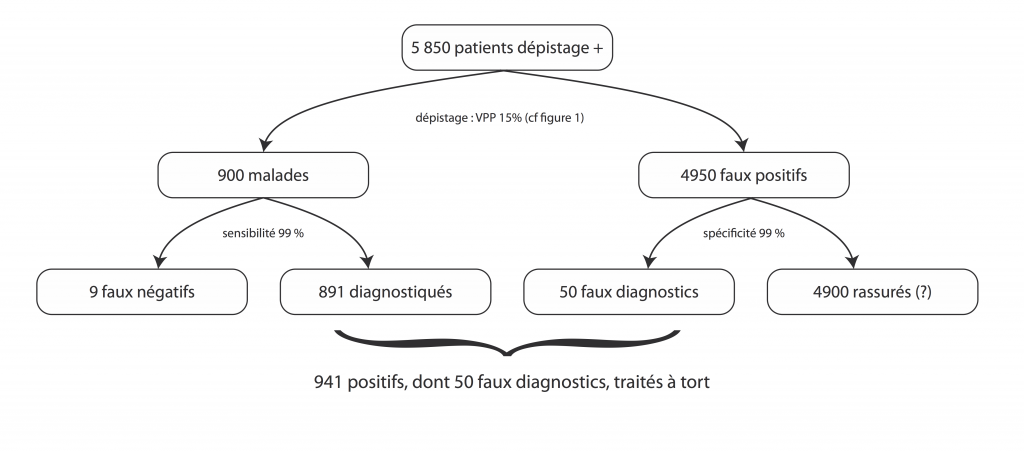 On obtient donc au final : 891 types qu’on va diagnostiquer à raison et à qui on va proposer un traitement, 4900 types qui repartiront chez eux rassurés (pour l’instant, parce qu’on risque parfois de leur reproposer de faire des biopsies régulièrement, pour surveiller, et de remettre le couvert une fois par an), au prix de 9 types qu’on va rassurer à tort alors qu’ils ont un cancer et 50 types à qui on va annoncer un faux diagnostic de cancer, et traiter à tort.
On obtient donc au final : 891 types qu’on va diagnostiquer à raison et à qui on va proposer un traitement, 4900 types qui repartiront chez eux rassurés (pour l’instant, parce qu’on risque parfois de leur reproposer de faire des biopsies régulièrement, pour surveiller, et de remettre le couvert une fois par an), au prix de 9 types qu’on va rassurer à tort alors qu’ils ont un cancer et 50 types à qui on va annoncer un faux diagnostic de cancer, et traiter à tort.
b) Ajoutons à ça que, par exemple, les coloscopies peuvent donner des perforations ou des infections, que l’irradiation de la mammographie augmente possiblement un tout petit peu le risque de cancer (et oui, c’est balot), que les biopsies de prostate peuvent entraîner des hémorragies ou des infections sévères, que l’anesthésie générale qui va avec présente elle-même des risques, y compris de décès…
Imaginons au final que l’examen entraîne une complication deux fois sur cent, et une complication mortelle une fois sur dix mille.
Sur les 5850 personnes de tout à l’heure, ça tourne quand même autour de 117 complications et un gros demi-mort. Alors qu’on n’a même pas encore commencé le traitement.
Au final, pour 100 000 types testés, dont 1000 malades, on aura :
5850 patients inquiétés, 891 diagnostiqués à raison, 109 rassurés à tort qui ont un cancer et qui ne le savent pas (les 100 faux négatifs de la première étape + les 9 de la deuxième), 50 diagnostiqués à tort qui vont avoir un traitement pour rien, et, répartis au hasard parmi les gens malades et les gens pas malades : 117 personnes qui auront une complication quelconque, et un demi-mort qui n’avait rien demandé à personne et qui serait en train de jardiner tranquillement si on lui avait foutu la paix.
Toujours, je le rappelle, pour un test de dépistage inventé pour les besoins de la démonstration et très performant.
3/ Certains cancers peuvent guérir tout seuls ou ne jamais évoluer.
C’est encore un truc difficile à admettre, mais cellule cancéreuse ne veut pas dire cancer.
Il est super fréquent d’avoir quelques cellules cancéreuses qui se baladent par ci par là, notamment pour la prostate chez les hommes âgés et dans le sein chez les femmes, même jeunes.
Plus on est performant pour trouver une petite cellule cancéreuse perdue, plus on la cherche, plus on a de chances de la trouver et moins on a de chances qu’elle ait été partie pour évoluer en vrai cancer méchant. Nous vous donnerons quelques chiffres plus bas, c’est vraiment beaucoup plus fréquent que ce qu’on croit.
Ou alors, les cellules cancéreuses peuvent former un vrai cancer, mais qui va rester sage tellement longtemps que la mort surviendra pour autre chose avant que le cancer ait eu le temps de se manifester. C’est très très très fréquent aussi.
Le souci, c’est que nos examens ne font pas la différence entre tout ça, et n’ont pas la boule de cristal pour savoir quels cancers vont évoluer ou pas.
Quand on pose un diagnostic de cancer dans une situation où le cancer ne serait pas devenu symptomatique, ou aurait régressé tout seul, ou tout simplement par erreur, on appelle ça un surdiagnostic.
Si on part sur un cancer sur deux qui aurait disparu ou n’aurait pas posé de souci, et qu’on reprend nos gus de tout à l’heure en arrondissant, on a 446 types à qui on a diagnostiqué un méchant cancer qui aurait posé problème et à qui on va peut-être rendre service, 9 rassurés à tort, 495 types surdiagnostiqués prochainement surtraités à qui on va faire courir des risques pour rien (50 chez qui on s’est trompé, + 445 chez qui le cancer n’aurait jamais évolué), et un demi-mort qui aimerait bien qu’on lui foute la paix, maintenant.
ALORS QU’ON A MÊME PAS COMMENCÉ LE TRAITEMENT !
4/ Les traitements du cancer, c’est pas marrant-marrant.
Je vais passer rapidement là-dessus, hein. Vous avez tous malheureusement un exemple d’un proche en tête. Les conséquences au niveau médical, mais aussi psychologique et social d’une chimiothérapie par exemple, je vais pas faire vibrer les violons : je pense que vous voyez.
Il y a parfois des morts, aussi, à cause des traitements. C’est pas si souvent, mais ça arrive. La iatrogénie que ça s’appelle.
L’idée, c’est que si on applique ces traitements à de gens qui en ont tous besoin, le jeu peut en valoir la chandelle (et encore, pas tout le temps mais c’est un autre débat).
Si on vous sauve la vie à coup sûr, ça peut valoir 20% de risques d’avoir une incontinence à vie ou un sein en moins. Ça peut même valoir le coup de mourir du traitement, puisque hey, on était parti pour mourir de toute façon.
Si on vous allonge votre espérance de vie de 5 ans contre 10 ans d’incontinence, déjà peut-être un peu moins, question de point de vue.
Mais si on traite 446 personnes qui ont besoin du traitement et 495 qui n’en auraient pas eu besoin, et qu’on a déjà tué un demi-mec en chemin rien que pour le diagnostic, tout de suite, c’est plus du tout la même chose. Surtout si on met dans la balance les morts-du-traitement qui sont dans le groupe des gens-qui-n’auraient-pas-eu-besoin-du-traitement.
5/ Nos outils pour mesurer l’impact bénéfiques d’un dépistage sont bourrés de failles eux-aussi
Pour mesurer l’impact du dépistage, pour savoir si on a bien sauvé des vies, on a plein de problèmes de partout. On a plein d’études biaisées qui disent par exemple que « l’espérance de vie après diagnostic d’un cancer de tel organe augmente », mais qu’il faut savoir décrypter. Voici quelques exemples de biais et d’incertitudes :
– Le type qui n’aurait pas besoin du traitement mais qui l’a eu quand même, lui, forcément, il va vivre longtemps. Vu qu’il était pas malade. (Y a rien qui guérit mieux qu’un cancer qui n’existe pas.)
Il va être compté dans les gens à qui on a sauvé la vie, par ses proches déjà (cf le tout début du texte et votre tante), mais aussi par les statistiques.
– Si on vous trouve un cancer à 55 ans parce qu’on l’a dépisté, et que vous en mourrez à 70, vous avez eu 15 ans d’espérance de vie.
Si on vous trouve un cancer à 65 ans parce que vous avez présenté des symptômes qui ont amené au diagnostic et que vous mourrez à 70ans, vous avez eu 5 ans d’espérance de vie.
C’est le même cancer, vous êtes mort au même âge, vous avez peut-être vécu angoissé et avec les effets indésirables de votre traitement dix ans de plus, mais pour les stats, c’est une vraie victoire : 3 fois plus d’espérance de vie grâce au dépistage !
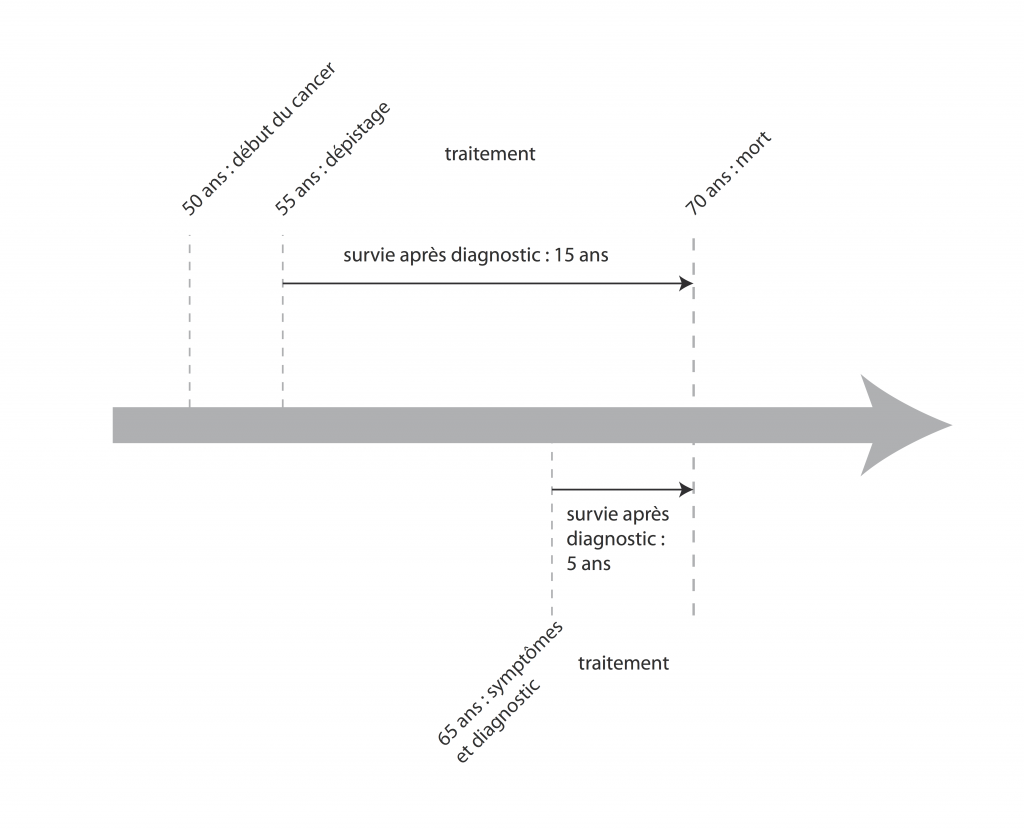 – Des études comparent parfois les options « traitement ou non après un diagnostic de cancer », pour montrer que le traitement sert à quelque chose, mais cette comparaison n’a pas de sens. On ne vit pas de la même façon, ne serait-ce que psychologiquement, après avoir été étiqueté « cancéreux ». Pour réfléchir à l’intérêt du dépistage, il faudrait comparer [(dépistage + traitement) ou (dépistage + rien)] versus (pas de dépistage du tout)
– Des études comparent parfois les options « traitement ou non après un diagnostic de cancer », pour montrer que le traitement sert à quelque chose, mais cette comparaison n’a pas de sens. On ne vit pas de la même façon, ne serait-ce que psychologiquement, après avoir été étiqueté « cancéreux ». Pour réfléchir à l’intérêt du dépistage, il faudrait comparer [(dépistage + traitement) ou (dépistage + rien)] versus (pas de dépistage du tout)
– Des études à trop long terme peuvent attribuer au dépistage une augmentation de l’espérance de vie qui est en fait lié à d’autres choses (amélioration des traitements, par exemple).
– Bref, ce ne sont que des exemples (grossiers et partiels) mais au final : c’est compliqué d’évaluer sans biais l’efficacité d’une stratégie de santé publique. La seule chose qui doit nous intéresser, dans une étude, pour savoir si on sauve des vies ou pas, c’est la mortalité GLOBALE. La seule vraie façon de savoir, c’est de prendre 100 000 personnes à qui on fait passer le dépistage, 100 000 personnes à qui on ne le fait pas, et de regarder le nombre de mort à la fin EN TOUT. Comparer la mortalité spécifique, c’est à dire les morts « par cancer du sein » par exemple n’a pas de sens, parce que les sauvées du cancer du sein peuvent être compensées par celles qui sont mortes d’autres choses mais d’une façon ou d’une autre à cause du dépistage (effet iatrogène des médicaments, complications en chaîne, suicides parfois etc.).
6/ Du coup, au final :
– On aimerait bien pouvoir proposer aux gens d’être de bons médecins et de leur sauver vachement la vie, mais la réalité nous met des bâtons dans les roues.
– Beaucoup de dépistages actuellement proposés n’ont pas fait leur preuve de leur efficacité, et les preuves de leur nocivité ou de leur inefficacité sont de plus en plus probantes, hélas.
– C’est très difficile à croire, à voir et à expliquer.
– J’attire votre attention sur le fait que les examens qu’on va remettre en cause plus bas ne sont pas remis en cause en tant que tels. C’est leur utilisation dans un contexte de dépistage de masse, appliqué à toute la population sans distinction qui est remise en cause. Leur utilisation ponctuelle peut être tout à fait justifiée, en fonction des situations.
On a vu plus haut que le risque d’erreur dépend énormément de la probabilité au départ d’avoir une pathologie. Donc ce n’est pas du tout la même chose de faire une mammographie diagnostique à quelqu’un qui a senti une boule cheloue dans son sein ou une mammographie de dépistage a une femme qui a une mutation génétique augmentant le risque de cancer du sein que de faire des mammographies de dépistage systématique à toutes les femmes de 40ans. (-> le risque de cancer est plus important au départ -> la performance de l’examen devient meilleure)
B/ LES DIFFÉRENTS DÉPISTAGES EN L’ÉTAT ACTUEL DES CHOSES
Tous les dépistages conduisent à faux positifs et négatifs, surdiagnostics, surtraitements et effets indésirables. Un dépistage peut être clairement nuisible, inutile, ou utile, selon sa capacité à détecter les cancers qui justifient un traitement, l’ampleur des effets indésirables des examens et des traitement, et son impact sur la mortalité globale et la qualité de vie.
Lorsqu’un dépistage est statistiquement nocif, un médecin qui le propose systématiquement nuit, en moyenne, à ses patients.
Nous allons examiner les principaux exemples, cancers de la prostate, du sein, colorectal, et du col de l’utérus. L’objectif ici est d’essayer de s’abstraire de la charge émotionnelle liée au cancer pour se concentrer sur les faits.
1/ Le cancer de la prostate :
Le dépistage repose sur une prise de sang : le dosage d’une protéine produite par la prostate, le PSA, dont le taux augmente en cas de cancer, mais aussi avec des maladies bénignes comme les prostatites, et même naturellement avec l’âge à mesure que la prostate grossit.
Le dépistage est confirmé par une biopsie (effets indésirables : hématurie 16 %, prostatite aiguë 1 %, septicémie 0,5-2 %, trouver que se faire enfoncer une aiguille via l’anus à travers la paroi du rectum est pas super cool 99%).
Les biopsies confirment le cancer dans 10-20 % des cas, les autres sont des faux positifs du dosage du PSA.
Parmi ces 10 à 20% de biopsies positives, de nombreux cas sont en fait simplement des cellules cancéreuses isolées qui n’auraient jamais provoqué de cancer : plus de la moitié des hommes de 60 ans ont des cellules cancéreuses dans leur prostate, c’est un phénomène quasi normal et c’est le cas de près de 100% des hommes de 90 ans : des études sur des autopsies chez des hommes décédés pour d’autres causes (Sakr et al. 1994) trouvent des cancers histologiques chez 24 % des hommes, et par tranche d’âge respectivement 2 %, 29 %, 32 %, 55 %, et 64 % chez les hommes de 20-29, 30-39, 40-49, 50-59 et 60-69 ans. Ça veut dire que si on va fouiller la prostate d’une personne de 65ans morte d’autre chose, on a 64% de chance d’y découvrir des cellules cancéreuses.
Évidemment, puisque non, 64% des hommes ne meurent pas de cancer de la prostate, ça veut dire qu’une majorité de ces « cancers » seraient restés silencieux.
Ce réservoir très important d’hommes porteurs de cellules-cancéreuses-qui-ne-deviendront-pas-des-cancers amène à penser que, si on essaie seulement d’ « améliorer » le dépistage en trouvant de plus en plus efficacement des cellules cancéreuses, sans repenser les choses en profondeur, on aboutira seulement à un nombre ahurissant de surdiagnostics.
Les deux études les plus complètes sur l’impact du dépistage et du traitement sont Schroder et al. 2012 et Andriole et al 2012. Elles montrent un impact faible ou nul sur la mortalité spécifique (réduction absolue du risque spécifique de 0.071 % dans l’étude européenne), et nul sur la mortalité globale. Elles montrent un taux de surdiagnostic de l’ordre de 50 %, avec des effets secondaires de la chirurgie importants (incontinence, impuissance…).
Un bilan du surdiagnostic peut être trouvé dans Sandhu et al. 2012 et Loeb et al. 2014, et confirme sa très forte présence.
De tous les dépistages, celui du cancer de la prostate est l’exemple le plus clair de dépistage nocif : l’impact sur la mortalité est faible ou nul, l’impact sur la qualité de vie très négatif. Les taux de faux positif, de surdiagnostic, de surtraitement sont tous élevés. Effectuer un dosage de PSA sur un patient sans facteur de risque particulier est nuisible. Plusieurs pays recommandent officiellement de ne plus faire le dépistage systématique. En France la HAS (haute autorité de santé) ne le conseille plus (enfin !), même si de nombreux médecins continuent de le pratiquer.
2/Le cancer du sein
Le dépistage est effectué en général par mammographies, tous les ans ou tous les deux ans, à partir de 40, 45 ou 50 ans selon les recommandations, diverses en fonction des pays et en train d’évoluer. Certains pays ne recommandent plus le dépistage systématique, comme la Suisse.
En cas d’image très anormale, on propose une biopsie de la lésion pour voir s’il s’agit d’un cancer ou non.
Le dépistage trouve beaucoup de cancers peu avancés, (les carcinomes canalaires in situ (CCIS)), dont l’évolution est très lente, et qui peuvent même eux-aussi régresser spontanément, donc pour lesquels les risques de surdiagnostic et de surtraitement sont a priori élevés.
Les études récentes sont sans appel sur l’impact du dépistage : diminution faible ou nulle à la fois de la mortalité spécifique et de la mortalité globale, taux important de faux positifs (10 %), et effets indésirables importants (cancers radio-induits par le dépistage radiologique lui-même, cancers induits par la radiothérapie, surtraitement conduisant à des mastectomies inutiles, effets secondaires des chimiothérapies…).
Par exemple, l’étude canadienne Miller et al. 2014 a suivi pendant 25 ans 89000 femmes, dont la moitié a effectué des mammographies annuelles ; la mammographie annuelle n’a pas réduit la mortalité spécifique, et a causé 22 % de surdiagnostics.
Plusieurs études (Bleyer et al. 2012, Zahl et al. 2004) évaluent le taux de surdiagnostics à environ 30 %.
Une étude très récente et exhaustive, comparant les pratiques en divers endroits des USA (Harding et al. 2015), sur 16 millions de femmes de 40 ans ou plus, trouve que les programmes de mammographie systématique découvrent principalement de petites tumeurs, et n’ont aucun impact sur la mortalité globale ni même spécifique ; l’étude conclut à la présence massive de surdiagnostic.
Qu’en est-il des études plus anciennes qui trouvaient un bénéfice (modéré cependant) à la mammographie ? Elles n’appliquaient pas toutes une méthodologie rigoureuse d’essai clinique aléatoire, mais surtout elles ont été conduites alors que l’arsenal thérapeutique était moins performant. Les traitements devenant plus efficaces, les bénéfices du dépistage ont diminué, alors que les effets négatifs n’ont pas changé. En outre, les femmes étaient peut-être moins attentives aux premiers signes cliniques qu’actuellement.
Il est intéressant de comparer ces résultats avec les recherches de tumeurs lors d’autopsies de femmes décédées accidentellement, qui montrent la prévalence très élevée de «cancers» chez des femmes, y compris jeunes, sans symptômes.
L’analyse la plus élaborée de ce type est Nielsen et al. 1987, qui a cherché des tumeurs chez 110 femmes de 20 à 54 ans, décédées accidentellement.
20 % des femmes présentaient des tumeurs cancéreuses (avec beaucoup de CCIS). La proportion montait à 40 % dans la tranche d’âge 40-49 ans. Ces tumeurs de petite taille régressent très probablement d’elles-mêmes puisqu’on trouve moins de cancers dans les tranches d’âge supérieures ! Un dépistage radiographique plus sensible et démarrant à 40 ans (ou pire, 30, comme des gens probablement bienveillants mais très mal informés le conseillaient ces jours-ci dans la presse) pourrait donc produire des taux de surdiagnostic énormes (plus de faux positifs, plus de cancers non évolutifs).
Avancer le dépistage à 40 ans augmente les faux positifs et le surtraitement, sans impact sur la mortalité. En outre, un faux positif infirmé par biopsie produit des effets psychologiques durables (Brodersen et al., 2013) : l’annonce de la possibilité d’un cancer a presque les mêmes conséquences psychologiques qu’un cancer confirmé.
En résumé, pour 1000 femmes subissant un dépistage systématique tous les 2 ans à partir de 50 ans, 200 subiront des examens supplémentaires (biopsies), 19 subiront un surtraitement, pour 0 à 6 vies sauvées, probablement compensées par un décès iatrogène chez les femmes surtraitées (c’est la seule explication aux études trouvant une baisse de la mortalité spécifique mais pas de la mortalité globale).
Plus de détails peuvent être trouvés dans un rapport très complet du Swiss Medical Bord (“dépistage systématique par mammographie”, 15 décembre 2013).
Le dépistage systématique par mammographie est donc non seulement inutile mais probablement nuisible, et ce d’autant plus qu’il est pratiqué chez des femmes jeunes.
3/Le cancer colorectal
Un dépistage systématique est proposé tous les deux ans par la recherche de sang dans les selles (hemoccult) pour les patients entre 50 et 74 ans. En cas de résultat positif, une coloscopie est proposée.
Cependant, ce sont surtout des tumeurs avancées qui provoquent des saignements. Et effectivement, le test de recherche de sang est caractérisé par une faible sensibilité (inférieure à 50%) et une très faible valeur prédictive (inférieure à 10%), voir par exemple Bleiberg 2002 qui dénonçait à l’époque pour ces raisons l’usage de ce test. Cela signifie que seule une coloscopie de vérification sur dix confirme la présence d’un cancer, et la moitié des cancers ne sont pas détectés au dépistage.
Une méta-analyse portant sur 245 000 patients (Moayyedi et al. 2006) a observé une petite diminution de la mortalité spécifique due au cancer colorectal après dépistage, mais une augmentation de la mortalité pour d’autres causes, et aucun impact sur la mortalité globale.
Une étude plus récente, un suivi sur 30 ans de 45000 patients (Shaukat et al. 2013, étude Minesotta), observe une diminution marginale de la mortalité spécifique (surtout en cas de test annuel plutôt que tous les deux ans, et principalement chez les hommes de 60 à 69 ans ; l’effet est nul ou marginal chez les femmes), et toujours aucun impact mesurable sur la mortalité totale.
Aucune étude publiée à ce jour n’a montré un impact positif du dépistage systématique sur la mortalité globale.
Il a été suggéré (Lang et al. 1994) qu’une part importante de la réduction observée de mortalité spécifique soit due en fait à une sélection aléatoire pour une coloscopie, qui elle a une forte sensibilité et une forte spécificité. En effet, compte tenu du fort taux de faux positifs, dans les essais cliniques avec test annuel, au moins 40% des patients subissent une coloscopie à un moment.
C’est à dire, pour simplifier, que si on choisissait au hasard 100 personnes dans la rue et qu’on leur faisait passer une coloscopie, on arriverait à un résultat probablement assez proche de celui de l’hemoccult.
L’utilisation systématique de coloscopies de dépistage n’est cependant pas viable à grande échelle, à la fois en termes de coût, et d’effets secondaires (anesthésie générale, risque de perforation ~1‰, d’hémorragie ~1‰…). Trois millions de colos, mine de rien ça fait 30 morts à cause de l’anesthésie générale, 1500 perforations, 1500 hémorragies…
Nb : nous n’avons parlé jusqu’à présent que du test hemoccult, alors qu’un nouveau test (immunologique) est maintenant proposé, qui suit à peu près le même format : recherche de sang dans les selles (un peu différemment) tous les deux ans et coloscopie proposée si positif.
Il n’y a que pour le test hemoccult que des études longues sont disponibles pour le moment. Cependant, les quelques études disponibles sur le nouveau test permettent de le comparer à l’ancien. Il n’est sensible qu’au sang humain : il permet d’éviter les faux positifs dus au steak tartare de la veille. Sa sensibilité est ajustable, et il est de manière standard pratiqué de façon à avoir deux fois plus de positifs que l’hemoccult, donc environ 5% de tests positifs au lieu de 2,5 % (ce taux est donc un choix de la part des promoteurs du test). Cela présente l’inconvénient de faire pratiquer deux fois plus de coloscopies, et donc d’engorger un peu les services concernés, et d’augmenter en proportion les effets indésirables. In fine, on a un peu moins de deux fois plus de diagnostics confirmés de cancer, avec des stades similaires : le test est donc plus sensible (par choix) mais moins spécifique (du fait ce choix de sensibilité). Un petit calcul montre qu’on peut s’attendre à un effet sur la mortalité globale sans doute moins bon qu’avec l’hemoccult, puisqu’on a plus augmenté les effets indésirables (y compris la mortalité pour autres causes) qu’on a diminué la mortalité spécifique…
Le dépistage du cancer colorectal semble donc au mieux inutile, et potentiellement nuisible compte tenu du fort taux de coloscopies induit.
4/Le cancer du col de l’utérus
Il est d’évolution en général assez lente. Il est causé par une infection virale préalable (virus HPV), et il est dépisté par le « frottis » qui consiste en un prélèvement de cellules (grosso modo on vous met un coton tige au fond du vagin pour récupérer quelques cellules sur votre col de l’utérus) et analyse cytologique, tous les 2 à 3 ans en France (3 à 5 ans dans d’autres pays) à partir de 25 ans, chez les femmes qui ont déjà eu des rapports sexuels.
(Oui oui, c’est tous les deux à trois ans. Je sais bien que plein de médecins vous disent de le faire tous les ans, mais c’est pas les recommandations. Tous les 2/3 ans c’est suffisant et même mieux, on risque moins de vous emmerder pour rien. Refusez de le faire tous les ans.)
(Et oui oui, c’est bien à partir de 25 ans. Vous laissez pas emmerder non plus si vous en avez 18.)
Il est à noter que le dépistage est beaucoup plus direct que dans tous les cas précédents, en raison de l’accessibilité du lieu de la tumeur qui permet aisément un prélèvement de surface. Un dépistage positif donne lieu à une colposcopie et à l’analyse histologique d’une biopsie.
La question du surdiagnostic et du surtraitement a été posée (par exemple Raffle et al. 2003), mais la plupart des études publiées montrent qu’un dépistage tous les 3 à 5 ans suivi d’un traitement permet environ 10 fois moins de cancers invasifs. Les effets secondaires sont réels (biopsies inutiles, impact psychologique des faux positifs), mais le dépistage a globalement un bilan positif.
On peut objecter qu’il n’existe pas d’étude de type essais cliniques randomisés, les plus fiables, comme pour les autres dépistages. Cependant, les écarts de mortalité spécifique trouvées par les études de type « case-control », plus simples mais moins fiables, sont beaucoup plus importants. En outre, les comparaisons entre les pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède) dans lesquels la mise en place du dépistage a été différente, mais les autres effets — hygiène, traitements — sont similaires permet de relier de manière fiable la diminution observée de mortalité et la mise en place du dépistage (Läära et al. 1987, Sigurdsson 1999).
Des dépistages trop fréquents (plus que tous les 3-5 ans) ou commençant trop jeunes (avant 25 ans) n’apportent rien, sinon plus de faux positifs (fréquents chez les femmes jeunes) (par ex. Adab et al 2004 et Kulasingam et al. 2011).
Au final, à l’heure actuelle, on est à peu près sûr que le dépistage systématique par frottis sauve des vies.
Références : on en parle ailleurs…
D’autres médecins ont écrit sur le sujet. Ils sont nombreux, et je ne pourrai pas les citer tous, mais par exemple :
— @Dr_JB_Blanc, à qui j’ai piqué l’image plus haut, avec en particulier un billet sur la prise de décision du dépistage et la déconstruction du discours des campagnes de dépistage.
— @ docdu16 , qui a publié de très nombreux billets sur le cancer du sein, un billet récent sur le dépistage, et ce depuis 2011 (et aussi là) et 2012.
– Dominique Dupagne, bien sûr, qui râle contre les PSA depuis au moins 2008, et qui a publié de nombreux articles sur la question des dépistages, genre ici, ici où il parle du chouette livre de Rachel Campergue, et beaucoup d’autres, utilisez le moteur de recherche…
– Sur Voix médicales, d’autres articles sur le cancer du sein : ici ou là ou ailleurs.
Plein de données bibliographiques et d’explications autour du dépistage du cancer du sein : http://cancer-rose.fr/
Pour ceux qui veulent creuser un peu l’histoire merveilleuse des probabilités conditionnelles : par ici.
Dans la bouche d’un patient : par là.
Si vous préférez le papier, vous pouvez lire ça ou relire ça.
(Oui les liens amazon c’est caca. Allez chez votre libraire plutôt.)
Références : articles
Prostate
Andriole et al. (2012). “Prostate cancer screening in the randomized prostate, lung, colorectal, and ovarian cancer screening trial: Mortality results after 13 years of follow-up”, Journal of the National Cancer Institute 104, 125-132.
Delpierre et al. 2013, “Life expectancy estimates as a key factor in over-treatment: The case of prostate cancer”, Cancer Epidemiology 37, 462–468.
Gulati et al. 2014, “Individualized Estimates of Overdiagnosis in Screen-Detected Prostate Cancer”, JNCI J Natl Cancer Inst 106, djt367.
Loeb et al. 2014, “Overdiagnosis and Overtreatment of Prostate Cancer”, European Urology 65, 1046–1055.
Sakr et al. 1994, “High grade prostatic intraepithelial neoplasia (HGPIN) and prostatic adenocarcinoma between the ages of 20-69: an autopsy study of 249 cases”, In Vivo 8, 439–43.
Sandhu et al. 2012, “Overdiagnosis of Prostate Cancer”, Natl Cancer Inst Monogr 45, 146–151
Schroder et al. 2012, “Prostate-cancer mortality at 11 years of follow-up”, N Engl J Med 366, 981-90.
Sein
Bleyer et al. 2012, “Effect of Three Decades of Screening Mammography on Breast-Cancer Incidence”, N Engl J Med 2012;367:1998-2005.
Brodersen et al 2013, “Long-term psychosocial consequences of false-positive dépistage mammography”, Ann Fam Med 11, 106-15.
Harding et al. 2015, “Breast Cancer Screening, Incidence, and Mortality Across US Counties”, JAMA Intern Med. 175, 1483-1489
Miller et al. 2014, “Twenty five year follow-up for breast cancer incidence and mortality of the Canadian National Breast Screening Study: randomised screening trial”, BMJ 348, g366
Nielsen et al. 187, “Breast cancer and atypia amoung yong and middle-aged women: A study of 110 medicolegal autopsies”, Br. J. Cancer 56, 814-816.
Welch et al. 1997, “Using Autopsy Series To Estimate the Disease ‘Reservoir’ for Ductal Carcinoma in Situ of the Breast: How Much More Breast Cancer Can We Find?”, AIM 127, 1023.
Zahl et al. 2004, “Incidence of breast cancer in Norway and Sweden during introduction of nationwide screening: prospective cohort study”, BMJ 328, 921.
Colon
Moayyedi et al. 2006, “Does fecal occult blood testing really reduce mortality? A reanalysis of systematic review data”, Am J Gastroenterol 101, 380-4.
Shaukat et al 2013, “Long-Term Mortality after Screening for Colorectal Cancer”, N Engl J Med 369, 1106-14.
Bleiberg 2002, “Hemoccult should no longer be used for the screening of colorectal cancer”, Ann Oncol 13, 44-46.
Lang et al 1994, “Fecal occult blood screening for colorectal cancer. Is mortality reduced by chance selection for screening colonoscopy”, JAMA 271, 1011–1013
Col de l’utérus
Raffle et al. 2003, “Outcomes Of Screening To Prevent Cancer: Analysis Of Cumulative Incidence Of Cervical Abnormality And Modelling Of Cases And Deaths Prevented”, BMJ 326, 901-904.
Adab et al. 2004, “Effectiveness and Efficiency of Opportunistic Cervical Cancer Screening: Comparison with Organized Screening”, Medical Care 42, 600-609.
Kulasingam et al. 2011, “Screening for Cervical Cancer: A Decision Analysis for the US Preventive Services Task Force”, AHRQ No. 11-05157-EF-1. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality.
Sigurdsson et al. 1999, “The Icelandic and Nordic cervical screening programs: Trends in incidence and mortality rates through 1995”, Acta Obstet Gynecol Scand 78, 478–485.
Läära et al 1987, “Trends in mortality from cervical cancer in the nordic countries: association with organised screening programmes”, The Lancet 1987:1, 1247.
Ouais, parce que pardon, je m’apprête à parler de l’importance des mots… (roulements de tambour) et des maux ! (hilarité du public, extase contenue, standing ovation).
Je vous ai saoulés longtemps avec mes « N’oublie pas » .
Je me suis aussi beaucoup auto-saoulée avec, si ça peut vous consoler. N’oublie pas. N’oublie pas. N’oublie pas.
Ce que ça fait de ne pas savoir, ce que ça fait quand on prend pour acquis que tu sais, ce que ça fait quand on ne te demande pas si tu sais, quand on ne laisse aucune porte ouverte pour que tu puisses le dire, que tu ne sais pas.
Je me suis super souvent félicitée quand j’oubliais pas. Quand je faisais de beaux dessins sur la hernie discale (« Oui bon je fais les vertèbres carrées mais c’est parce que je sais pas dessiner, hein, en vrai c’est pas carré » ) en expliquant bien le disque qui fait comme le steak du cheeseburger quand on appuie trop dessus, quand je faisais de beaux dessins d’utérus (« Oui bon on dirait une ampoule mais le pas de vis, là, c’est le col voyez, et le filament c’est le stérilet » ), quand je dessinais bien la cystite (« Oui bon c’est pas dans le vrai angle et le colon ressemble pas du tout à ça mais c’est pour vous donner une idée » ) et le trajet des vilains microbes et le pourquoi de faire pipi après l’amour.
Bon médecin, ça, bon !
Je me suis jamais pas-félicitée de toutes les fois où je ne l’ai pas fait. ([ANECDOTE !!] Ma mère. Une petite patiente qui parle à ses poupées. « C’est bien ! Je te félicite ! (…) C’est pas bien ! Je te fais pas licite ! » [/ANECDOTE])
Toutes les fois où j’ai glissé vite fait « Oui bon c’est sans doute un peu d’arthrose » parce que le mec venait pour autre chose ou pour six trucs et que c’était le septième, ou parce qu’il venait pour ça mais que je lui avais trouvé un trouble du rythme à l’auscultation qui m’inquiétait diablement plus et que je me gargarisais d’avoir trouvé, parce que moi je savais que l’arthrose-c’est-pas-grave-mais-c’est-chiant-mais-de-toute-façon-même-si-ça-fait-très-mal-hey-mec-y-a-rien-à-faire-alors-bon-hey-hein, et que du coup je l’avais reléguée au second plan, son arthrose, alors que merde, lui venait pour ça, pour savoir, et s’en foutait pas mal que j’aie réussi à lui dégoter un rendez-vous chez le cardiologue dans l’après-midi pour un truc qui lui faisait même pas mal et pour lequel il était pas venu.
Toutes les fois où j’ai dit « C’est une gastro » d’un ton docte et rassurant, sans m’assurer de savoir que le mec savait ce qu’est une gastro.
Un jour, un type est venu me voir, il a dit « Je vomis et j’ai la diarrhée » , je l’ai interrogéxaminé, j’ai dit « Mmmm c’est une gastro » , il a dit « C’est quoi une gastro ? » et je suis restée comme une conne à deux ronds de flan devant un chaudron à dire « Heuuu bin c’est quand on vomit et qu’on a la diarrhée » .
J’avais oublié.
Et les fois d’après, devinez quoi ??
Bin j’ai re-oublié et j’ai refait pareil, et j’ai redit « Bon c’est pas bien grave c’est une gastro » , sans m’assurer que le type en face savait, parce que bon, une gastro, qui ne sait pas ?
Une des pires hontes de ma vie médicale, c’était une première consultation de grossesse.
Et pardon d’avance parce que je vais être longue (mais ce post semble bien parti pour être beaucoup trop long de toute façon)(alors bon), mais je dois poser le contexte.
Une première consultation de première grossesse, c’est le truc le plus chronophage qu’il soit sur terre.
Il faut expliquer la grossesse, le risque de fausse couche même si c’est violent de dire ça d’emblée alors il faut l’enrober grave, le suivi normal, les trois échographies, à quoi elles servent, les analyses mensuelles, ce que ça veut dire « semaines d’aménorrhée », ce qu’on peut manger, ce qu’on peut fumer, ce qu’on peut boire, ce qu’on peut prendre comme médicaments, filer le lien du CRAT, mais que quand même il faut vivre normalement et qu’on peut faire du sport et marcher et courir et baiser, les motifs de consultations que d’habitude on consulte pas mais là il faut consulter, le qu’il faut pas trop tarder non plus quand même à s’inscrire à la crèche et à l’hôpital, la première échographie à prescrire, appeler le centre de radio parce que la patiente est à 11 SA et qu’il faut faire vite, qu’il faut revenir pour la déclaration de grossesse et aaaaaaaaaaaaaah.
La plupart du temps, je me débrouille pour le faire en deux consultations, parce que en une, c’est juste impossible. D’autant que la meuf écoute rien du tout, qu’elle a les yeux tout enluminés du souvenir de ses deux barres bleues, qu’elle a plein de questions à poser auxquelles tu t’attendais pas, un peu mal au dos et un peu mal au ventre et qu’il faut gérer tout ça.
Bref : c’est compliqué et long et super génial mais super compliqué et long. (Et le gynéco du coin fait la même chose en 5 minutes en expliquant que dalle pour 85€ s’il vous plaît madame, et tu repasses derrière et il faut tout reprendre et toi tu dois gérer les nausées qu’elle avait pas encore et la tendinite pour laquelle elle vient surtout mais aussi un peu des questions et tout refaire pour 23€ mais je m’égare)(Et y a plein de gynécos qui font tout très bien pour moins cher, mais pas par chez moi. Pardon.)
Bref : c’est long et compliqué.
Depuis quelques années, EN PLUS, des mecs qui ont jamais fait une consultation en vrai de leur vie ont décidé que le dépistage de la trisomie 21, c’était plus cool au premier trimestre qu’au deuxième. Comme la dame vient à 9 ou 10 ou 11 semaines, et qu’il faut faire le dépistage vers 12, te voilà à devoir expliquer dès la première consultation à une fille pleine d’étoiles que HEY ! MAIS LA TRISOMIE 21 VOUS Y AVEZ PENSÉ À LA TRISOMIE 21 ??!
Et c’est ultra compliqué à expliquer, le dépistage de la trisomie 21. Faut y mettre des risques, des in/certitudes, des fractions, des explications d’examen, des probabilités, comparer des fractions (et tu sais bien que pour certaines personnes, dire qu’un risque de 1/250 c’est plus grand qu’un risque de 1/1000, c’est incompréhensible), réfléchir à des positions éthiques, les interroger en souplesse, voir ce que veulent faire les gens de leur hypothétique risque de dans deux semaines de 1/189 alors qu’ils ont des étoiles de partout et qu’ils t’écoutent évidemment fucking pas.
Donc, j’étais dans une consultation comme ça, pour la pire honte médicale de ma vie.
Avec une femme que je pouvais pas trop faire revenir pour une deuxième consultation, parce qu’elle avait pas les sous pour, et parce qu’il était déjà un peu tard dans la grossesse.
Et qui parlait pas très bien français.
Et à qui j’ai dit, je sais pas pourquoi : « Vous voyez ce que c’est la trisomie 21 ? »
Et qui a dit non. Cette conne.
Sérieusement, arrêtez-vous de lire 5 minutes, et essayez d’expliquer à voix haute ce que c’est que la trisomie 21 à quelqu’un qui n’en a aucune idée. Et qui parle pas très bien français. Essayez vraiment. Reprenez la lecture après, que je me sente moins seule.
La plupart des gens, ils voient. Ils voient environ la dysmorphie, le visage un peu particulier, le retard mental plus ou moins important. Ils ont au moins une petite idée. Tu peux affiner, répondre aux questions, tout ça, mais souvent, ils savent déjà ce qu’ils veulent ou pas, s’ils assument ou pas. Ils y ont même déjà souvent réfléchi en amont. Tu n’as plus qu’à respecter leur avis, et expliquer des trucs compliqués sur les examens.
Quand quelqu’un n’a AUCUNE IDÉE, putain, bah c’est bien pire que la gastro-bin-tu-vomis-et-t’as-la-diarrhée.
J’ai bafouillé.
J’ai dit n’importe quoi, avec beaucoup trop de « Heuuu » . À un moment, j’ai (pardon, dieux des cieux, pardon), j’ai bridé mes yeux avec les doigts.
J’ai tapé « Le 8ème jour » dans google image. Regards interrogatifs en réponse.
J’ai essayé d’expliquer. Je me suis rendu compte que j’expliquais avec mes frousses à moi, mes préjugés à moi, mes tendresses à moi, mes décisions à moi. Je me suis demandé si peut-être je noircissais pas un peu le tableau, et de quel droit. Du coup, j’ai marqué une pause de quatre secondes, j’ai ajouté « Heu, mais souvent c’est des gens heu très heu heureux et souriants » . Je me suis entendue dire ça et j’ai eu envie que quelqu’un vienne m’enterrer six pieds sous terre très vite.
Après coup, je me suis dit que j’avais pas assez bien adapté. Que quand les gens peuvent pas comprendre, bin c’est contre-productif d’essayer de les embrouiller de toutes forces et de pas y arriver. Que peut-être des fois il vaut mieux élaguer, simplifier, décider un peu à leur place, s’il est à ce point impossible qu’ils puissent décider clairement.
Après après coup, je me suis demandé de quel droit décider à la place des gens.
Après après après coup, je me suis dit « Mais que faire ? » On est à 11 SA, j’ai pas le temps matériel d’organiser une rencontre avec un interprète dans les délais impartis.
Après après après après coup, je me suis dit « Mais si, t’as le temps, connasse, prends-le, t’as juste la flemme ! »
Après après après après après coup, j’ai repensé au gynéco à 85€ les 5 minutes d’impression d’ordonnances imposées sans explications et je me suis dit que pourquoi c’était à moi de porter toute la misère du monde et que je m’emmerdais trop et que zut à la fin.
Après après après… Enfin bref.
Bref, toutes ces fois où tu dis un mot de ton langage courant qui n’est pas forcément celui des gens.
Toutes ces fois où tu oublies que l’arthrose, c’est un mot banal pour toi, que tu sais ce que ça veut dire et ce que ça implique, et que eux, pas forcément. Où ton arthrose c’est peut-être la bielle de ton garagiste, à qui t’as dit ahah bien sûr la bielle, en faisant plein de jeux de mots poucraves dans ta tête * pour faire style genre et garder contenance à l’intérieur de toi, et de chez qui t’es sortie en te sentant quand même la dernière des connes.
Alors que tu t’étais juré de ne pas oublier.
Toutes ces fois où ok, t’as bien dessiné la hernie discale et le RGO, mais tu dessines jamais l’arthrose ou le ligament croisé ou l’otite séreuse.
Ensuite, on va aborder rapidement (Mmmm… pardon d’avance sur la publicité que je pressens mensongère du « rapidement » ) le registre des mots connotés.
De l’obésité « morbide » .
Des pertes vaginales « sales » .
De la « tumeur » qu’est rien qu’un banal kyste et qui dans ton vocabulaire à toi s’appelle « tumeur » sans que ce soit effrayant dans ta tête.
De tous ces mots dont je perçois la violence et que j’essaie d’expliquer et d’enrober quand ils ont été écrits ou dits par d’autres, et de ne pas dire quand c’est moi qui ai envie de les dire.
J’ai eu la patiente la plus courageuse du monde (vous pensez tous que c’est vous qui l’avez eue, mais détrompez-vous, c’est moi…) qui a bravé son cancer de la gorge mieux que Samson les philistins.
Qui a tout encaissé sans broncher : les rechutes, les huitièmes lignes de chimio, les sondes naso-gastriques, les métastases encore et encore et n’en jetez plus, et que j’ai vue s’effondrer une seule fois, une seule, du diagnostic à sa mort.
Elle était venue les larmes aux yeux (fait inédit) avec son compte rendu de cancéro dans la main. Elle me l’avait tendu, et à voir sa tête, j’imaginais déjà la fin de son monde. J’ai parcouru la lettre, qui était plutôt (pour une fois) pleine de bonnes nouvelles. Des trucs qui régressaient, des scanners qui s’amélioraient, des traitements qui marchaient enfin un peu.
J’ai fini, à force de points d’interrogation, par comprendre ce qui la bouleversait à ce point.
« Tolérance médiocre de la chimiothérapie » .
Dans mon cerveau à moi, c’était plutôt gentil. Alors que d’habitude (et re pardon et re tous sont pas comme ça mais dans mon coin si) (change de coin, me direz-vous) les oncologues ont une furieuse tendance à écrire dans leurs lettres « Elle pète la forme » quand tu vois ta patiente tellement amoindrie amaigrie assourie ((assouri, c’est quand tu as arrêté de sourire)), moi j’entendais plutôt ça comme, pour une fois, « La pauvre, elle a vraiment morflé, elle a été courageuse » .
Elle, et je ne l’ai compris qu’au bout de beaucoup trop longtemps, elle avait entendu « médiocre » .
Comme dans les bulletins du collège en 6ème.
Comme dans « Bon, elle a fait sa chochotte, à pas tolérer sa chimiothérapie… »
J’ai re-compris le pouvoir des mots alors que je pensais l’avoir cerné et ne l’avoir pas oublié.
J’avais re re re oublié.
Et maintenant, je me méfie de médiocre comme je me méfiais de tumeur et de morbide et de sale.
Mais combien de pathologies ai-je annoncées d’un mot rapide comme si les gens savaient à coup sûr, et de combien de mots violents n’ai-je pas saisi la portée ?
Sans doute plein, que j’oublie à mesure de mon SAVOIR grandissant, mais que la fille en moi en P2 aurait entendus en se grattant les couettes, certes, mais au moins en sachant le plus important : qu’ils n’étaient pas évidents.
Sur twitter, on a échangé récemment des anecdotes rigolotes à base de gens qui avaient pris une douche avec du Normacol, parce que sur la boîte c’était marqué « lavement ».
J’ai rigolé comme tout le monde.
Mais en fait, hey, mec, mais BIEN SÛR !
Nous ça nous fait rigoler, du haut de notre petit podium de savoir, parce que, moi la première, ça nous paraît si évident ; mais comment putain de dieu tu veux qu’un type qui n’y connaît rien comprenne qu’il faut pas se laver avec un lavement ? Bielle toi-même.
Comme les ovules qu’il faut mettre dans le vagin et que des fois tu dois le mimer à une patiente étrangère (encore une fois, prenez 5 minutes pour essayer de le faire vraiment chez vous)(ce tour n’a pas été réalisé par des professionnels et ne comporte aucun danger), comme les inhalations que bien sûr il faut respirer mais que c’est un mot authentiquement compliqué, comme la pilule qu’il faut expliquer 40 minutes la première fois parce que en vrai y a aucune fucking raison que la fille connaisse le coup des 7 jours de pause (ou pas !) et de ça se prend par la bouche, comme tellement, tellement, tellement de choses qu’on oublie et que j’ai oubliées alors que je m’étais promis de ne jamais.
TRANSITION : (elle était censée être ciselée de ouf, ma transition, sur le pouvoir des mots tout ça, mais j’ai tellement encore à dire que je vais vous la raccourcir) : Transition : hey, les gens, le pouvoir des mots !!
On a passé un bout de la soirée avec mon futur-presque-meilleur-nouvel-ami à réfléchir sur la question de comment poser à nos patients la question des violences. On était bien d’accord (en bon twittos élevés au grain) qu’il faut poser la question à tout le monde, systématiquement. On s’est échangé nos trucs de comment. Comment le placer discrétos entre la poire et le fromage, « Des opérations des hospitalisations des maladies chroniques des violences des allergies et vos vaccins ? »
On avait chacun nos trucs à nous, qui marchaient bien et qui nous convenaient bien.
Pas le même placement, mais la même question : « Avez-vous déjà été victime de violences ? » .
Avez-vous, déjà, été, VICTIME, de violences ?
Je passerai relativement rapidement sur la problématique du mot « violences », qui peut vouloir dire violence sexuelle, violence physique, violence morale, et j’en passe. La question est vaste et n’est pas là ce soir.
Ce soir, on s’est attardés sur « victime » .
On s’est raconté des anecdotes, toutes pareilles.
« Non, jamais ! (mais (huit consultations plus tard) mon oncle a tué mon frère et c’est moi qui ai trouvé son corps) » –> c’est pas moi la VICTIME.
« Non, jamais ! (mais (deux ans après) mon père frappait ma mère et c’est moi qui m’interposais à 12 ans) » –> c’est pas moi la VICTIME.
On s’est dit qu’on passait probablement à côté de plein de choses, en formulant comme ça, à cause d’un bête mot.
Que sans doute plus l’histoire était violente, plus les gens n’osaient pas piquer la place de la « vraie » victime, et répondaient non. Parce que eux, c’est pas si grave.
Après on s’est dit aussi que hey, si une personne sur dix a été victime de violences, c’est sans doute que grosso modo environ une personne sur dix a été auteur (autrice ?) de violences. (oui ok, stats foireuses, une même personne peut en violenter plusieurs autres mais bon, vous voyez l’idée…)
Qu’à ces personnes-là, aux auteurs, ça valait bien peut-être le coup de leur ouvrir une porte aussi. Qu’on peut en parler chez moi. Que je suis là pour écouter n’importe quelle histoire. Que je peux tout entendre, mais que vous me dites ce que vous voulez. Que pour eux, c’était vachement fermer une porte de parler uniquement de victimes alors qu’ils étaient coupables.
On a cherché plein de formules, on a bidouillé autour, on a fini par se mettre d’accord sur un compromis transitoire faute de mieux : « Avez-vous déjà vécu d’une façon ou d’une autre des violences ? ».
Le « vécu d’une façon ou d’une autre » est pas bien joli, mais a le mérite d’ouvrir à la fois sur les différentes formes de violence, et sur les positions possibles de victime de témoin ou d’auteur ou les trois.
Ça roule pas très bien en bouche. C’est un peu dur à dire, je trouve, un peu pas langage parlé facile.
Si vous avez une autre idée, on est preneurs.
* la bielle Hélène ahahaha. La bielle et la bête ihih. La bielle de Cadix a l’essieu de velours JE SUIS LA REINE DU CALEMBOUR.
Injonctions paradoxales. Mes fesses.
2 octobre, 2015
Un jour prochain, je planifie de vous raconter comment Twitter m’a sauvé la vie.
En attendant ce jour, je m’ennuie quelques fois, je vais vous raconter comment Twitter m’a cueillie un matin à l’aube, et m’a donné envie de tout plaquer, de tout foutre en l’air, et d’aller dresser des ours quelque part en Auvergne.
J’ouvre les yeux. Il est 10h55 du matin. Je tombe là-dessus.
« Arrêt de travail : des médecins piégés par les caméras cachées de France TV »
Morceaux choisis :
« Après trois minutes dont 15 de consultation, un arrêt de travail de sept jours est délivré à la journaliste »
((« Après trois minutes dont quinze de consultation » … Je sais pas vous, mais moi je sais pas ce que ça veut dire. Je retourne le truc dans tous les sens, hein, mais 3 minutes dont 15 de consultation, non, vraiment, je vois pas.))
Blablabla. « Elle se dit épuisée, le médecin la croit sur parole » .
MAIS PARDON ! Croire ses patients sur paroles ? Scandale.
Je m’excuse. Je plaide coupable. Je crois mes patients.
Je vous avais raconté il y a longtemps que c’était difficile pour moi, ces histoires d’arrêts. De juger la souffrance, sans essayer de comparer à la mienne, sans me dire que hey, bon, ça va.
D’écouter avec bienveillance et compassion une meuf qui m’explique que 8h par jour avec seulement 1h de pause déjeuner, c’est insoutenable, alors que je l’écoute à ma 11ème heure de boulot de suite sans avoir mangé ni bu ni fait pipi.
C’était difficile pour moi au début, j’étais un peu rigide. J’arrêtais deux jours pour une rhino s’il fallait vraiment, parce que hey, bon, une rhino, ça va, quoi. Je tapais du poing sur la table si on me demandait trois jours au lieu de deux.
Et puis au fur et à mesure du temps, j’ai rencontré des gens.
J’ai pris un bain de foule. J’ai cogné mes étroitesses d’esprit contre les largeurs de la réalité de la vie quotidienne de mes patients. J’ai vu que des fois, les deux jours pour une rhino, c’était pas vraiment pour une rhino, c’était aussi pour les dix ans sans arrêts et les quatre enfants à la maison et le mari absent et les humiliations quotidiennes et la sous-chef rigide et les fins de mois inbouclables et la mère malade et le fils aîné en prison.
Je tire sur la corde, là, mais c’est pour vous dire que petit à petit, j’ai mis mes principes de côté et j’ai commencé à vraiment écouter les gens.
Et si quelqu’un me dit que c’est insupportable d’aller travailler, pardon, mais je le crois.
Parce que quand un mec me dit j’ai eu la gastro et j’ai vomi et j’ai la diarrhée, figurez-vous que quand je lui palpe le ventre, c’est principalement pour vérifier que c’est pas une appendicite un peu bâtarde.
Parce que non, j’ai pas des scanners supermanesques au bout des doigts pour voir si le type a vraiment une gastro ou pas, et je lui demande pas de passer la fin de l’après-midi dans mes toilettes pour aller vérifier de visu qu’il a bien fait caca liquide.
Quand un mec me dit « J’ai vomi et j’ai eu la diarrhée », pardon, je le crois sur parole.
Quand un mec me dit « Je supporte plus d’aller au travail, je dors plus, j’ai des boules dans le ventre sur la route le matin », bah c’est pareil.
Il y a 5 ans, je voyais des menteurs partout, je me méfiais, je redoutais qu’on me prenne pour une poire.
Et puis j’ai réalisé que de toute façon, j’avais aucun scanner magique pour vérifier.
Depuis, j’ai pris un parti pris qui à la fois me simplifie la vie et à la fois est inévitable : je crois mes patients.
C’est MON PUTAIN DE JOB, de croire mes patients.
Des fois, souvent, je suis la seule personne sur terre pour les croire, pour être à côté d’eux et pas contre eux, pour les regarder avec bienveillance et pas avec méfiance, pour les prendre pour des adultes et pas pour des gamins qui cherchent à sécher l’école. La seule personne sur terre.
Dans un monde de plus en plus policier, où des mecs avec un bandeau « Contrôle Qualité Travail » sur le bras accompagnent certaines de mes patientes aux chiottes, pour vérifier qu’elles n’y passent pas plus de temps que le temps nécessaire à un pipi réglementaire. Je vous jure, hein, j’invente pas. J’ai eu deux patientes de deux entreprises différentes accompagnées aux chiottes à chaque fois, et surveillées par un mec qui pointait leur temps de miction.
Hey bin dans ce tsunami-là, des fois, je suis la seule personne sur terre à croire en leur bonne volonté.
Alors oui, je m’en cogne. Si deux ou trois fois sur cinquante on me mène en bateau, on me raconte des salades et des souffrances qui n’en sont pas, on essaie de me gratter un arrêt pas justifié, tant pis.
Il y a sept ans, j’étais terrifiée à l’idée de donner un arrêt injustifié à un mec pas vraiment malade.
Aujourd’hui, je suis terrifiée à l’idée d’en refuser un à quelqu’un qui souffre.
So sue me.
Tant pis. Tant pis, merde, si des fois je me fais prendre pour une poire. J’assume.
C’est mon rôle, de faire confiance à mes patients et de les croire et de les soutenir. Et s’il faut quelqu’un pour aller dénicher le un sur cinquante qui a menti, ce ne sera pas moi.
Et je ne vous raconte pas tous ceux qui refusent mes arrêts, inlassablement, parce qu’ils ne peuvent pas, parce qu’ils ne veulent pas, parce que ça ne se fait pas. Tous ceux qui sont au bord de la falaise et que j’essaie d’éloigner, et qui me disent non, ça va.
Dans ma pratique, on me refuse beaucoup plus d’arrêts qu’on ne m’en extorque.
Vos mères, journalistes de France TV.
Non, je n’examine pas tous mes patients qui me racontent qu’ils ne dorment plus.
Parce que leur tension, là, je m’en cogne. Parce qu’ils ne viennent pas me voir pour que je leur dose leur cholestérol. Alors oui, j’ai dû arrêter quelques fois dans ma vie des mecs qui m’ont prise pour une pomme, qui voulaient passer un week-end avec leurs potes et qui ont bien rigolé en leur racontant comme je les avais arrêtés juste en les croyant sur parole. Au nom de tous les mecs que j’ai été la seule à écouter, la seule à entendre, la seule à croire, tant pis.
Mon job, c’est d’être aux côtés de mes patients. C’est pas d’être flic, ou directeur de conscience.
Mon boulot est assez dur comme ça, je me contente d’essayer de le faire.
Bref, sur Twitter à l’aube, je m’énerve bien.
Caméras cachées de mes couilles, de gens qui ont pas la moindre idée de ce qu’est mon boulot et qui viennent me donner des leçons à une heure de grande écoute.
J’inspire j’expire.
Il est maintenant 10h57, et je tombe là-dessus :
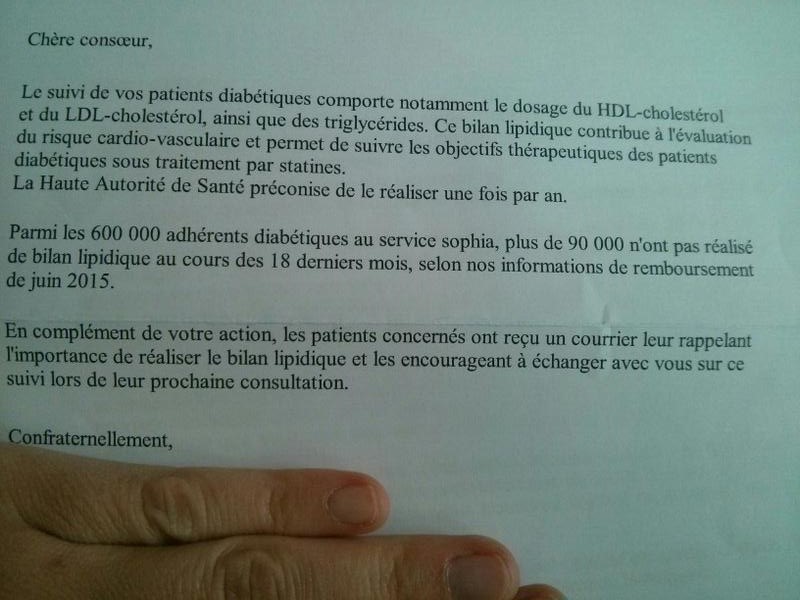
Ça, c’est un truc envoyé par Sophia, qui est genre pour faire vite une branche de la sécu qui propose aux patients diabétiques de les suivre de près et de leur envoyer des bons conseils par la poste 3 ou 4 fois par an, parce que leurs médecins sont vraiment des tanches pas capables de suivre des diabètes (en résumé).
Le bilan lipidique, je vous la fais en court aussi, mais depuis un moment, de plus en plus d’études disent qu’on s’en cogne.
En gros, l’histoire c’est qu’il vaut mieux donner des médicaments anti-cholestérol plutôt en fonction des facteurs de risques globaux, et pas en fonction du chiffre noté sur le papier. En gros, si vous êtes diabétique trop gros avec un père qui a fait une crise cardiaque à 40 ans, ça vaut sans doute le coup de vous donner une statine, même si votre chiffre de cholestérol sur le papier de la prise de sang est pas si pire, alors que si vous êtes un type mince en bonne santé qui fait du sport sans aucun antécédent, on ferait mieux de pas vous en donner même si le chiffre sur le papier est très vilain.
Je résume, hein.
Bref, perso, mes diabétiques à haut risque cardio-vasculaire qui ont déjà un médicament pour le cholestérol, j’arrête de leur doser. Parce que grosso modo, quel que soit le résultat, le médicament est indiqué pareil.
Bref, passons les considérations théoriques.
Arrêtons-nous sur le « Vos patients concernés ont reçu un courrier leur rappelant que vous êtes un gros naze qui fait pas ce qu’il faut pour leur santé. »
Je vais me permettre un AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH.
Qui es-tu, Sophia de mes fesses, qui ne connais pas mes patients, qui ne sais pas leurs frousses, leurs certitudes et leurs incertitudes, leurs représentations familiales, qui ne sais pas à quel point je bataille pour réussir à faire un bilan 1 fois par an à M. Bernard (qui en veut zéro), alors que je bataille pour faire un bilan 4 fois par an à Mme Michel (qui en veut dix), qui ne sais pas que M. Leduc prend tous les jours sa statine et des fois deux quand il a mangé un os à moelle, ni que M. Gras l’oublie un jour sur deux parce que le soir avec son travail il y pense pas, et que M. Fernand attend son bilan tous les ans comme le messie pour savoir s’il va faire sa semaine de jeûne ou non, et que Mme Bourgeois prend de la levure de riz rouge en plus parce qu’on ne sait jamais, qui es-tu, bordel de dieu, pour faire rentrer tous ces gens-là dans la même case en décidant que j’ai eu tort de ne pas leur faire un bilan inutile cette année ?
Et que vais-je dire à Mme Michel qui me réclame son cholestérol tous les deux mois, à qui je me suis échinée à dire que c’était pas la peine, quand tu lui auras envoyé ton courrier qui dit « Ahahah, ton médecin c’est rien qu’un sale mauvais qui aurait dû te doser le cholestérol » ?
Que fais-tu de la confiance que j’ai mis un ou deux ans à tisser, péniblement, avec mes petites mains et mes petits fils de laine rabibochés ?
Tu t’assoies dessus ? Ah oui, ok, c’est bien ce qu’il me semblait.
Mais mêlez-vous de vos fesses, Marie Jésus Joseph.
À ce stade-là, en 12 minutes sur Twitter et 40 secondes dans ma vie à moi qui remonte mon fil, j’ai déjà eu deux injonctions paradoxales et je suffoque.
Ahahah, les médecins qui écoutent leurs patients et qui les croient, et qui font des arrêts de travail qui coûtent des sous à la sécu.
Ahahah, les médecins qui écoutent pas leurs patients et qui leur font pas des bilans sanguins inutiles qui coûtent des sous à la sécu.
À ce stade-là, j’ai singulièrement envie de raccrocher la blouse.
Moi, qui ne vis que pour mon métier.
Il était 10h59, et je sentais de gros muscles verts poindre sous ma chemise de nuit et la déchirer. (C’est une image, j’ai pas de chemise de nuit.)
Du coup, j’ai repensé en arrière.
J’ai repensé à ma collègue, qui va fermer sa porte, parce que les statistiques de la sécu lui ont dit qu’elle faisait trop d’arrêts de travail.
Que je vous raconte un peu comment ça marche, les contrôles de la sécu.
Ils prennent une moyenne (genre combien de jours d’arrêt pour X patients par médecin), et ils prennent les 10% du dessus, et ils leur tombent dessus. « Vous faites plus d’arrêts que la moyenne de vos collègues » .
Si t’essaies d’expliquer que tu vis dans une zone défavorisée, pleine d’ouvriers qui se pètent le dos dans des usines malveillantes qui te surveillent quand tu vas pisser, ils te répondent : « Oui mais vous faites plus d’arrêts que la moyenne de vos collègues » .
Si t’essaies d’expliquer que tu vois 70% de gens de plus de 68 ans, contrairement à tes collègues, ils te répondent : « Oui mais vous faites plus d’arrêts que la moyenne de vos collègues » .
Et on cause en pourcentage, hein.
C’est-à-dire que le mec qui voit 85 patients par jour sans sourciller, qui fait des consults de 5 minutes, qui facture des trucs que toi tu fais 8 fois par jour en acte gratuit (l’ordonnance de semelles orthopédiques pour une petite de 6 ans aux pieds plats, le renouvellement de passage infirmier pour 6 mois pour un patient grabataire, le renouvellement d’INR pour ton patient sous AVK, juste un vaccin entre deux parce que tu l’as déjà vu et examiné il y a quatre jours et que tu fais juste l’injection et que con comme tu es tu fais pas payer, l’ordonnance de Doliprane pour la mère que tu connais et qui en a besoin sur la consultation de la fille, je m’arrête là parce que vous voyez mais j’en fais bien 6 à 10 par jour), bref, le mec qui fait 85 consultations par jour dont 10 actes qui devraient être gratuits qu’il fait payer parce que hey, en passant juste la carte vitale personne ne voit rien, bin son ratio d’arrêts de travail sera vachement meilleur que le tien, pauvre con qui a expliqué aux gens qu’il ne sert à rien de consulter pour un rhume, qui a fait des vaccins et lu des bilans biologiques et des IDR entre deux sans faire payer, qui a appelé deux ou trois patients inquiets pour leur donner des conseils gratuits au téléphone et expliqué que la consultation en urgence aujourd’hui c’était pas la peine.
Ce mec-là sera jamais emmerdé par la sécu. Parce que son ratio est super bon. Parce qu’il reconvoque les otites à J3 pour vérifier.
Parce qu’il renvoie à d’autres les patients un peu trop chiants, un peu trop lourds, un peu trop malades, un peu trop pas rentables.
Il a des chiffres fabuleux, pour la sécu. Voilà un médecin comme il faut. Voilà un médecin qui n’arrête pas trop.
Et ma consœur, on lui tombe dessus. On lui explique qu’elle fait mal. On lui explique que statistiquement elle est pire que les autres. STATISTIQUEMENT, hein. C’est-à-dire qu’elle est dans la tranche du haut. Donc on lui explique qu’elle est le dernier wagon du train, celui où il y a le plus de morts, et que pour bien faire on va supprimer le dernier wagon. Une fois le dernier wagon supprimé, l’avant dernier deviendra le dernier, et on lui tombera dessus parce qu’il est le dernier.
Elle va partir.
Alors qu’elle est le médecin que vous voudriez tous avoir.
J’ai repensé aussi et j’ai la flemme de vous chercher le lien à cet article sur les infirmiers libéraux qui coûtent trop cher.
Les énarques, sur leurs petits sièges en velours, ont vu des chiffres. Ohlala les dépenses de soins infirmiers en ville augmentent trop beaucoup. Ils coûtent trop cher. Il y a sans doute des abus. Contrôlons-les, réduisons-les, assommons-les.
Qu’on soit très clairs, on parle des tarifs des infirmiers à domicile. Genre 3 euros pour une prise de sang et 7 euros pour un pansement difficile de 20 minutes. REMBOURSÉS.
Les chiffres sont limpides : ça augmente !! SCANDALE !
Alors qu’on fait des plans de réduction des coûts hospitaliers, qu’on fait sortir les gens de l’hôpital de plus en plus tôt après une opération pour économiser des sous, qu’on les balance à domicile 48h après leur chirurgie parce que hey, l’hôpital c’est pas l’hôtel, que les gens vieillissent et vivent à la maison de plus en plus vieux, figurez-vous que c’est pas dieu possible les coûts des infirmiers à domicile augmentent !
Alors la solution est simple, c’est qu’ils sont trop payés ou trop nombreux et qu’il faut diminuer l’offre.
Idem pour les transports, sur un autre article que j’ai re la flemme de vous chercher. Le coût des transports augmente, il y a fraude. Les médecins font des bons de transports de complaisance, je ne vois que ça.
Mon lapin. On a de plus en plus de vieux, on a de plus en plus de pauvres, on a de plus en plus de mis de côté de la société qui ne veut plus d’eux, on a de plus en plus de gens sortis manu militari de l’hôpital parce qu’ils coûtent trop cher, et la seule explication que tu vois au coût des soins infirmiers à domicile et des transports qui augmente c’est que les gens abusent et que les médecins sont complaisants ?
Et je te paye avec mes impôts pour mobiliser tes trois neurones pour arriver à ces conclusions-là ?
Je m’emporte, pardon.
J’ai atteint le point « Et c’est avec mes impôts ! », c’est le signe que je dois sans doute arrêter de parler.
Mais tu vois, je suis la fille qui ne vit que pour son métier, qui ne se définit que par ça, qui ne serait rien sans lui, et à qui tu as donné envie, en 12 minutes sur twitter, de tout plaquer et d’aller dresser des ours en Auvergne.
Alors que je connais même pas l’Auvergne et que si ça s’trouve c’est moche et y a pas l’ADSL.
Demandez-vous.
21 septembre, 2015
J’ai connu Mme B. au tout début de mon remplacement chez le Dr Cerise.
Je l’ai très vite pas aimée du tout.
Au bout de ma troisième consult avec elle, j’écrivais dans son dossier : « Moi je trouve surtout qu’elle consulte beaucoup trop souvent pour une femme de 32 ans » . Et la fois d’après : « Il faut arrêter les examens complémentaires ».
Elle était INSUPPORTABLE.
Il fallait l’arrêter trois fois de suite pour une sinusite à la con.
Elle avait encore trooooop mal. Et elle se sentait encore troooop pas bien.
Moi on était en février, et je fumais deux paquets par jour et je crachais un demi-poumon entre chaque deux patients, en me tenant pas sur mes jambes et en étant obligée de m’asseoir par terre parce que tousser me prenait toute la force que j’avais en moi et dépassait celle de tenir juste debout sur mes jambes, et elle il fallait que elle je l’arrête parce qu’elle avait encore trop mal au sinus droit sous l’œil, et puis la tête comme du coton aaaaah ça n’allait pas du tout elle pouvait pas aller travailler comme ça. Ça me rendait folle.
Elle avait obtenu haut la main le record de lapins sur la plus petite durée de temps envisageable.
J’veux dire, la meuf était capable de te poser trois lapins sur la même matinée.
Elle venait pas à son rendez-vous de 8h.
J’appelais, à 9h30, elle avait pas pu venir, elle s’était pas réveillée, vaguement pardon, elle reprenait rendez-vous à 11h45.
À 11h43 elle appelait pour dire qu’elle annulait le rendez-vous de 11h45 et elle en reprenait un à 12h30.
Et puis elle arrivait à 13H12, en disant : « Oui mais on a dû habiller sa Barbie » .
Moi je pétais un plomb. « On a dû habiller sa Barbie » , sur le TROISIÈME rendez-vous de la journée, je me sentais pousser des veines sur mes tempes dont je ne soupçonnais pas l’existence.
Au 12ème lapin, du haut de ma troisième année d’exercice et de mes 30 ans, j’ai tapé du poing sur la table.
Je l’aurais peut-être pas fait pour une autre, mais elle m’agaçait tellement, avec ses bajoues vides et son regard bovin et son « On a dû habiller la Barbie » l’air de s’en foutre totalement, sans dire pardon ou désolée ou mes couilles, j’ai craqué. J’ai demandé son aval à mon chef, et je lui ai dit que les prochaines fois, ce serait 40€ la consult. Voilà. AHAH ! Toc !
J’ai pris mon air docte, je lui ai dit que maintenant ça suffisait, et que pour tous les retards, ce serait 40€.
Je l’aurais fait sans doute pour personne d’autre, mais elle, vraiment, elle me sortait par les yeux.
Elle a hoché la tête et elle a payé 40€ et je me suis dit que j’avais rudement bien fait.
Parce que comme ça JE LUI APPRENAIS, voyez ?
J’ai connu Mme G. au tout début de mon remplacement chez le Dr Carotte. Et je l’ai très vite pas aimée du tout.
Elle arrivait toujours en retard, toujours, elle aussi.
Avec l’air de s’en foutre et des excuses pourries, des j’ai pas trouvé de place pour me garer, et presque à l’entendre c’était de ma faute.
Elle venait toujours pour des trucs qui existent pas, des vertiges qui n’en étaient pas, des douleurs thoraciques merdiques, des gênes respiratoires de mes fesses. Elle exigeait toujours un scanner de tout le corps « pour voir ce qui n’allait pas », parce que c’était quand même pas normal et que dans la tête dans la tête quand même elle voulait bien mais que c’était pas dans la tête de pas pouvoir respirer à ce point-là. Elle voulait qu’on lui dose son magnésium et « tous les acides aminés » pour voir si elle avait pas des carences. Elle arrivait avec 12 minutes de retard en disant que c’était pas grave parce que c’était même pas pour une consultation c’était pour une prise de sang.
Et son arrêt de travail qui n’en finissait pas, qui partait sur une sciatique, qu’on prolongeait pour une sinusite et qu’on re-prolongeait pour une tendinite de la moitié gauche du corps (??).
Quand j’avais réussi à la calmer sur la respiration, elle revenait avec des fourmis dans la moitié du corps et que c’était quand même peut-être une sclérose en plaques parce qu’elle avait lu sur Internet que les fourmis c’était peut-être la sclérose en plaques.
Dans la salle d’attente elle criait et elle apitoyait tout le monde de à quel point elle devait passer avant tous les autres.
Ses enfants faisaient un bruit qui existe même pas sur l’échelle de Richter du bruit ; du coup ça m’allait bien qu’elle passe avant tout le monde même si c’était pas justifié du tout, ça faisait du bien à ma tête.
Les patients avant elle me glissaient en fin de consultation : « Heu, je sais que ça me regarde pas, mais la dame après moi, elle parle pas à son enfant. Enfin j’veux dire pas du tout. En deux heures. Je… je sais pas, je me dis que c’est bien que vous le sachiez, je sais pas, au cas où. »
Et puis elle arrivait sur ses grands chevaux et sur ses plaintes incompréhensibles, ses reproches sur ce que j’avais pas fait alors que sa cousine qui avait la même chose elle avait eu une IRM, et je l’aimais pas.
Et pourtant, ça fait un moment que je vous le raconte, j’aime tout le monde.
J’aime tous mes patients, depuis mes tripes.
J’aime les gros, les moches, les qui sentent mauvais (je crois que j’aime ENCORE PLUS ceux qui sentent mauvais), et allez savoir pourquoi aussi les méchants, les racistes, les homophobes.
Je pardonne des trucs à mes patients que je ne pardonnerais jamais au reste du monde dans le reste de ma vie.
J’ai un puits d’amour à peu près sans réserve.
Et elles deux (et là encore je dis elles deux parce que je vous ai parlé d’elles, mais il y en a beaucoup d’autres que sans savoir pourquoi, sans vraie raison, j’ai haïes), elles deux je les détestais.
Le temps a un peu passé.
J’ai arrêté d’écrire « Elle consulte beaucoup trop ! » et « Elle est agressive sans raison… » dans mes dossiers.
J’écrivais « Plaintes multiples habituelles », et je faisais des tours de passe-passe avec du Spasfon et du Laroxyl.
Et puis, quatre ans après, en les revoyant, j’ai vu des notes.
Pas de moi, des notes de l’autre médecin que je remplace, ou de celui qui remplace le même médecin que moi.
Mme B. était cognée par son mari. Tous les jours. Fort.
Quand elle arrivait en retard, elle disait « On devait habiller la Barbie » , parce que si elle partait avec la Barbie à moitié nue, elle s’en prenait une, ou deux. Ou trois, sans raison. Parce que la Barbie était nue. Et que ça elle pouvait pas le dire.
Mme G. a été violée par son beau-père, de ses 6 à 16 ans, dans le silence assourdissant de sa famille.
Moi, Mme B. je lui ai fait payer 40€ ses violences, parce que ça se faisait pas.
Mme G. , je l’ai pourrie, parce qu’elle était incorrecte.
Et toutes les deux, j’avais un truc au fond du ventre qui me faisait les haïr, alors que j’aimais d’amour vrai des gens bien pires sur le papier qu’elles.
Entre deux, j’étais allée sur Twitter. J’avais rencontré des gens, des victimes ou des médecins sensibles, qui m’avaient appris un peu que quand tu détestes une patiente super reloue, peut-être ça vaut le coup de poser la question.
J’ai relu en vitesse mes consultations d’il y a 5 ans, mes réactions du moment, et j’ai eu un peu, beaucoup, à la folie honte.
J’ai revu Mme B.
J’ai lu les violences dans son dossier.
J’ai regardé mon pied gauche, et puis mon pied droit, et je me suis dit qu’il fallait le dire.
J’ai dit : « Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quatre ans, j’ai été un peu dure avec vous, parce que vous étiez toujours en retard… »
Elle a dit « Oui, je me souviens. »
J’ai dit : « Je m’excuse. J’aurais dû me rendre compte, j’aurais dû poser la question, je ne l’ai pas fait. »
Elle a dit, avec toujours son œil impassible : « Oui, vous auriez dû. »
J’ai dit « Je suis désolée. »
Elle a dit « C’est pas grave, merci. Personne ne l’a fait. »
Voilà.
Tout ça pour dire : posez la question. Demandez-vous.
On m’a dit un jour dans une formation « Un gamin que tu as envie de taper, c’est peut-être qu’il est tapé. »
Bin une patiente que vous détestez, c’est peut-être qu’elle est détestée.
Arrêtez-vous.
Demandez-vous pourquoi vous avez envie de la taper.
Demandez-lui si elle est tapée.
Ce sera oui. Souvent.
Préparez-vous.
Petit traité imaginaire de médecine réelle.
2 juin, 2015
I] Introduction
Je crois vous avoir déjà parlé de mon amour des cases.
Et je l’ai déjà évoqué aussi, entre les cases de la fac et les cas de la vie, il y a un monde.
Un super-génial monde : un monde de vrais gens et de cas particuliers, un monde d’exceptions et d’individus individuels, un monde de cas qui refusent de se laisser mettre en case.
C’est la richesse de ce monde-là qui fait toute la richesse de la médecine générale.
Parce que ok j’aime les cases d’un amour complètement immodéré, mais quand même, si tout le monde rentrait sagement dedans, nous serions rapidement (comme pensent l’ARS et la sécu que nous le sommes) remplaçables par des algorithmes et par des ordinateurs, et on se ferait gravement chier.
Mais re mais quand même*, certes on se ferait gravement chier mais il faut bien dire que c’est quand même tout un apprentissage à refaire, quand on sort fraîchement émoulu de la fac, qu’on n’a pas encore tout à fait coupé ses couettes et qu’on part à l’assaut de la vraie vie avec notre épée en bois et nos moulins à vent.
II] Les cases manquantes
Je passe une partie pas assez négligeable de mon temps à me bagarrer contre l’idée trop fréquemment reçue que la médecine générale, c’est bien sympa, mais c’est quand même que des gastros et des grippes.
Parce que la médecine générale, figurez-vous que c’est vraiment pas que des gastros et des grippes. Y a des rhumes aussi .
Mais quand même **, il faut bien l’avouer : OK BON DES FOIS ON VOIT DES GRIPPES QUAND MÊME.
Et bin mine de rien, lors de mes premières passes en cabinet, mon angoisse, ma terreur, mon « mais au secours je sais pas quoi faire », c’était la rhino.
Une appendicite, une cholécystite, un diabète déséquilibré, un Pouteau-Colles, j’avais le bagage.
La rhino, j’avais aucune idée. On m’avait jamais appris cette case-là.
Ma première rhino, j’ai dû appeler ma maître de stage pour lui dire « Heuuuu y a Monsieur Machin qui demande un pschit pour le nez, et heu, qu’est-ce qu’on met, comme pschit pour le nez ? » . J’ai bien vu à l’œil désabusé du patient qu’un médecin qui connaît pas les pschits pour le nez, c’était encore pire qu’un médecin qui prend pas la tension ; j’ai bien vu à l’air ahuri de mon maître de stage que je venais de poser pas loin de la pire question que de tout temps l’Homme ait jamais posée depuis l’invention de la question, mais vraiment, sincèrement, je n’avais aucun nom d’aucun pschit pour le nez en tête.
Je savais grâce à Prescrire les pschits pour le nez mauvais pour le cerveau pleins de pseudoéphédrine qu’il faut éviter à tout prix, j’avais du coup bien en tête les noms des vilains pschits caca pour le nez, mais des gentils qu’on peut mettre quand même même si au fond on sait bien que ça sert à rien, que dalle.
Le premier niveau d’apprentissage a donc été les noms des pschits pour le nez qu’on a quand même un peu le droit de prescrire.
(« J’ai été confronté au problème mais j’estime que je n’ai pas suffisamment d’expérience pour pouvoir le gérer correctement une autre fois »)
Et ça se passait pas si bien, mes rhinos.
Je voyais bien que les gens étaient pas contents dans l’ensemble en repartant. (Et avec le recul, bon, la fille qui tourne frénétiquement les pages de son Dorosz à la fin d’une consult pour rhino J2, j’avoue volontiers que ça puisse inspirer moyen confiance sur une échelle des frères Bogdanov à Irène Frachon.)
Le deuxième niveau d’apprentissage a été de trouver où mettre savamment le curseur, pour signifier à la fois au patient que sa rhino est la chose la plus passionnante qui nous soit arrivée de la journée, qu’on compatit terriblement à son monstrueux nez qui coule (VERT !), que la vie est sacrément injuste de coller des rhinos comme ça à des gens gentils qui ont rien fait pour mériter un truc pareil ET que quand même c’est pas assez grave pour justifier des antibiotiques, que ça va passer tout seul même s’il faudra être très courageux en attendant, et que allez, à la rigueur, la prochaine fois, peut-être même que ce sera pas la peine de consulter.
(« J’ai été confronté au problème plusieurs fois et j’estime maintenant pouvoir le gérer »)
Je suis devenue une grande, grande, grande pro.
La dernière fois qu’on est parti en râlant que quand même pour se faire prescrire du Doliprane et du sérum phy c’était pas la peine de payer 23€ était en 2012.
Et mon taux de patient qui proteste quand même vaguement parce qu’il aimerait quand même mieux des antibiotiques est tombé sur les bronches à quelque chose comme un par an, alors qu’il frisait les 85% au début.
III] Les cases inventées
Je ferai vite : d’abord parce qu’elles sont un des corollaires directs de l’exemple rhinal du point II.
Ensuite et surtout parce que Borée les a déjà magistralement décrites ici. (Si vous ne devez cliquer que sur un lien de ce post, cliquez sur celui-là. Les autres ne sont jusqu’à présent que des renvois un peu monomaniaques et égocentriques à moi-même.)
Des fois, pour placer savamment le curseur, on sent quand même*** que le patient ne va pas réussir à se contenter d’un « Bah vous êtes malade, quoi, vous avez un rhume ».
Et, sans qu’on comprenne bien pourquoi, emporté par la fougue de la commisération et de l’empathie, on entend notre bouche déposer sur l’autel de la souffrance le diagnostic magistral de « rhino-pharyngo-stomatite ».
C’est rigolo et déclinable à l’infini.
Essayez : vous prenez à peu près n’importe quelle partie anatomique entre la base du cou et la ligne supérieure des sourcils, vous en choisissez 2, 3, voire 4 en fonction de la théâtralisation nécessaire à l’apaisement du patient, vous mettez des « o » à la fin des n-1 premiers termes, un « ite » à la fin du dernier, et vous sortez un superbe diagnostic pontifiant du fond de votre chapeau à compassion.
IV] Les cases ethnologiques
J’ai décrit avec un peu d’incertitude au départ et une conviction de plus en plus profonde à mesure que j’en rencontrais l’hémichauderie corporelle gauche.
Je ne l’ai pas dit dans mon post d’origine, je ne sais plus pourquoi, sans doute par peur de faire trop long, mais j’ai fini par me poser sincèrement des questions d’ethnomédecine. Ma tête ne pouvait pas s’empêcher de faire un lien entre les pathologies propres et rangées dans des belles cases occidentales et les expressions consacrées du pays correspondant.
« En avoir plein le dos » et les lombalgies mécaniques banales.
« Faire chier » et les colopathies fonctionnelles.
À force de voir des femmes arabes de 50 ans qui avaient chaud à gauche, à force de voir en elles le reflet en miroir autour de la Méditerranée de mes blanches lombalgiques de 50 ans, j’ai demandé à Twitter s’il existait des locutions, des expressions arabes exprimant la fatigue et/ou la dépression qui tourneraient autour d’une moitié de corps.
À ma première demande en 2012, on m’avait conseillé la lecture d’une thèse passionnante qui a très malheureusement disparu dans les tréfonds du net, mais je n’avais pas eu de réponses précises, avec des locutions arabes explicites.
À ma deuxième demande, en 2014 (je suis obstinée), j’en ai eu.
– « tah meni noss » mais ça exprime un effondrement physique et psychique suite à un choc émotionnel, littéralement « ma moitié s’est effondrée » (@bisoutherapeute)
– J’en ai une autre. « Kelbi kighrak »= mon cœur se noie. (@Perpinette)
– il y’a aussi « nessi n’chel » : ma moitié s’est paralysée en apprenant une mauvaise nouvelle par exemple. (@benamara)
Je suis TELLEMENT convaincue qu’il y a plein de réponses à plein de nos cases-qu’on-comprend-pas en fouillant un peu dans le langage / la culture / l’histoire des pays.
V] Les cases floues
Au départ, ce post ne devait aborder que ce point. Mais vous voyez ce que c’est : on cause, on cause, et on s’emballe.
Mais vraiment, s’il y a bien un point où il y a les cases de la fac et les cas de la vie, c’est bien sur les cases floues. Parfois aussi appelées les cases-valises. Comme rien ne vaut un bon steak autant qu’un bon exemple, plongeons-nous directement et sans tarder dans leur monde infini et inlassant :
1) La cysphrite
La cysphrite est l’exemple-roi de la case floue, aussi commencerons-nous par elle.
Dans la cysphrite, le patient type est une jeune femme sans antécédents de 18 à 38 ans.
Elle a une dysurie assez franche, avec des brûlures mictionnelles, une pollakiurie, un peu de sang dans les urines et aucun facteur de risque de quoi que ce soit.
Mais quand même***, au fil de votre interrogatoire de bon élève policier, elle a eu 38° avant-hier mais plus de fièvre depuis, et une vague douleur un peu floue en fosse lombaire droite.
À l’examen, elle est fraîche comme la rosée du matin, elle à 37,1°, un ventre souple, une BU positive, et elle grimace vaguement à la percussion des fosses lombaires, en vous expliquant que c’est pas vraiment une douleur mais que ça fait un peu mal quand même.
>> C’est une cysphrite.
La cysphrite n’est décrite dans aucun livre de médecine du monde. J’en dépose le nom ici même, et nourris l’espoir secret que dans quelques années la réalité de la cysphrite explose aux yeux du monde médical qui lui donnera avec une reconnaissance toute méritée à mon égard et une humilité assumée sur son aveuglement depuis des années, dans tous les livres médicaux, mon nom. La cysphrite ™Jaddo.
La cysphrite est une putain de réalité. Que celui qui n’en a jamais vu une me jette le premier copyright.
Du coup, en l’absence de case, un peu honteusement, un peu reconnaissant d’être seul dans votre cabinet sans un maître de stage ou un externe pour vous observer, un peu en ayant bien conscience de faire vaguement de la merde mais en ne pouvant décemment pas coller 14 jours d’antibio à la rosée du matin ni 1 sachet de Monuril à une fille qui a eu 38 et une douleur lombaire, vous épongez les gouttes perlant à votre front, et vous notez sur l’ordonnance 5 jours d’Oflocet.
Une ordonnance entre chien et loup.
Vous vous sentez vaguement sale.
C’est le signal contre-transférentiel de la case floue.
2) La bronchonie
Je pense que vous avez saisi le concept : la bronchonie survient typiquement chez un patient obèse de 68 ans, diabétique et tabagique, sans BPCO.
Il a de la fièvre depuis un tout petit peu trop longtemps pour être serein comme par exemple 4 jours et demi, aucun foyer à l’auscultation mais il ronchise fort de partout, il crache un peu plus vert que d’habitude mais seulement le matin, il a un bon état général c’est-à-dire qu’il est aussi essoufflé que d’habitude mais peut-être un peu plus, et il tousse vraiment beaucoup.
Ce serait le même tableau clinique chez un type de 20 ans, vous lui diriez de boire du citron chaud en lui expliquant néanmoins**** à quel point la vie est cruelle avec lui.
Mais là, quand même, vous fouillez dans vos poches, vous sortez un stylo, et en regardant autour de vous, bon : personne : 3 grammes d’amox discrètement sorties de derrière les fagots.
Vous vous sentez vaguement sale.
C’est le signal contre-transférentiel de la case floue.
3) La cystose
La cystose arrive dans le même cadre que la cysphrite. Une patiente jeune, sans facteurs de risques, avec une dysurie assez franche, des brûlures mictionnelles, une pollakiurie, un peu de sang dans les urines, et, au fil de votre interrogatoire de bon élève policier, ça gratte franchement dans le vagin et sur les lèvres, et elle a des pertes heu pas vraiment anormales-anormales mais pas comme d’habitude non plus, un peu épaisses oui docteur, heu comme du lait caillé oui oui mais vous lisez dans ses yeux qu’en 2015 et à 19 ans elle n’a jamais vu de lait caillé de sa vie.
Vous insistez : mais ça gratte vraiment ? Oui.
Mais en faisant pipi, ça brûle sur tout le sexe, ou seulement au niveau du trou pour faire pipi ? Ça brûle uniquement au niveau du trou.
Mais ça gratte vraiment ? Tout le temps ? Oui.
Mais les pertes sont vraiment anormales ? Bin un peu mais pas trop, enfin normalement anormales, quoi.
Au début, devant votre première cystose, vous vous rappelez qu’on a le droit d’avoir la syphilis et un bureau de tabac.
Vous vous dites que bon, une cystite et une mycose à la fois, dans une tranche d’âge où les deux sont fréquentes, pourquoi pas.
Et c’est en ayant l’impression un peu honteuse de n’avoir pas de diagnostic vraiment tranché que vous écrivez sur la même ordonnance du Monuril et du Gynopévaryl, en priant intérieurement le pharmacien de ne pas vous juger.
Et puis, à votre sixième cystose, vous commencez à vous dire que la syphilis et le bureau de tabac c’est certes possible, mais quand même pas si fréquent.
Que peut-être vous passez à côté de quelque chose.
Que peut-être vous ne savez plus vraiment les critères diagnostiques de la cystite.
Que peut-être il y a un facteur déclenchant commun. Vous vous retrouvez au petit matin devant les résultats PubMed de votre recherche « Sodomie + mycose vaginale ».
Vous ne trouvez rien de concluant.
Vous faites encore 2 ou 3 ordonnances par an de Monuril + Gynopévaryl, en vous disant que le pharmacien a dû s’habituer entre-temps.
Vous vous sentez vaguement sale.
C’est le signal contre-transférentiel de la case floue.
4) Bon je pense que vous avez compris.
Je ne vous détaillerai pas l’otalgite, la rhinusite, le rhumasaki (c’est un rhume fébrile qui dure depuis 10j, cc @UnDruide).
5) Les limites
C’est joli, de rajouter des cases au cases décrites.
Ça semble coller à la réalité, au terrain. Ça semble faire un pied de nez salutaire aux cases et aux livres, à la fac et aux cours, et aux recos HAS et parfois même (Dieu me pardonne) à Prescrire qui eux semblent parfois oublier la vraie vie, les tableaux cliniques atypiques et le patient à qui le Paracétamol ne suffit plus et qui gerbe sa Codéine alors que le Tramadol est caca mais que voulez-vous qu’on fasse.
Néanmoins, entre mes jolies cases de traité imaginaire de médecine réelle et votre vieux maître de stage aux belles tempes argentées qui vous propose une conduite à tenir à se taper la tête contre les murs et à hurler de désespoir sur l’épaule trop large du Formindep, sous prétexte que dans son expérience c’est pas comme dans les livres et que pour lui et ses patients ça a toujours très bien marché, il n’y a qu’un pas.
Méfions-nous un peu des cases, méfions-nous beaucoup des pas.
J’ai fini par accepter la cysphrite comme une entité à part entière, j’ai fini par me convaincre que j’avais mis le doigt sur un vrai truc ™Jaddo, et j’ai fini par avoir de moins en moins honte devant mes ordonnances bancales d’Oflocet 5 jours.
De moi à mon maître de stage décrié qui inventait la médecine à mesure des visiteurs médicaux et de son expérience personnelle, de l’EBM (evidence based medecine) à l’MFBM (mes fesses based medecine), il n’y a qu’un pas.
La réalité nous pousse à avoir envie de le passer.
Mais quand il suffit de passer le pas, c’est tout de suite l’aventure.
*J’ai un petit côté passif-agressif avec les cases, en fait.
** Un post à thème « mais quand même » , donc.
*** Sérieusement, il faudra que je compte le nombre de quand même à la fin de ce billet.
**** Youhou, un « quand même » de moins !
Pour que le feu reprenne (sic)
20 mars, 2015
J’étais petite. Peut-être en fin d’école primaire, ou peut-être au début du collège.
Une copine m’avait dit avec des grelots de désapprobation dans la voix : « Nan mais elle, elle ferait n’importe quoi pour que les gens l’aiment » .
J’avais ricané, j’avais dit Ahah, la naze.
Et puis en fait je m’étais demandé. Est-ce que c’est si mal ? En fait est-ce qu’il y a au monde un objectif plus noble ?
C’est quoi, en définitive, faire n’importe quoi pour que les gens nous aiment ?
Être gentille ? Être bienveillante ? Être drôle, être attentive, être généreuse ? Est-ce que ce serait pas un peu au fond comme Dieu ? Avec un objectif un peu illusoire, mais un chemin qui fait du bien, et au fond, même si on n’est pas d’accord avec la barbe qu’il y a au bout, la vache, des moyens qui comptent davantage que la fin ?
Bref, j’ai été convaincue très tôt que tout faire pour qu’on vous aime, c’était un putain de bel objectif. Pas honteux. Qui permettrait peut-être une jolie route. J’ai tout imaginé, tout détricoté dans ma tête, et je n’ai pas trouvé un exemple dont découlerait un truc pas bien.
Faire tout pour que les gens m’aiment est même devenu mon objectif. Parce que même si c’était paumé d’avance, ça ferait de moi quelqu’un de pas si mal. (Si l’éternel existe, en fin de compte il voit… oui, voilà, un peu cette idée-là.)(Cliquez vraiment sur le lien, il est extraordinaire.)
Et bêtement j’ai continué avec mes patients.
La « décision partagée », c’est joli sur le papier. Dans ma vraie vie, la décision c’est celle de mes patients.
Trop, et trop souvent.
Non mais non, je peux quand même pas vous demander d’arrêter COMPLÈTEMENT le fromage. (Ce serait trop méchant)
Oui bon, ce serait pas si mal d’essayer de descendre à quatre verres par jour. (Si vous pouvez ?)
Alors quand même je pense que là ce serait pas une erreur de vous hospitaliser. (Si vous êtes d’accord ?)
Et puis les gens peuvent pas aller à l’hôpital parce que vous comprenez ils ont des choses à faire. Et s’ils y vont, qui va s’occuper de leur mère, ou de leur fille, ou de leur chien ? Parce que bon, on peut peut-être essayer les mêmes antibiotiques que la fois dernière ?
Alors moi je dis ok, oui, bon, d’accord, on peut peut-être essayer les mêmes antibiotiques que la dernière fois.
Comme ça les gens sont contents. Ils m’aiment, parce que j’ai été gentille. Et puis je reçois un courrier du mec de l’hôpital qui dit que mon patient est passé à deux doigts de l’amputation, et que j’aurais dû l’envoyer il y a trois mois. Et puis je reçois sa femme entre deux qui a besoin d’un papier quelconque, et qui me dit « Vous savez mon mari il est à l’hôpital, et puis ils ont failli lui couper le pied parce qu’ils ont dit que vous auriez dû l’envoyer plus tôt ».
Et j’ai un neurone qui cabre et qui rue, et qui dit que je lui avais dit qu’il fallait aller à l’hôpital, et que c’est lui qui a pas voulu.
Et puis je me ré-entends. Avec mes « quand même » et mes « peut-être », avec mes conditionnels, avec mon ton de voix qui dit de toutes ses forces « Non mais c’est vous qui décidez, personne peut décider à votre place, dites-moi. ».
Le mec, j’aurais pu taper du poing sur la table. J’aurais pu dire « Non mais là on n’a plus le choix, sinon peut-être on vous coupe le pied ».
J’ai dit « Ouiiiiiiiiiii, bon, il faut vous occuper de votre mère, je comprends bien, mais quand même vous voudriez pas ? »
Il a dit non, j’ai dit bon ok, non.
J’ai eu tort. J’ai eu super tort.
J’ai pas voulu l’embêter, et j’ai pas voulu le déranger, et j’ai pensé à sa mère dont personne ne s’occuperait.
J’ai dit « Bon ok, on va essayer les mêmes antibiotiques que la dernière fois. »
Et bien sûr Voltaire et la médecine me donnent raison.
Y a neuf fois sur dix où il se trouve que le mec a guéri tout seul, ou un peu avec moi, où ça s’est pas fini si mal que ça.
Mais mon boulot, bordel, c’est d’être sûre. De peut-être hospitaliser neuf types qui en ont pas besoin, (et pardon à eux, et pardon à l’équipe hospitalière qui va s’en occuper pour pas grand-chose pendant sept jours), pour un type à qui ça va sauver la vie.
Et je le fais pas. Je m’endors sur les statistiques, je me love dans la couette de la vie qui continue malgré moi. Pour qu’on m’aime. Pour qu’on trouve que j’ai été gentille.
Un peu par réaction aussi. Parce que je suis si entourée de médecins autoritaires et paternalistes, parce que j’ai une idéologie un peu idiote et surtout lâche en définitive, je me mets tout à l’autre bout de la balançoire, comme si ça allait changer les médecins autoritaires.
Sur l’autel de mon militantisme, je sacrifie des patients que j’aurais dû secouer davantage.
Je confonds Jaddo (qui doit prêcher la bonne parole générique) et le DocteurMonNomMonPrénom (qui doit faire ce qu’il y a de mieux pour son patient là maintenant). Je milite pour le choix du patient, et je les laisse faire des bêtises au lieu de taper du poing.
Un jour, sur Twitter, quelqu’un avait dit qu’il y avait pire que les médecins méchants : les médecins gentils et incompétents. Que c’était les plus dangereux.
Je pense qu’il a horriblement raison et que je ne suis pas loin de faire partie de ceux-là.
Parce que je sais que c’est pas terrible une grossesse à 46 ans avec du diabète et de l’hypertension et de l’hypothyroïdie, mais je sais pas les chiffres. Je ne sais pas, par un défaut bête et technique de compétences et de connaissances, à quel point il y a un risque sérieux pour l’enfant et pour la mère. Je sais que c’est pas terrible, je sais que c’est risqué, je sais surtout que tout le monde va la pourrir pour ça et par réaction je la soutiens, les yeux et l’antenne fermés. Je tire le fil de « ça arrive que ça se passe bien » et j’encourage avec toutes les œillères que Dieu fait.
Je pourrais encourager en donnant les cartes. En donnant les chiffres. En disant je sais que vous avez arrêté votre contraception, je vous suivrai et je serai avec vous tout le long de votre grossesse si vous le décidez, mais voilà les chiffres des risques.
Comme je ne connais pas les chiffres des risques et comme je veux que mes patientes soient heureuses de leur grossesse qui peut bien se passer, comme je sais qu’elles vont se faire pourrir pendant 8 mois par des gens qui vont les juger inconscientes, je dis Hourra et je leur serre la main très fort et je tais tout le reste.
Et après, je viens le dire ici, pour qu’on me dise « Tu as eu raison », pour m’endormir de vos soutiens, pour me dire que c’est pas grave et que je suis gentille et que si je suis mauvaise on me pardonne et j’apprendrai plus tard.
Et je vais me coucher en pensant que je suis gentille. Et un jour on amputera mon patient à cause de ma gentillesse.
Pas de TPG dans mes souliers.
24 décembre, 2014
Comme on m’a beaucoup demandé sur Twitter « Mais pourquoi t’es contre le tiers-payant généralisé alors que c’est une mesure gentille et que t’es gentille ? » (en substance et en manichéisme) et que 140 caractères c’est finalement assez peu, je vais essayer de vous le faire en plus de caractères ici.
Et comme ça me saoulera d’avoir un billet politicofoutraque en première page (parce qu’on va pas spécialement se fendre la poire, je vous préviens), ça me motivera pour vous raconter rapidement une histoire de patient, avec un peu de chance.
Donc, je m’en vais vous donner mon point de vue à moi, qui n’est pas forcément celui des syndicats que je ne connais pas, ni « le point de vue des médecins généralistes ».
Si tant est qu’il soit besoin de le rappeler.
1/ Point 1 : je ne fais pas grève.
Principalement parce que je trouve que faire grève en plein pendant que les gens nous imaginent déjà faire du golf dans un chalet au ski, c’est vraiment donner des verges pour se faire battre. Et aussi et peut-être surtout parce que, au cas où vous ne l’auriez pas remarqué, je suis pas engagée, comme fille. Je raconte des histoires et je vis ma petite vie de petit nombril, et je fais pas dans la politique ou dans le syndicalisme. À tort probablement, mais c’est comme ça. Je vous dis les faits, je ne les défends pas. Les autres points de la réforme que le tiers-payant généralisé, même pas je les connais. Et j’ai tendance à fermer ma gueule quand je sais que je n’en sais pas assez.
Bref, pas assez engagée pour faire grève, et surtout pas à des dates qui nous font passer pour des guignols. J’assume pas.
2/ Point 2 : je suis super contre le tiers payant généralisé.
Pour des tonnes de raisons. Pas idéologiquement. Sur le principe, au départ, j’étais plutôt pour, je me suis dit pourquoi pas.
Basiquement, je suis contre la guerre et le sida, je suis pour la paix dans le monde, les câlins et les pauvres qui peuvent se soigner comme les riches.
Je ne trouve pas que mes patients déjà en tiers-payant (AME, CMU, accidents de travail, ALD à qui je fais le tiers payant etc) soient plus irrespectueux ou plus consommateurs de soins que les autres. Je propose volontiers le tiers-payant sur la part sécu à mes patients qui galèrent (mais pas suffisamment pour avoir la CMU), et dans ce cas ils avancent 6€90 s’ils sont pas en ALD ou 0€ s’ils sont en ALD. On appelle ça le tiers-payant « social » et c’est déjà possible de le faire, même si encore mal vu, découragé et remboursé à contrecœur par certaines caisses de sécu.
Bref, au début je me suis dit que si ça pouvait permettre aux quelques uns** qui sont sur la frontière pas-de-CMU-mais-c’est-quand-même-difficile-d’avancer-les-sous de se soigner et de venir me voir sans être freinés par des considérations financières, tant mieux. Je suis pas loin du point de vue de Dr Milie ici (même si je fais beaucoup moins de tiers-payant qu’elle au quotidien).
Et puis j’aimais bien aussi l’idée que ça permettrait de lisser un peu tout le monde, et que sans doute les patients bénéficiant de la CMU seraient moins mal traités et moins stigmatisés qu’ils ne le sont actuellement.
En partant de mon « pourquoi pas », j’ai commencé à imaginer ce que ça serait, et c’est là que j’ai commencé à flipper à cause des marques blanches sous mon string et du reste de ma peau toute brûlée, couche après couche.
>> Point 2/A : ça va être un bordel infâme.
- Point 2/Aa : ça va être un bordel infâme de commencer une consultation.
Parce que pour s’assurer qu’on a une chance d’être payé à la fin, comme je m’imagine les choses (j’espère avoir tort, mais je vois pas comment), il va falloir, à chaque consultation :
– qu’on vérifie si on est votre médecin traitant (ça a l’air facile, comme ça, à première vue. À première vue c’est facile aussi de demander à quelqu’un s’il a de la fièvre. En pratique il répond « Oui mais j’ai pas pris ma température » ou « Non j’ai pas de fièvre mais je suis fébrile » ou « Oui : j’ai eu mal à la tête » ou « Oui, j’avais le front le chaud » ou « Oui, 37,2 » ou « Oui, 37,2 mais pour moi c’est de la fièvre » ou « Oui j’en ai tous les jours depuis 6 ans » ou « Je sais pas » ou « Non enfin pas vraiment, seulement le soir ». Pour le médecin traitant c’est pareil. Les gens savent pas, ils pensent que c’est nous alors que non, ils pensent qu’ils en ont peut-être un mais ils savent plus qui c’est, ils assurent qu’ils sont suivis ici depuis toujours et que le Dr Carotte les suit depuis 20 ans alors que d’après le dossier on les a vus une fois en 2008, ils ont fait la déclaration mais ils savent pas s’ils l’ont envoyée, ou on les suit vraiment depuis 20 ans mais ils ont changé de médecin en douce sans oser nous le dire. Donc, va falloir vérifier d’une autre façon. En regardant sur le site de la sécu, par exemple, qui est en rade 2 jours sur 7 et dont les listes sont pas à jour 4 fois sur 10. Et même si on tombe sur un jour où ça marche et où la liste est à jour (allez, c’est Noël aujourd’hui), mine de rien c’est du TEMPS.
– qu’on vérifie si vous avez une complémentaire santé et laquelle (je vous la refais pas en long, mais c’est la même chose, hein. Les gens savent pas.)
– qu’on vérifie si les droits sont à jour sur votre carte vitale.
Si vous avez pas de carte vitale (ce qui arrive SOUVENT), je sais pas comment vérifier que vos droits sont à jour et je ne pense pas que l’attestation papier suffise.
Si vos droits sont pas à jour, si on est pas votre médecin traitant, si vous savez pas si vous avez une complémentaire, la consultation va commencer sur des discussions sur le paiement, sur ce qui restera à votre charge, sur pourquoi on est désolés mais va falloir payer.
J’ai pas ENVIE de commencer mes consultations comme ça. J’ai envie de commencer mes consultations en prenant des nouvelles de la cheville, ou de la petite-fille, ou de la vie en général. J’ai pas envie de commencer par des problèmes de flicage administratif et de pognon.
Et déjà que j’ai bien du mal à faire tenir les 2, 3, 4, 7 motifs de consultation en 20 minutes, j’ai pas le temps à consacrer à ça non plus.
Ni l’envie, ni le temps.
- Point 2/Ab : ça va être un bordel infâme de courir après les remboursements des parts complémentaires.
Y a genre 400 complémentaires différentes. Déjà qu’en l’état actuel des choses, c’est un bon bordel de gérer les problèmes de remboursement avec la sécu, j’ose vraiment, vraiment, vraiment pas imaginer quand il faudra gérer les problèmes de remboursement avec 400 interlocuteurs.
Grosso modo, actuellement, je sais pas comment font les autres cabinets, mais chez Carotte on s’assoit dessus. Il a environ un tiers d’impayés sur ses tiers payants, et il préfère les compter en perte sèche que se péter le cul à courir après.
Là, je sais pas. J’imagine qu’il faudra qu’on ait une liste quelque part dans un tiroir des 400 complémentaires, avec l’adresse et les numéros de téléphone.
Qu’il faudra vérifier, consult après consult, si on a bien été payés ou non. Pointer. Attendre un peu au cas où, re pointer. Quand vraiment on n’aura pas été payés, aller chercher le nom de la mutuelle du patient, écrire, ou appeler. Se cogner 10 minutes de Quatre saisons de Vivaldi pour avoir le mauvais interlocuteur, recommencer, et vous connaissez la suite, vous avez tous vécu ça, je ne vous fais pas l’affront de développer.
Les pharmaciens, ils engagent quelqu’un pour ne faire que ça. Une amie sur Twitter disait grosso modo 20 heures par semaine pour 75 ordonnances par jour.
Nous, je sais pas comment on va faire. J’imagine que certains médecins bosseront plus, j’imagine que d’autres recevront moins de patients, j’imagine enfin que certains (proches de la retraite par exemple) préféreront déplaquer.
Plus de temps administratif, ça n’a en tout cas jamais débouché sur plus de soins, ni sur de meilleurs soins pour les patients.
Rien que pour le point 2/A, rien qu’avec ça, même si c’était que ça, je serais déjà contre le TP généralisé.
Parce que j’ai trop peur que la qualité de soin et le temps de soin en pâtisse.
Parce que Marisol Touraine a beau jurer que pas du tout, que ce sera simple avec un interlocuteur unique, je demande sincèrement à voir. Ce n’est encore le cas pour personne, pas pour les pharmaciens, pas pour les cabinets de radio, pas pour les centres de santé, j’ai bien du mal à imaginer que ça deviendrait rose et facile du jour au lendemain. Quand on voit à quel point tout est compliqué, à quel point rien ne marche déjà actuellement, à quel point on passe du temps à réparer des erreurs ou refaire des choses qui sont censées se passer bien / automatiquement / facilement, je ne crois pas un quart de seconde qu’une révolution de cette ampleur puisse se passer facilement. Je suis la naïveté même, mais j’ai des limites.
Déjà, si on avait proposé « Tiers-payant généralisé sur la part sécu », ça aurait été une belle avancée sociale, les gens auraient avancé moins cher, j’aurais réfléchi différemment et peut-être (peut-être ?) été d’accord.
>> Point 2/B : la dépendance directe aux complémentaires, acte I
Prenons mon patient Monsieur Martin qui a une complémentaire santé merdique (je ne sais pas, moi, imaginons une complémentaire qui marcherait aussi bien que la LMDE par exemple) qui paye en retard ou mal ou pas du tout, qui est injoignable, qui donne trois réponses différentes les trois fois où on appelle pour pointer un problème.
(Petit retour au point 2/Ab : jusque là, déjà, c’est M. Martin qui se fade les coups de fil et les courriers recommandés. Je suis désolée pour M. Martin, mais je suis quand même bien contente que ce soit lui et pas moi. Parce que multiplié par le nombre de patients, je ne veux pas imaginer que ce soit moi.)
Quand M. Martin en aura vraiment marre, il peut menacer. Taper du poing sur la table, et menacer de changer de complémentaire. Puis, le cas échéant, changer vraiment de complémentaire, quand il sera suffisamment en colère pour se cogner les démarches administratives que ça implique.
Si c’est moi que la complémentaire paye en retard ou mal ou pas du tout, je fais quoi ? Je demande gentiment à M. Martin de changer de complémentaire ? Je le supplie ? Je le menace ? J’affiche dans ma salle d’attente : « Désolée, mais nous ne recevrons plus les patients adhérents à la complémentaire des jonquilles en fleur, sauf s’ils nous honorent la part complémentaire, parce que les jonquilles en fleur c’est rien qu’un tas d’empaffés. » ?
>> Point 2/C : l’inflation des dépenses de santé
Je ne crois pas être d’accord avec mes (nombreux) confrères qui disent que proposer des soins (apparemment) gratuits va conduire à une explosion de la consommation de soins. Comme je l’ai dit plus haut, « mes » patients CMU ou ALD-TP ne sont pas plus consommateurs de soins que les autres. Pas plus irrespectueux, pas plus demandeurs.
Certains le sont, évidemment, mais dans les mêmes proportions que ceux qui ne sont pas en tiers-payant***.
Je me plais à croire que tout est au moins en partie question d’éducation (même si j’abhorre ce terme, je n’en ai pas de meilleur sous la main) et que le fait d’être capable ou pas de comprendre qu’il est inutile de consulter dans certains cas dépend de la façon dont on l’explique et de sa capacité à l’entendre, sans rapport avec son compte en banque ou le fait de ne pas avancer l’argent.
(Cela dit, et même si je déteste cette idée et que j’aimerais vraiment avoir raison, l’honnêteté me pousse à dire que ok, peut-être que les gens ne sont pas plus consommateurs de soins parce qu’ils ont conscience d’être traités de façon exceptionnelle, qu’ils savent pertinemment qu’une consultation ça coûte 23€ même si pas pour eux. PEUT-ÊTRE que dans un système de tiers-payant complet, généralisé, les gens vont finir par l’oublier et que ça va influencer leurs demandes. Je ne le crois pas. Je dis juste que je sais que mon contre-argument « Mais heu c’est pas vrai, mes patients à moi y sont gentils et pas excessifs » n’est pas suffisant et un peu bancal.)
Bref : TPG = sur-consommation de soin, je n’y crois pas, ou je refuse d’y croire, ou je me bagarrerai contre.
Par contre, très clairement, je suis d’accord avec ceux qui disent que ça va entraîner une sur-facturation des soins. Ou plutôt que ça va nous faire arrêter de sous-facturer.
Actuellement, et je sais que je ne suis pas la seule, je sous-facture clairement. Je fais plein d’actes gratuits. Des vaccins, des papiers-pas-compliqués-qui-ne-nécessitent-pas-de-consultation, des consultations à plusieurs. C’est complètement débile parce que je ne suis pas marchande de légumes (2 certificats médicaux achetés 1 gratuit), mais ça se passe quand même comme ça en vrai.
Parce que je me sens parfois un peu honteuse de demander 69€ (surtout à une famille pour qui je sais que ce n’est pas rien) pour une consultation triple qui honnêtement a été plutôt reposante pour mes neurones. Je SAIS que c’est censé venir en compensation de toutes les fois où j’ai fait payer 23€ pour une consultation longue, et compliquée, et fatigante. Je SAIS que si je vous fais payer 23€ pour une injection de 30 secondes, c’est aussi que je vous ferai payer 23€ pour une dépression de 55 minutes.
Je sais que c’est presque anti-éthique d’être parfois contente de « faire une fleur » à un patient, et d’être contente qu’il me trouve gentille, parce que ça a un côté patientéliste qui ne devrait pas avoir sa place dans une relation de soin, mais toujours est-il que ça me fait parfois plaisir quand même.
Et mes lapins, autant vous dire que faire des fleurs à la sécu ou être gênée de demander le prix réel de ma consultation à mon ordinateur, même pas en rêve. (Et oui, bien sûr je sais bien que quand je fais « un cadeau » à un patient, en définitive et par ricochet c’est à la sécu que je le fais, mais entre ce qu’on sait dans sa tête et ce qu’on ressent dans son ventre avec quelqu’un en face, y a comme un monde.)
Je ne vais évidemment pas faire d’actes fictifs, évidemment pas sur-facturer, mais il est certain aussi que je ne ferai plus de cadeaux et que je n’aurai plus de scrupules idiots. Et que ça va se chiffrer.
(Ce point-là rejoint en miroir un peu, sans doute, ceux qui militent pour le côté symbolique du paiement. Qui pensent que ça a un sens, un intérêt dans la relation de soin.
Que déconnecter les patients de cet échange là n’est pas innocent. Que non, ce n’est pas « pareil » de payer son médecin puis de se faire rembourser que de ne pas payer du tout.
Je ne dis pas que c’est mon point de vue, hein. Honnêtement je n’en sais rien, je n’ai pas réfléchi jusque là, mais ce serait sans doute intéressant d’y penser. C’est juste que ça illustre bien que même si sur le papier, ce sont les mêmes sous qui viennent des mêmes poches au final, nous se sommes pas en papier et les apparences ont beau n’être que des apparences, elles ont des répercussions concrètes.)
>> Point 2/D : l’inflation des dépenses de ma poche
Oui, parce que, en n’étant pas spécialement du côté de ceux qui se plaignent des sous, et en trouvant que je gagne super bien ma vie, et en ne voulant pas spécialement en réclamer plus, j’ai quand même pas honte d’avouer que comme tout un chacun, j’aime autant quand on ne m’en enlève pas.
Et le bordel décrit dans les points précédents, le temps passé à faire des démarches administratives, les enveloppes et les timbres et les coups de fils, et surtout les très nombreux probables impayés, ça a un coût. Et ce coût, pour l’instant, il est de la poche des médecins.
J’ai lu des tas de chiffres, mais grosso modo tout le monde s’accorde à l’estimer entre 1 et 4€ par acte.
Travailler plus pour gagner moins.
Remarquez, en tant que remplaçante, je m’en cognerais presque. Je fais une consultation à 23€, le Dr Carotte m’en reverse 17€25 de sa poche À LUI, et derrière, c’est lui qui est pas remboursé. Double peine. Mouahahah.
Enfin bon, ricanera bien qui ricanera le dernier, ça finira bien par être ma poche à moi d’une façon ou d’une autre. Et puis j’aime plutôt bien le Dr Carotte et je souhaite plutôt pas trop de mal à sa poche à lui, et j’ai pas tellement envie de la vider et d’être payée d’elle.
>> Point 2/E La dépendance directe aux complémentaires, acte II
Il est pas encore écrit, l’acte II. Il est pas sur le papier de loi. Sur le papier de loi, pour le moment, y a que le joli côté social et gentil et d’égalité d’accès aux soins.
Il est pas encore écrit, mais il me terrifie et j’ai beau être la même naïveté-même que quelques lignes plus haut, je suis intimement convaincue qu’il est déjà en train de prendre forme sous des plumes en coulisse.
D’abord, y a plein de gens qui disent qu’une fois que les dépenses de santé seront camouflées, opacifiées derrière le tiers-payant, une fois que les gens auront l’impression de ne pas payer le médecin, ce sera beaucoup plus facile de manipuler tout ça, et de, en douce, baisser la part de la sécu, monter la part des complémentaires et privatiser l’assurance maladie à bas-bruit. Pas mal de gens en ont parlé mieux que moi (un médecin ici, une pas-médecin mais qui a tout compris là) et ce point-là m’ennuie un peu, je ne développerai pas plus.
Non, le truc qui me terrifie, c’est qu’à la fin les complémentaires me disent quoi prescrire et quels soins donner à mes patients. C’est ça, mon angoisse.
On glisse vers ça, déjà, un peu. Avec les histoires de ROSP, la sécu me donne déjà des bons points (et des sous, hein, soyons clairs) si je prescris bien comme elle m’a dit de prescrire. Y a des jolis points avec lesquels je suis d’accord, et y a des points avec lesquels je suis pas d’accord du tout, qui ne sont pas de la bonne médecine. Et quand bien même je serais d’accord sur tous les points, sur le principe, obéir au financeur de mes prescriptions pour savoir ce que je prescris, y a quand même comme un conflit d’intérêt qui me gène aux entournures.
On commence aussi à avoir des complémentaires qui vous remboursent mieux si vous allez voir l’opticien ou le dentiste qu’elles ont choisi pour vous.
Dans mon cauchemar prévisionnel, un peu plus haut, y avait M. Martin dont la complémentaire refusait de me payer, et contre laquelle je ne pouvais rien faire.
Dans mon cauchemar au carré, y a la complémentaire de M. Martin qui m’écrit pour me dire qu’elle ne remboursera les consultations spécialisées de M. Martin que si je l’adresse à un des spécialistes experts et qualifiés présents sur la liste ci-jointe. Et puis quelques mois plus tard pour me dire qu’elle ne remboursera plus les princeps, que je si je veux que M. Martin soit remboursé de ses médicaments j’ai qu’à y prescrire des génériques. Puis deux mois encore après que si je veux que JE sois remboursée de la consultation j’ai qu’à y prescrire des génériques.
Six mois plus tard, la mutuelle de M. Martin me dira qu’elle est au regret de m’annoncer qu’elle ne peut pas prendre en charge le bilan biologique de M. Martin à qui j’ai prescrit une hémoglobine glyquée alors qu’il en a déjà eu quatre dans l’année, et que la HAS elle dit quatre Hémoglobines glyquées par an et pas cinq.
Deux ans plus tard, la mutuelle de M. Martin pourra aussi me dire par exemple qu’elle travaille en partenariat serré avec le laboratoire MonGrosComprimé, et que quand un équivalent existe de cette marque-là, pour le bon remboursement et des soins optimaux de mon patient et sa santé qui lui tient si cher à coeur, elle sera au regret de ne pas me rembourser si je prescris un laboratoire concurrent. Et que d’ailleurs, l’IRM cérébrale était-elle bien nécessaire alors qu’un scanner aurait suffi ?
Donner tant de pouvoir aux financeurs, donner un pouvoir direct et sans intermédiaires ni transparence à ceux pour qui la santé est une question d’argent ne peut pas être raisonnable. Dans aucun monde, en aucune façon, jamais. C’est forcément une connerie.
Prophétie, fantasmes, diront certains.
Mais nous y sommes déjà. La pente est toute faible. On fait des tout petits pas, on met l’eau à chauffer tout doucement.
Et moi j’ai la frousse.
** Pas si nombreux, quand même. Pas autant en tout cas que ce qu’on voudrait nous faire croire en brandissant le côté révolution sociale de la réforme.
La majorité des difficultés d’accès de soin concernent les soins d’optique et dentaires, pour qui le TPG ne va strictement rien changer.
Il y a des patients qui sont « trop riches » pour avoir la CMU, de qui le médecin traitant est trop con pour proposer un tiers-payant social, ou à qui le médecin le propose mais qui n’osent pas l’accepter. Évidemment ils existent, et évidemment ce serait un progrès indéniable de les aider. Mais ils sont moins nombreux que ce que Marisol beugle.
***Mention spéciale à pas-mon patient de l’autre jour qui a rappelé le lendemain de la consultation pour dire qu’il était toujours pas guéri de son rhume et que c’était un scandale de payer 23€ une consultation si c’était pour lui prescrire des trucs même pas remboursés qu’il aurait pu s’acheter lui-même à la pharmacie et qui demandait que je lui rende ses sous.
E-A-U
8 février, 2014
Dans mes révélations médicales, il y a eu la fois où j’ai réalisé que les yeux se croisaient à l’intérieur de la tête, la fois où j’ai réalisé que je voulais être généraliste, et la fois où ma mère m’a dit « Moi, quand je m’endors pendant une consultation, je me méfie. C’est souvent qu’il y a une histoire de violence. »
Ouais, je sais, ça fait mystique, hein ?
Pardon Maman de déformer tes propos, et d’en extraire un tout petit bout racoleur pour appâter le lecteur.
Il se trouve que ça a été mon e-a-u d’Helen Keller à moi. La phrase qui m’a ouverte à la compréhension de tout un tas de trucs enfouis, que je sentais confusément mais sans avoir jamais réussi à mettre le doigt dessus : des fois, pendant une consultation (ou ailleurs, mais là on cause de consultation), notre bide nous parle.
Et ce que notre bide nous dit, c’est pas seulement un machin gênant à faire taire pour mieux se concentrer sur le patient.
Ce que notre bide nous dit, c’est un symptôme. Et parfois un symptôme important.
Le contre-transfert, c’est pas « Ouais des fois j’aime pas un patient relou, c’est rien qu’un con, ahlala je fais un contre-transfert faut que j’arrive à lutter contre. »
Le contre-transfert, c’est tout ce que vous dit votre bide sans passer par la case de votre tête. Et avec lequel il faut composer. Pour le faire taire parfois (pas souvent), mais aussi pour l’écouter, pour l’intégrer au reste, pour en faire un outil diagnostique ou un outil thérapeutique. Le contre-transfert est ton meilleur ami.
(Bon après c’est moi qui appelle ça contre-transfert, hein. C’est mon contre-transfert à moi que j’ai, je suis désolée pour les gens qui s’y connaissent mieux que moi et qui vont hurler. J’ai collé ce mot-là sur ce concept-là, je ne jure de rien. Sinon je l’appelle aussi l’alarme bidale, ça fait moins frimeur.)
Comme ça m’a changé la vie, je vais essayer de vous raconter un peu comment. Au cas où ça changerait la vôtre un peu aussi.
Comme c’est très compliqué et encore fameusement obscur pour moi, ça va être le bordel.
Mais merde, j’ai l’impression d’avoir découvert le feu, je dois partager.
L’alarme bidale, donc, c’est la version plus large de ce que j’avais appelé ailleurs le signal d’alarme. Le signal d’alarme c’est rien qu’une sous-classe d’alarme bidale, quand ton bide te crie « Run, you fool ».
Parce qu’il y a plein d’alarmes bidales différentes.
Alors après tout le boulot c’est de réussir, en quatre étapes successives de maîtrise de l’alarme bidale, à l’entendre, à l’écouter, à la comprendre, à en faire quelque chose. (Ce truc très moche synthétisé qu’on dirait une marguerite des compétences de mes couilles, il est de moi, hein, pas de ma mère. Je dis ça pour son honneur.)
L’entendre, c’est super fastoche, c’est juste laisser une petite place dans sa tête pour formuler la phrase « Tiens, y se passe quelque chose dans mon bide ».
Mais bon déjà, faut ménager la place. Pas forcément si évident quand « Dieu du ciel, c’est quoi déjà l’antibio pour les parotidites, et d’ailleurs, qu’est-ce qu’une parotidite ? » est en train de prendre tout l’espace alloué.
Mais juste déjà, entendre.
« Bide, Bide, roger. Demandons autorisation de parler à Tête. »
Ensuite, écouter. Ok, il se passe un truc dans mon bide, qu’est-ce que c’est ?
Et prenons un exemple fastoche pour commencer, genre : « Tiens, je suis en train de me mettre en colère » .
Ça l’air tout con comme ça à première vue (mais c’est plein de bonnes choses qu’on peut pas comprendre, nous, humains), mais de passer du machin qui bouillonne au creux du ventre, du malaise obscur et de la tension dans les muscles à la phrase dans le cerveau à soi-même « Tiens, je suis en train de me mettre en colère » , c’est déjà un bout de chemin.
Si on veut pousser un peu, amusons-nous :
– Pourquoi est-ce que je suis en colère ? À quel moment ça a commencé ?
– Ah bah tiens, ça a commencé quand elle a dit « Et puis d’ailleurs en ce moment j’ai du mal à dormir » .
– Bon. Est-ce un motif valable de colère que ton patient n’arrive pas à dormir ?
– Nan.
– Pourquoi ça te met en colère, alors ?
– PARCE QU’ELLE ME DIT ÇA À FIN DE CONSULTATION MOINS CINQ ET QUE C’EST LA QUATRIÈME DE SUITE CE MATIN ET QUE J’EN PEUX PLUS DES INSOMNIES DE SEUIL DE PUTAIN DE SA RACE !
Bravo, vous venez de franchir l’étape pas si facile que ça de comprenage de l’alarme bidale.
Essayons maintenant d’en faire quelque chose.
– Ok, donc on est d’accord que ton patient, là, c’est pas sa faute ? Il a juste fait la même chose (pas répréhensible) que tes trois patients d’avant, et juste t’as plus la patience pour re-partir dans la problématique des troubles du sommeil qui débarquent en fin de consult, c’est bien ça ?
– Ouais, c’est ça. Enfant de sa mère, merde, je suis fatiguée, je veux une gastro !
– Ok. Alors. Tu te souviens dans quelle disposition d’esprit tu étais pour le premier patient ? Ouais ? C’était facile, nan ? T’as fait une belle consult qui t’a fait plaisir, non ? Bon bah alors tu me calmes ce bide, tu te remets dans la disposition de patient -4 et tu recommences.
– Mais j’ai pas le teeeeeeeeeeeeeemps !
– Nan, c’est pas vrai. Ça va te prendre autant de temps de t’énerver et de bougonner et de râler que de faire un truc bien. Et puis le temps c’est pas grave. Tu l’as fait pour patient n-4, y a pas de raison que tu le fasses pas maintenant.
– Ouais, bon, ok, c’est vrai. C’est pas sa faute.
Et là, soudain, en vrai, vous sentez un truc qui se passe dans votre ventre.
Comme si on avait retiré la bonde de la baignoire. Vous étiez folle de colère et d’impatience, et ça fait brrrrlbrllllbrrrrrl et vous sentez physiquement la fatigue et la colère quitter votre bide. Et vous re-aimez votre patient. Et c’est pas sa faute. Et vous faites votre boulot d’insomnie de fin consult, facilement, sans angoisse et en étant fière de vous.
Jvous jure que ça marche comme ça.
Je fais un aparté dans ce futur-trop-long-post pour vous raconter un autre truc, qui découle du dernier, et dont j’avais prévu de faire un billet à part entière. Ça fera un vraiment trop long billet à la fin, mais tant pis.
Est-ce que vous le voyez, ce patient de 87 ans qui reboutonne sa chemise en 17 minutes en fin de consultation alors que votre salle d’attente est bondée ? Qui se lèche le doigt pendant 38 secondes pour réussir à détacher le chèque en 57 ?
Qui a rangé sa carte vitale, mais qui se demande s’il l’a bien rangée, qui croit que vous ne lui avez pas rendue, alors qui vous demande « Vous m’avez rendu ma carte vitale ? » et à qui vous dites que oui, vous venez de lui rendre il y a 30 secondes, et qui ressort son portefeuille de la troisième poche intérieure de sa veste, en ayant d’abord essayé les deux premières, et qui ouvre son portefeuille avec une lenteur indécente pour constater que oui, la carte verte est là, et qui essaie de ranger son portefeuille dans la deuxième poche sauf que c’est là où il a déjà rangé l’ordonnance, alors il se demande ce que c’est que ce papier et il ressort l’ordonnance et il la déplie lentement et il dit « Ah, c’est l’ordonnance ! » et il la range dans la deuxième poche puis il re-range son portefeuille dans la troisième et vous avez JUSTE ENVIE DE MOURIR ?
Vous le voyez ? Vous le sentez votre ventre qui bouillonne ?
Alors moi, j’ai trouvé un truc imparable.
Quand je me sens comme ça, à trépigner sur ces deux minutes perdues (deux minutes, sur une consultation de vingt, bon…), j’invoque ma grand-mère. J’essaie pas de me raisonner à coups d’arguments (ça marche pas), j’essaie pas de me dire « Sois patiente, il est vieux, c’est pas sa faute, c’est juste deux minutes sur une consultation de vingt. »
J’invoque ma grand-mère, je regarde son visage et je pense à elle.
Et la bonde s’ouvre. En un visage, plus puissant que tous les arguments du monde. Je SENS dans mon ventre la patience que j’aurais voulu que tous les soignants du monde aient eue pour elle, je me sens me remplir de toute la douceur qu’elle méritait, et je ne suis plus en colère, et les deux minutes passent en un moment fugace, joli et gnangnan d’apaisement.
Je ne suis pas en train de dire que je me raisonne en me disant « Et si c’était ta grand-mère, hein, connasse !?? ».
Nan, juste je pense à elle, avec mon bide. Et ça putain de marche.
Fin de l’aparté.
Voilà pour le niveau 1 de l’alarme bidale. La bête maîtrise d’un sentiment inopportun. C’est du ras-des-pâquerettes, mais dieu du ciel, ça permet déjà d’économiser une énergie folle. Et rien que pour ça ça vaut le coup.
Des fois (souvent), c’est plus compliqué que ça.
Des fois, je sens qu’il se passe un truc dans mon bide, je l’entends, je l’écoute, mais je ne comprends pas pourquoi.
Alors je le range dans un tiroir. « Cette fois-là, ton bide a dit tel truc. Ça reste un mystère, consigne-le, on verra plus tard. »
Et du coup, des fois, après, ça m’aide à poser un diagnostic. Parce que je me suis rendu compte, à force d’écouter, que ça sonnait toujours pareil face aux mêmes patients.
C’est pas systématique, c’est pas exclusif ; ça ne suffit pas, évidemment.
C’est juste un symptôme de plus, sauf qu’au lieu de venir de la bouche du patient, il vient de la bouche de mon bide.
C’est juste, heu… une espèce de vague, un roulis dans le ventre, qui reste bloqué quelque part juste avant la limite de la conscience.
Par exemple, quand j’ai l’impression que j’assiste à la consultation de l’extérieur, comme si j’avais une boîte de pop-corn et que j’étais derrière moi-même, avec mes pop-corn, en train d’écouter la patiente parler, bin je sais que ça me fait ça avec mes quatre patientes bipolaires, alors ça me donne l’idée de chercher un peu dans ce sens-là. Je ne l’explique pas. Je n’explique pas plus le coup du « pop-corn > bipolaire » que le coup du « somnolence > violence », mais c’est comme ça.
Un symptôme en plus dans la liste. Des fois c’était ça, des fois non, comme pour n’importe quel symptôme. Je ne sais pas du tout d’où ça sort, ni expliquer pourquoi ce sentiment-là, mais c’est juste que c’est comme ça, et ça me donne un élément de plus.
« Tiens, ce patient me met dans le même état bidal que M Hypo et Mme Hyper qui sont bipolaires, c’est peut-être un indice. »
Et j’ai un autre exemple (ouais).
Plusieurs fois, j’ai eu le ventre qui bouillonne et surtout l’impression de grimper une échelle. (Je ne peux pas vous l’expliquer mieux que ça, mais j’ai cette image d’échelle à chaque fois.)
Et j’ai vu l’agressivité monter, et je me suis entendue dire des trucs de médecin paternaliste, de « C’est quand même moi qui sais », de « Vas-y, c’est quiquafait dix ans d’études entre toi et moi ? ».
J’ai entendu ma voix prendre un ton pincé, monter d’une octave, dire un truc faussement arrangeant dans un degré mal défini mais bien au-delà du premier, du genre « Oui, voyons ça », avec un ton de mégère et à moitié l’envie de me baffer et mon ventre qui criait « Nooooon arrêêêêête ! C’est piiiiire » alors qu’un autre bout de neurone criait « Jm’en fooooous ! Sale coooooon ! »
Avec le recul, j’ai repensé à toutes ces consultations-là.
Et c’était toujours un mec d’une cinquantaine d’années (parfois une femme, mais plus rarement), qui m’avait prise un peu de haut, qui avait dit des trucs un peu sur tel fil, qui avait une attitude un peu comme…
Et en fait qui me méprisait.
J’ai pu mettre le doigt dessus : les gens qui me font monter sur l’échelle, c’est les gens qui me méprisent.
Du coup, maintenant, j’arrive à faire redescendre le truc.
Je vois l’échelle, je me vois grimper dessus, et j’arrive à dire quelque chose.
Quelque chose d’un peu pourri, d’un peu bancal, du genre : « Bon, j’ai l’impression qu’il y a un problème de confiance », et que j’adapte en fonction. « Peut-être que ce serait mieux si vous reparliez de ça avec le Dr Carotte », « Peut-être qu’il y a un problème dont vous ne m’avez pas parlé ? », bref, toujours est-il que maintenant je mets le doigt dessus et j’arrive d’une façon ou d’une autre à redescendre de l’échelle au lieu de continuer à grimper de barreau en barreau et d’octave en octave vers un échec prédit d’avance.
Ça reste bordélique, ça reste brouillon mais je sais que je suis sur le chemin. Après, on affine.
On essaie de repérer mieux quel sentiment, à quel moment, pourquoi, sur quelle phrase. On essaie de faire un lien plus précis entre les choses que mes flous « Je sais pas pourquoi mais devant telle situation mon bide dit tel truc ».
Je n’en suis pas encore là.
Je pense que les gens qui savent, qui ont été formés pour (c’est-à-dire ceux qui n’ont pas fait d’études de médecine), ont un contrôle vachement plus fin de l’alarme bidale que moi.
Mais putain, ça m’aide. Au jour le jour.
Dans nos études, moi, j’ai plutôt le souvenir qu’on nous apprend à étouffer notre bide. On nous apprend qu’il est parasite, qu’il faut le faire taire, qu’il faut se boucher les oreilles en disant lalalalalaj’entendspasj’entendspasj’entendsquemonpatient.
C’est pas vrai. Ce qu’il faut étouffer, c’est de réagir cortico-sous-corticalement à notre bide.
Votre bide est votre meilleur ami. En vrai.
Écoutez-le, il a des choses à vous dire.
À nous deux, nous ferons un bon médecin.
6 octobre, 2013
Cher toi,
Avant de te raconter (avant de te raconter toi, j’entends ; pas « avant de te raconter un truc »), et avant de te dire merci, je vais te raconter l’histoire de ma dernière annonce d’Hépatite B.
Histoire que tu réalises un peu le contexte.
Donc, ma dernière annonce d’Hépatite B.
J’avais eu ce type au téléphone, entre deux consults d’une journée éprouvante dont je ne me souviens plus. Je sais juste que j’étais fatiguée, pressée, et en retard. J’avais eu ce mec, je l’avais laissé me lire ses résultats par téléphone (ce que j’essaie d’éviter habituellement. Parce que les « Je veux juste savoir ce que ça veut dire -Sérologie HIV positive- » par téléphone, c’est un tout petit peu difficile à gérer…) (du coup, et je fais une parenthèse, imagine bien ce que ça implique au quotidien. Tu as une personne angoissée au bout du fil, qui, pour elle, appelle « juste » pour un renseignement. Elle veut juste te lire deux phrases de sa prise de sang au téléphone pour que tu lui dises que ce n’est rien. Et, en l’occurrence, 99,5% du temps, ce n’est rien, et tu pourrais très bien prendre 30 secondes, écouter deux lignes, comprendre que ce n’est rien, dire « Ce n’est rien », avoir été thérapeutique et miraculeuse en moins de temps qu’il n’en faut pour dire « Ce n’est rien », et avoir rendu un service énorme à quelqu’un. Sauf que tu penses aux 0,5%. Tu penses à ce qu’il faudrait dire, là, au téléphone, si quelqu’un te demande « Qu’est ce que ça veut dire un lâcher de ballons, docteur ? » ou « Qu’est ce que ça veut dire « Sérologie HIV positive » ? ». Tu penses à ce que tu pourrais bafouiller, à ton ânonnage de « C’est dur à dire au téléphone, il faut que vous veniez pour qu’on en discute face à face », à ce que ça pourrait être de semi-annonce maladroite et pourrie. Tu penses que c’est comme quand ton amoureux t’as dit au téléphone « Tu vas me quitter ? » et que oui, putain, tu allais le quitter, mais que non, tu pouvais pas dire ça là, pas comme ça, pas maintenant, pas au téléphone. Bref, c’est à ça que je pense tout le temps quand je refuse de « juste regarder » dans la salle d’attente ou « juste dire » entre deux téléphones. C’est ce à quoi je pensais quand ce type la semaine dernière est parti du cabinet en claquant la porte et en hurlant que les assistantes du Dr Carotte, c’était que des bonnes à rien, et qu’il voulait juste qu’on prenne 2 minutes pour lui dire les résultats de son test du sida. Hey, parce que si c’est positif, mon bonhomme, tu veux vraiment que je te le dise là maintenant, dans ma salle d’attente, entre une mère et son gamin fébrile et une femme avec un panaris ?
Donc non, non, ce n’est jamais facile de « juste jeter un œil ». Ne nous demandez pas de faire ça.)
Bref, disais-je, pardon. Je t’annonçais ma dernière annonce d’hépatite B à ce type que j’avais laissé me piéger au téléphone.
Il m’a dit des trucs, des anticorps anti truc, des antigènes anti machin, des trucs que oui, pardon, après 14 ans de médecine je ne suis toujours pas capable de piger facilement au premier jet sans avoir une antisèche magique que j’aime d’amour sous les yeux. Ça ressemblait quand même furieusement à une vaccination, avec des « Acéhantihachebéhesse positifs », et j’avais dit doctement « C’est rien, c’est que vous êtes vacciné, c’est positif parce que ça veut dire que vous avez des défenses immunitaires contre la maladie, vous êtes juste vacciné, vous êtes protégé, tout va bien. »
Et puis il était venu en consultation, pour autre chose, pour revoir son traitement. À la minute où il était entré, j’ai eu envie d’ouvrir les fenêtres. Ça me fait toujours ça quand les gens portent trop d’angoisse. Ils n’ont pas encore ouvert la bouche que j’ai envie d’ouvrir les fenêtres, de ventiler ma main devant mon visage, pour faire sortir l’angoisse qui distille dans la pièce comme un nuage de poison vert invisible d’une arme chimique d’une guerre oubliée. Plus contagieux que l’Hépatite B, il y a l’angoisse.
J’ai re-regardé ses résultats, avec une main de vapeur impalpable qui me serrait la gorge, et j’ai lu « Ag HbS positif ». J’ai blêmi. J’ai relu. J’ai passé ma main droite sur les commissures de mes lèvres, et j’ai rerelu. « Ag HbS positifs ». Je me suis mise à bafouiller. Que oui, bon, certes, j’avais dit un truc au téléphone l’autre jour, mais que je m’étais trompée, que là c’était différent, qu’il y avait effectivement une Hépatite B dans la cour de jeu. J’ai bafouillé des trucs horriblement, sur des examens complémentaires à faire, sur une lettre pour un spécialiste, sur que des fois c’est grave mais des fois c’est pas grave l’Hépatite B.
Et il venait pour revoir un traitement pour son angoisse, traitement qu’il prenait trop, mal, et qui ne va pas du tout avec une Hépatite B. Nous avons donc passé beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup de temps à essayer de bidouiller un traitement pour son angoisse (qui, ô surprise, n’allait pas mieux devant le diagnostic d’Hépatite B) et qui ne serait pas trop trop contre-indiqué au vue des nouvelles pièces au dossier.
Cette consultation a duré une heure, dont 45 minutes de mauvaiseté. J’ai été mauvaise du début à la fin. Pétrifiée d’angoisse, de ma très vague connaissance du sujet (« Alors l’Hépatite B, en fait, comment vous dire, des fois c’est très très grave mais plus souvent pas du tout, mais des fois si, quand même, et je peux pas trop vous dire pour vous ») et de la consternation d’avoir dit n’importe quoi au téléphone.
Et puis il était parti. Et puis j’avais fini ma matinée de consultation. Mal. Vraiment très mal, à moitié absente, à moitié en colère. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous venez me saouler ce matin précisément pour votre truc à la noix. C’est pour me faire chier, c’est ça ? Vous avez fait exprès de venir me mettre mal exactement ce matin ? Alors que vous ne voyez pas que j’ai eu un patient avec une Hépatite B tout à l’heure et que j’ai merdé ?
Et puis j’avais relu ses résultats, après le départ du dernier patient.
Qui disaient Ag HbS négatifs. Ac anti HbS positifs.
Qui disaient qu’il était vacciné.
Je ne sais pas comment j’avais pu me tromper à ce point. Merci l’angoisse, sans doute.
La fille qui annonce que ce n’est rien par téléphone, puis qui annonce que c’est horrible de vive-voix et qu’elle s’est trompée, puis qui ré-appelle pour dire « Ahah, vous allez rire, mais en fait, j’avais raison la première fois ! », cherchez pas, c’est ma pomme.
Donc, mon très cher, voilà comment tu peux imaginer que je me sens maintenant devant des résultats d’Hépatite B.
Bref, tu étais dans ma salle d’attente ce matin.
« J’ai pas rendez-vous, tu m’as dit, mais le docteur m’a appelé pour dire de venir avec mes examens, et j’ai pas dormi de la nuit. »
J’ai été contrariée que tu n’aies pas rendez-vous. Je t’ai pris un peu de haut. Non monsieur, un rendez-vous c’est un rendez-vous et on voit pas des gens sans rendez-vous entre des gens avec rendez-vous parce que sinon à quoi ça sert que les gens qui aient pris rendez-vous aient pris rendez-vous ? Et puis quand même, deep deep down, quelque chose en moi a remarqué la feuille toute froissée de résultats biologiques que tu serrais dans tes mains. Froissée comme par une nuit d’angoisse. Je t’ai dit d’attendre, que je te prendrai tout à l’heure, qu’il fallait qu’on se prenne le temps d’une vraie consultation et que j’allais te voir après.
Tu es revenu à l’heure dite, avant l’heure dite, même, avec tes cernes et ta feuille froissée.
Qui annonçait une Hépatite B positive.
Je vais avoir du mal à raconter le mélange d’angoisse et de dignité que tu portais.
Tu étais bourré d’angoisse, mais bizarrement je n’ai pas eu envie d’ouvrir les fenêtres. J’ai eu juste envie de te serrer dans mes bras. There-there.
Avec les leçons que j’avais prises depuis mon dernier fiasco, et surtout avec la note dans le dossier du Dr Cerise (qui t’avait effectivement dit de venir avec tes examens) qui annonçait en lettres noires « Hépatite B active et CONTAGIEUX », je n’ai pas eu besoin de mon antisèche magique.
C’est avec ton angoisse que tu étais revenu 20 minutes en avance, c’est avec ton angoisse que tu continuais à tordre cette feuille entre tes mains, et c’est avec ta dignité que tu m’as dit que tu venais d’enterrer ta sœur. De 24 ans. Morte d’une Hépatite B fulminante, diagnostiquée 6 mois plus tôt. Que c’est pour ça que tu avais fait le dépistage.
Vas-y te raconter derrière ça que l’Hépatite B, des fois c’est grave mais le plus souvent ça va.
Et pourtant, diable, je n’ai pas eu envie d’ouvrir les fenêtres.
Tu as été héroïque, et tu m’as permis de l’être.
On a causé. J’ai sorti mes antisèches, pour te les montrer et pour me les montrer à moi aussi en douce, et on a causé.
Des risques. Du oui, peut-être, des fois, ça peut tuer une femme en pleine santé avant qu’elle ait trente ans. Que c’était horrible mais que c’était rare.
On a causé des modes de transmissions. De ce qu’il faudrait avoir comme précautions d’ici ta rencontre avec mon CherConfrère. J’ai passé l’essentiel de la consultation à te dire de continuer à faire des câlins à ta fille de deux ans.
Tu n’étais pas convaincu, et je voyais bien que tu avais envie de partir dans un igloo au pôle nord pour protéger ta famille, alors je l’ai redit, beaucoup. Faites des câlins à votre fille. Antisèches à l’appui.
Je t’ai gardé longtemps, et puis je t’ai demandé 23 euros s’il vous plaît, et puis j’ai accueilli un type qui avait besoin d’un certif de jujitsu.
Tu as été héroïque et droit et fort et intelligent et digne et beau, et tu m’as réconciliée avec les annonces d’Hépatite B.
Merci.
Guéris vite.
Fugue.
22 septembre, 2013
Madame la ministre, Marisol chérie, Ma Marisol, Poulette
(Vous permettez que je vous appelle Poulette, Madame la ministre ? Entre femmes françaises influentes selon adopteunmec.com, on est un peu comme unies au sein d’une belle et grande famille, non ? On se tape les côtes avec le coude, pas vrai ? Je vous ressers un peu de gigot d’agneau, Marisol belle ?)
J’ai mis longtemps à me décider à vous écrire, Marisol sacrée.
D’abord parce que vous écoutez pas ce qu’on vous dit.
Causer aux politiques, jme disais, c’est à peu près aussi utile que d’être une femme française influente selon adopteunmec.com, et je doutais fort que ça puisse être aussi rigolo.
Je pesais les pour et les contre, j’atermoiemais, je cherchais des pistes.
Et ce qui m’a décidée, finalement, c’est que pendant que je réfléchissais à tout ça hier soir, l’esprit occupé et mes doigts caressant machinalement le niveau 165 de Candy Crush, comme tous les putains de jours depuis plus d’un putain de mois, le miracle tant attendu a eu lieu. Sugar crush, Madame la ministre.
Je me suis dit que c’était un signe.
Du coup, je vais vous raconter quand j’ai décidé de devenir médecin généraliste.
Il faut commencer par vous dire qu’à la fac, je me révoltais intérieurement quand les profs invoquaient l’ombre froide de la honte suprême, la menace ultime, le châtiment :
« Vous finirez médecin généraliste dans la Creuse ».
« Mais putain, je me disais. Pourquoi ils s’acharnent comme ça ? C’est pas bientôt fini ce racisme primaire ? C’est vrai, à la fin, en quoi c’est moins bien que le reste, la Creuse ? C’est un département comme un autre, merde.»
Ouais. J’étais pas plus maligne que tout le monde, hein. Je n’avais aucune carte pour l’être.
Ce n’était même pas une opinion réfléchie, pesée. Je n’aurais sans doute pas été capable de l’argumenter bien loin si on m’avait demandé de le faire, c’était juste une certitude évidente, qui ne se questionne pas plus que l’herbe qui est verte ou que Michel Leeb qu’est pas drôle. Médecin généraliste, c’est la honte. C’est comme ça depuis que le monde tourne*.
Je ne savais pas encore ce que je voulais faire, mais le spectre était déjà amputé.
Et puis au fur et à mesure de mes stages, des critères se sont précisés.
En obstétrique, je me suis dit que quand même, voir des gens pas malades de temps en temps, c’était une sacrée bouffée d’oxygène. Je ne me voyais pas réussir à tenir toute une vie avec que des malades super malades, à n’être que dans la mort et dans la souffrance et dans le noir tout le temps. Pour la cancéro, ou la gériatrie, ou les soins palliatifs, il fallait des épaules plus larges que les miennes. J’avais besoin d’être un peu dans la vie, de temps en temps, dans les bonnes nouvelles, les chamallows et le cycle éternel qu’un enfant béni rend immortel.
Aux urgences, j’ai adoré l’ambiance et le travail en équipe. J’ai adoré être la première personne à essayer de trouver le truc qui cloche, à remonter d’un symptôme vers d’autres puis vers un diagnostic, à reconstituer une histoire.
J’adorais passer d’une entorse de cheville à une douleur abdo à un trauma crânien, j’adorais rencontrer plein de gens différents, j’adorais être leur premier contact avec l’hôpital et un peu « leur » médecin pour un temps. Celle à qui on demande des nouvelles.
Et puis quand même, j’ai réalisé deux choses. D’abord, que se planquer dans les chiottes pour esquiver les cas les plus graves ( j’ai jamais pigé les mecs de Grey’s Anatomy qui se battent comme des lions à jeun depuis deux jours pour s’occuper du pire, ça m’a toujours dépassée ) et être paralysée du corps et de l’esprit par les surplus d’adrénaline allait sans doute être un obstacle mineur à une brillante carrière d’urgentiste.
Ensuite, que c’était quand même un peu frustrant de ne pas savoir les suites. De poser un beau diagnostic sans savoir s’il allait être confirmé. De découvrir des tranches de gens et de vie, d’essayer de dépatouiller des situations et de ne jamais savoir si ce qu’on avait fait ou dit ce jour-là avait changé un peu les choses, et dans quel sens. De ne jamais avoir su si elle avait finalement porté plainte ou s’il avait réussi à arrêter de boire.
En orthopédie, j’ai réalisé que le travail en équipe, d’accord, mais que la hiérarchie hospitalière dans toute sa clicheur (clicheur, de cliché. J’aurais pu dire stéréotypie mais ça sonnait moins bien), non.
Que ça me pesait trop de travailler dans un endroit où la pire chose qui puisse arriver soit qu’un externe adresse la parole à un PH.
Que j’en avais marre qu’on me demande à longueur de journée si le piercing sur la langue, c’était pour <insérez ici un mime de fellation> et que ça paraisse une excellente blague très drôle à tout le monde.
Qu’il faudrait avoir la chance plus tard de tomber dans le bon service, où le respect ne s’acquiert pas qu’avec la blancheur de la blouse ou le port du pénis. Je savais qu’il en existait. (Ou alors devenir la grande chefe et imposer moi-même les règles, mais sur ce point je manquais d’ambition. Et puis ça aurait fait dans trop longtemps.)
En gastro, j’ai découvert que j’aimais bien expliquer les trucs.
Que quand un patient me retenait par la manche à la fin du tour en me disant « Pardon, mais il a dit une rectocolitémoquoi ? », ça me plaisait de m’asseoir au bord du lit et d’expliquer le peu que j’en avais compris. Parce que moi aussi, trois semaines avant, je m’étais dit « Une rectocolitémoquoi ? » et que moi non plus je n’avais pas osé poser la question au chef.
J’ai découvert que finalement je m’ennuyais un peu au bloc.
En réa, j’ai appris à placer judicieusement la trouyoteuse pour qu’elle ne troue ni le début de la ligne du sodium ni celle des bicarbonates (une compétence dont je me réjouis encore aujourd’hui).
En radio, j’ai découvert que je ne voulais pas faire radio.
À ce stade du récit, on pourrait croire que bon, j’étais pas loin de mettre le doigt dessus, quand même.
La fille, elle veut faire un truc de premier recours, où on voit des pathologies différentes et des gens différents, des trucs des fois un peu graves et des fois pas, où on passe du temps à expliquer des machins et où on a un suivi au long cours et des nouvelles des patients, si possible sans être trop étouffée par le système hiérarchique.
Hey bin oui, bin non. Toujours pas généraliste.
Une certitude ancrée est ancrée. On m’avait moulée comme ça.
On m’avait moulée à trouver inéluctables les blagues misogynes (la seule révolte que j’avais eue avait été de finir par l’enlever, mon piercing sur la langue), à n’envisager que l’hôpital comme lieu d’excellence (je me gaussais avec tout le monde des courriers des libéraux qui avaient fait n’importe quoi avant de finir par envoyer enfin leur patient dans un endroit décent) et à penser que bien sûr, un médecin généraliste ça soignait (mal) des rhumes et des gastros.
C’est ça que la fac m’a appris, Madame la ministre.
Et, si j’en crois la lecture de mes confrères ici ou là (ou là ou là ou là ou là ou là ou là ou là ou là ou là ou là ou là), ma fac ne faisait pas figure d’exception.
(ou alors on était tous dans la même fac et on le sait pas, allez savoir.)
(d’ailleurs c’est quand même rigolo cette obsession pour la Creuse. Pourquoi pas à Berck ou dans l’Oise ? Mystère. Ça doit faire partie des traditions séculaires et des phrases qu’on se transmet de génération en génération…)
Et je cherchais désespérément la spécialité qui cumulerait tout ce que j’attendais.
Et puis j’ai découvert enfin ce que c’était qu’un médecin généraliste.
Une seule rencontre du bon bonhomme, et paf. Révélation, illumination, séisme.
Pas à la fac, et pas dans mes stages. J’ai découvert ça sur internet.
C’est internet qui m’a appris la vraie vie, Marisol jolie, est-ce que ce n’est pas délicieusement ironique ?
Est-ce qu’il ne faudrait pas essayer de faire un peu en sorte que ce genre de miracle n’arrive pas que par miracle ? Essayer de favoriser les rencontres et la découverte de l’au-delà-des-murs-de-l’hôpital ?
Essayer d’ouvrir les esprits, de dégager les horizons ? Essayer d’apprendre la complémentarité de nos métiers au lieu de la compétition ?
Comment peut-on s’étonner que les cabinets se vident alors qu’on dépense toute cette énergie à imprégner les médecins de l’idée que l’hôpital est leur seul foyer et qu’en partir, c’est fuguer ?
Qu’on se comprenne bien, Marisol adorée.
Je ne veux pas être privée d’hôpital, il est précieux. Il fonctionne parfois de travers et il y a des choses à améliorer, mais je veux l’hôpital.
Je ne veux pas être privée de mes confrères spécialistes, qui me sont indispensables.
Mais je ne veux pas non plus que nous soyons #PrivésDeMG.
Alors je vous dis à demain matin, Madame la ministre.
Avec tous mes égarements,
Jaddo.
* ♪♫ C’est comme ça depuis que le monde tourne, y a rien à faire pour y changer, c’est comme ça depuis que le monde tourne, y vaut mieux pas y toucher. ♫