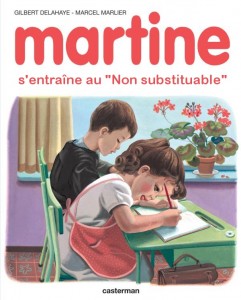« Moi je les supporte pas, les médicaments génétiques. »
15 janvier, 2013
Si j’avais l’Hadopi sur le dos (heu, non, le truc, là, pas Hadopi ; Hadopi c’est le machin sur le téléchargement, pas ça, le machin qui rémunère les médecins à la performance, là), bref, ce truc-là, si je l’avais sur le dos parce que je serais pas remplaçante et que j’aurais pas envoyé mon refus à la sécu (admettons, hein, parce que je pense que si j’étais installée je l’enverrais, mon refus à la sécu), bref, si j’avais ce machin-là sur le dos, je pense que je serais mauvaise élève en génériques.
Moi, de savoir si c’est bien ou pas bien les génériques (oui, je suis manichéenne de la tête), je m’intéresserai à la question quand j’aurai résolu mes problèmes de nombril. Y a débat, et j’ai pas d’idée sur le débat. Comme d’hab sur ces trucs compliqués, j’écoute un peu les gens en qui j’ai confiance, mais je ne suis pas capable de me pencher sur le fond de la question. Ou alors j’ai la flemme, ce qui revient peu ou prou au même.
En gros, pour le moment j’en suis à penser qu’on peut dire que c’est à peu près la plupart du temps pareil, mais qu’on manque quand même de billes pour en être sûrs et certains, et que y a des fois où c’est sûr que c’est pas pareil.
Et puis si j’ai bien suivi on n’est même pas sûrs que ça fasse gagner des sous, et les études qui disent si c’est pareil ou pas sont à peu près aussi bien planquées que le sens de l’humour de Michel Leeb.
Là, pour simplifier les choses, on va partir du principe qu’on est à peu près sûrs que c’est à peu près pareil.
On me demande parfois si je suis « pour ou contre » les génériques.
Je m’en cogne un peu, en fait, de savoir si je suis pour ou contre les génériques. Je suis plutôt « pour », je crois, à tout prendre. Mais en tout cas je sais que je suis pour mes patients. C’est mon job, d’être pour mes patients.
Et, quand on prescrit un médicament, la part pharmacologique du médicament joue seulement pour un petit pourcentage de l’effet attendu. J’ai la flemme de vous trouver des liens qui le montrent, mais voilà. Dans un médicament, y a des molécules et des pharmacocinétiques et des pharmacodynamies de mes couilles, mais pas que.
En gros, figurez-vous que les gens ne sont pas strictement superposables à des rats.
Moi, j’ai une patiente que le Dafalgan endort. Mais pas le Doliprane.
Sur le papier, c’est blanc-bonnet, Dafalgan et Doliprane hein, c’est du paracétamol tout pareil des deux côtés.
Mais voilà, avec le Dafalgan elle passe une super nuit, et la journée elle prend du Doliprane pour ses douleurs et ça l’endort pas.
Je suis censée lui dire quoi, moi ? « Ahah, pauvre gourde, mais c’est du paracétamol les deux, a-t-on idée d’être idiote à ce point-là ? Il n’y a AUCUNE raison que le Dafalgan vous endorme, c’est répertorié nulle part, c’est que dans votre tête. Alors je vais pas vous mettre du Dafalgan pour dormir, ça n’a aucun sens, je vais vous mettre du Stilnox parce que ça c’est marqué dans mes livres que ça endort pour de vrai, ça Madame. »
Bah nan. Elle dort avec du Dafalgan, je suis joie et bonheur, ça nous y fait du somnifère à peu d’effets indésirables et à bas prix, hourra sonnez tambours.
Du coup, j’y écris sur l’ordonnance : « Doliprane 1000 : 1 matin, 1 midi, 1 soir si douleurs. Dafalgan 500 : 1 au coucher. » et le pharmacien doit me prendre pour une abrutie.
Je ne cherche pas à comprendre absolument POURQUOI. Dans l’immense pourcentage non-pharmacologique de l’effet d’un médicament, dans le gros pourcentage de placebo, dans le non-quantifié pourcentage « On croit que c’est pareil mais si ça strouve pas totalement », y a un truc qui fait qu’elle dort avec du Dafalgan, et je serais bien idiote de cracher dessus.
J’ai quarante mille exemples de ce type.
J’ai des patients qui ont la chiasse sous Metformine et pas sous Glucophage, j’ai des patients qui ont la chiasse sous Glucophage et pas sous Metformine, j’ai des patients qui ont des pssscccht dans la tête là comme ça au-dessus des yeux depuis que j’ai changé l’Amlor pour de l’Amlodipine. J’ai une patiente qui est « allergique au lactose » (mais pas au lait) et avec qui il faut passer vingt-cinq minutes de Vidal à éplucher tous les excipients avant la moindre prescription.
Roulez jeunesse, allons-y pour l’Amlor.
Je tiens avec mes patients, et s’ils me disent qu’ils sont mieux avec tel truc, je leur fais confiance.
Ce qui m’importe à moi, c’est qu’ils le prennent, le truc.
Ensuite, se pose le vrai problème de la gueule du médicament.
Chez un patient de 93 ans, en bras de fer permanent avec ses troubles de la mémoire, qui se bagarre tout ce qu’il peut pour retarder le moment où un infirmier viendra tous les matins que dieu fait pour lui donner la béquetée, non, ce n’est pas tout à fait anodin de passer d’une boîte blanche et verte avec des comprimés blancs à une boîte bleue avec des comprimés verts.
Dans la vie que j’aurais choisie avec une baguette magique, déjà tous les putains de médicaments seraient vendus dans des boîtes du même nombre de médicaments (et pas soit 28, soit 30, soit 32 selon le sens du vent), on éviterait les « Non mais celui-là me le mettez pas Docteur, j’en ai deux boîtes d’avance » et les « Vous pourriez m’en mettre une boîte en plus le pharmacien a dû me dépanner« , et tous les médicaments avec le même principe actif auraient la même gueule, la même couleur, les mêmes excipients et le même skin de boîte.
En l’occurrence, c’est pas le cas.
Du coup, si j’essaie de contenter Dame Sécu et de mettre des génériques à tout le monde, dans mon monde sans baguette magique, il faudrait que je mette un nom de laboratoire derrière. « AMLODIPINE MYLAN » ou « AMLODIPINE BIOGARAN ».
Je les connais pas, moi, les noms de labo. Je ne sais pas qui commercialise ou pas telle ou telle molécule. Pas mon taf.
Et quand bien même je les connaîtrais, me semble que le pharmacien a tout à fait le droit de remplacer mon Amlodipine Arrow par l’Amlodipine Alter qu’il a en stock.
Du coup quoi ? Je mouille la plume de mon stylo et j’écris en toutes lettres à la main : « Non substituable Amlodipine Cristers » ?
((Oui, parce que, pour les trois du fond qui n’auraient pas suivi, c’est ce qu’on a trouvé d’intelligent à nous faire faire pour encourager la prescription de génériques. La punition. Les lignes.
Si tu veux que ton patient ait le princeps, tu écriras à la main « Non substituable » DEVANT le nom du médicament. Nous sommes à deux doigts de scotcher des crayons bic ensemble.
Moi, il se trouve que ça me lourde très peu. Je fais déjà mes ordonnances à la main, pour des raisons obscures et qui ne tiennent qu’à moi que je vous raconterai peut-être un jour, et j’ai cette espèce de jouissance idiote à faire mes lignes à la main en tirant la langue.
Mais pour tous mes confrères qui font des ordonnances informatisées, c’est l’horreur.
Et je ne vous parle pas des fois où on retrouve dans la salle d’attente Mme Habitude qu’on a quittée vingt minutes avant, qui veut juste passer entre deux patients parce que y en aura pas pour longtemps, qui vous dit que c’est le pharmacien qui lui a dit de vous dire qu’il fallait écrire à toutes les lignes, heu… qui sort son petit papier et qui annone avec soin « Non substituable mais là-devant ».))
Tout ça ne veut pas dire que je dis amen à tout, et que je mouille ma plume pour le fameux sésame devant chaque ligne de chacune de mes prescriptions.
Grosso modo, j’ai la même règle qu’avec les légumes et les gamins. « T’as le droit de pas aimer, t’as pas le droit de pas goûter ».
Quand j’introduis un nouveau traitement, je le fais en DCI, histoire que les gens apprivoisent le nom de la molécule.
Quand je renouvelle pour mes patients qui refusent les génériques « par principe », « parce qu’ils y ont droit », on fait petit à petit.
J’explique que quand même, c’est pas loin d’être la même chose et qu’il faut voir, et puis on en essaie un, on voit dans trois mois si ça s’est bien passé, si ça s’est bien passé on en essaie un autre en plus, si ça s’est vraiment pas bien passé on remet le princeps et on en essaie un autre.
Douze minutes d’addition de consultation à chaque fois pour expliquer les génériques, le pourquoi, le on va essayer. Un générique tous les trois mois. Mauvaise élève, vous disais-je.
Bref, l’autre jour, Mme Coutume est revenue me voir.
La pharmacienne, elle voulait que j’écrive « Non substituable à la main et devant là », mais elle voulait aussi que j’écrive POURQUOI.
Le jour où les raisons qui font que je prescris à Mme Truc du Doliprane le soir et du Dafalgan la journée, ou comment j’en suis venue à faire le compromis avec M. Bidule de mettre cette fois-ci la Simvastatine en générique mais aucun des autres tiendront sur une ordonnance, c’est qu’on pourra me remplacer par un ordinateur.
J’ai pas vraiment hâte.
Seule. Et mal accompagnée.
9 septembre, 2012
Y paraît qu’un médecin coupe la parole à ses patients au bout de 22 secondes.
C’est pas bien lourd, 22 secondes. En 22 secondes, on a le temps d’entendre mettons un, peut-être deux ou trois symptômes quand le patient est super concis. « J’ai des vertiges ».
Si on laisse causer davantage, neuf fois sur dix on se facilite le boulot, parce que le patient nous donne de lui-même le vrai motif de consultation (« Et j’ai une collègue au boulot, elle a une tumeur cérébrale et ça a commencé comme ça ») (« Là ça va mieux, mais ça m’arrive de temps en temps et ce matin j’ai pas pu aller au travail ») voire carrément le diagnostic (« J’avais déjà eu ça l’an dernier, et l’ORL m’avait secoué la tête dans tous les sens et c’était parti »).
Bref, j’essaie de laisser parler mes patients.
Au moins pour la première phrase de consultation. Je demande « Qu’est ce qui vous amène ? » et je m’efforce de fermer ma gueule jusqu’au vrai point final de la réponse qui suit. Des fois, c’est pas facile, parce que le patient s’égare (« Alors en fait depuis lundi, enfin, bon, pas vraiment lundi, parce que pour dire vrai ça avait déjà commencé un peu dimanche, mais comme j’avais mangé tard je m’étais dit que c’était à cause de ça, mais attendez je vous dis dimanche mais je vous dis une bêtise, dimanche j’étais déjà dans le Loiret alors que j’étais sur Paris le soir de la côte de veau… ») mais je vous jure que c’est payant. Et au pire, quand c’est pas payant c’est rigolo.
Donc celle-là, je suis bien décidée à la laisser parler.
Une femme de cinquante ans, que je n’avais jamais vue avant et qui n’éveille pas ma sympathie d’emblée. Déjà parce que je l’ai jamais vue avant, et que son médecin est en vacances, et que ça me gonfle d’être le seul médecin du coin pas en vacances, parce que ça me fait des consults à rallonge, des ouvertures de dossier, des lettres dans tous les sens et des habitudes à apprivoiser. Au douzième patient pas-à-moi de la journée, je tire un peu la gueule, et je me souviens pourquoi j’ai choisi de faire des remplacements fixes au lieu de courir les routes avec ma sacoche en cuir.
En plus, elle est un peu moche, un peu fatiguée, un peu chouineuse. (Au douzième patient pas-à-moi de la journée, je deviens un peu conne, aussi.)
Vide sidéral du côté des antécédents, ce qui nous permet d’arriver assez vite au sus-cité « Qu’est-ce qui vous amène ? »
Hop, je la laisse parler. Et ma tête, maligne comme un singe et prompte comme quelque chose de prompt à comprendre les situations au premier coup d’œil (l’expérience, y a qu’ça d’vrai), complète à mesure.
– Bin ça a commencé mardi y a deux semaines, d’abord j’ai eu mal à la gorge, alors jme suis dit j’ai une angine…
Mais après mon nez s’est mis à couler…
– Mais après mon nez s’est mis à couler, j’étais comme la tête pleine de coton, j’arrivais pas à me moucher pis je pouvais pas dormir, jme suis dit ça va passer…
Mais après quatre jours c’est pas passé et je me suis mise à tousser…
– Mais après cinq jours c’est pas passé et je me suis mise à tousser, alors je suis allée voir mon médecin et y m’a juste donné du doliprane et un pschit pour le nez…
Mais ça a rien changé et c’est tombé sur les bronches…
– Mais ça s’est pas amélioré, c’était même pire, c’est tombé sur les bronches, je toussais gras, gras, vous savez, ça venait de là, je sais pas comment dire, mais je sentais bien que ça venait de plus profond, alors au bout de six jours je suis retournée voir mon médecin…
Et il m’a mis des antibiotiques et il m’a fait passer une radio…
– Elle m’a mis des antibiotiques et puis je suis allée passer une radio…
Et sur la radio le radiologue il a dit que c’était normal, enfin que y avait une bronchite…
– Et sur la radio y avait un lâcher de ballons.
– Oh merde !
Oui, j’ai dit Oh merde. Je blâme ma bouche.
Je pense m’être redressée d’un coup, alors que je m’imagine m’avachissant, le coude sur le bureau et la tête sur le poing.
Oh merde, j’ai dit. Et comme un de mes neurones, far far away, a bien senti que « Oh merde » était moyennement approprié, il a suggéré à ma bouche de continuer par « Je suis désolée… »
J’ai donc dit : « Oh merde ! Je suis désolée… »
Et j’ai dit « Oh merde » de façon doublement conne. Au-delà de la connerie-même de dire un truc absolument absurde et inapproprié, j’ai dit « Oh merde » comme j’aurais dit « Oh merde » au Docteur Carotte qui me parle d’un patient. Juste parce qu’elle avait employé le joli mot médical.
Face au terme technique, je n’avais plus une patiente devant moi, mais une fille qui sait, qui a franchi la barrière, qui est à côté de moi à se tenir le menton dans la main devant un lâcher de ballons et à se dire « Mmm, ça pue un peu, quand même, hein ? »
Triple conne.
Tu voulais du diagnostic ? En voilà, Cocotte ; Madame est servie. Tu m’étonnes qu’elle avait l’air fatiguée.
Je ne sais plus exactement comment s’est déroulée la consultation après ça.
J’ai essayé de comprendre quel parcours elle avait eu pour se retrouver un samedi matin dans le bureau d’un médecin étranger, avec son lâcher de ballons.
J’ai essayé de comprendre ce qu’on lui avait dit, ce qu’elle en savait, où on en était.
Bin la fille, elle est retournée voir son médecin avec son lâcher de ballons.
Qui l’a examinée sous toutes les coutures, qui a trouvé une boule dans le sein qui était potentiellement là depuis un moment, et qui a dit « Bon bah ça doit venir du sein, allez aux urgences, parce que là je pars en vacances demain et du coup je vais pas pouvoir suivre. »
Elle est allée aux urgences avec la lettre de son médecin.
On lui a dit « C’est pas une urgence, revenez voir la gynéco, on vous donne un rendez-vous mardi en huit. »
Elle est allée voir la gynéco mardi en huit, qui a dit « Bah ouais, effectivement y a une boule, mais bon ça peut venir de là ou pas, on va faire une mammo mais en attendant allez voir le cancérologue jeudi dans deux semaines. »
Elle est allée voir le cancérologue jeudi dans deux semaines qui a dit « Bah oui, mais bon tant qu’on a pas la mammo c’est difficile de savoir, ça peut être ça mais ça peut être autre chose, il faut attendre les bilans, revenez dans deux semaines. »
Madame Fatiguée me dit :
– Le cancérologue il a dit que ça pouvait aussi être une infection, il a demandé si j’avais de la fièvre, et c’est vrai que du coup une fois qu’il a posé la question, c’est vrai que j’ai un petit 38 le soir depuis un moment. Mais, si jamais c’est pas une infection, qu’est-ce que ça peut être d’autre ?
Adieu veau vache bronchite.
J’ai dit que oui, que ça pouvait être une infection, que c’était difficile à dire tant qu’aucun examen n’avait été fait, mais que comme autre possibilité, il y avait le cancer.
Je vous dirais volontiers que je l’ai dit super bien et délicatement, ça strouve oui, hein, mais je ne sais plus.
Elle s’est effondrée. Alors qu’elle avait dit quatre fois « cancérologue » en deux phrases, alors que (oui, crétine de moi) elle avait dit « lâcher de ballons » quinze minutes avant.
Cancer et cancérologue, c’est pas le même mot.
Et je ne blâme personne. Le médecin partait, il fallait que sa patiente soit prise en charge, elle a envoyé à l’hôpital, bon. Sans doute qu’il était difficile de faire mieux. Organiser un suivi de près mi-spécialiste-mi-généraliste quand y a pas le généraliste, c’est bancal.
Les urgences ont dit que c’était pas une urgence, c’est vrai.
La gynéco a dit ce qu’elle pouvait dire avec ce qu’elle avait. Le cancéro pareil.
Il n’empêche que Madame Fatiguée était dans mon cabinet, un samedi matin, en ayant folâtré d’examens en examens, de spécialistes en spécialistes, avec comme plus grande source d’information, j’imagine, Google et « lâcher de ballons ».
Il n’empêche qu’elle a eu une semi-consultation de semi-annonce en face d’une meuf à couettes semi-endormie sur son poing qu’elle avait jamais vue de sa vie et qui a dit « Oh merde ».
Il n’empêche que j’espère que la suite a été moins chaotique, et que j’espère que c’était une sarcoïdose.
À la fin, quand même, au bout de 35 minutes, j’ai demandé ce que je pouvais faire pour elle.
Elle voulait un arrêt de travail, parce qu’elle avait la biopsie après-demain, et puis une autre prise de sang, et que quand même là elle était un peu fatiguée.
J’ai fait un arrêt de travail.
Ils n’ont qu’un seul point faible, et c’est d’être (in)habités.
3 septembre, 2012
Vous ne m’entendrez pas souvent causer de politique, de démographie médicale et d’organisation du système de soins.
Je l’ai souvent dit : je n’ai pas d’idées à grande échelle, je n’ai pas de point de vue d’ensemble, je me contente de raconter les petites histoires de mon petit nombril.
Et puis quand même, un des intérêts de tout ça, de ce blog, de venir ici causer de mon métier, c’est que ça ouvre à des rencontres. Avec des gens qui vivent mon métier comme je le vis, qui le voient comme je le vois, qui veulent le faire comme je veux le faire, et qui ont parfois les idées plus larges.
On me tire par la couette, on me fait relever le menton.
Trois degrés de plus en haut, cinq degrés de plus à gauche, un nouveau filtre, un zoom sur un détail que je ne voyais plus, un plan large sur un paysage que je ne voyais pas, on met en commun, on garde les valeurs centrales, et ça fait des idées.
Qui ne causent même pas de mon nombril, ces égoïstes.
Médecine générale 2.0
Les propositions des médecins généralistes blogueurs
pour faire renaître la médecine générale
Comment sauver la médecine générale en France et assurer des soins primaires de qualité répartis sur le territoire ? Chacun semble avoir un avis sur ce sujet, d’autant plus tranché qu’il est éloigné des réalités du terrain.
Nous, médecins généralistes blogueurs, acteurs d’un « monde de la santé 2.0 », nous nous reconnaissons mal dans les positions émanant des diverses structures officielles qui, bien souvent, se contentent de défendre leur pré carré et s’arc-boutent sur les ordres établis.
À l’heure où les discussions concernant l’avenir de la médecine générale font la une des médias, nous avons souhaité prendre position et constituer une force de proposition.
Conscients des enjeux et des impératifs qui sont devant nous, héritages d’erreurs passées, nous ne souhaitons pas nous dérober à nos responsabilités. Pas plus que nous ne souhaitons laisser le monopole de la parole à d’autres.
Notre ambition est de délivrer à nos patients des soins primaires de qualité, dans le respect de l’éthique qui doit guider notre exercice, et au meilleur coût pour les budgets sociaux. Nous souhaitons faire du bon travail, continuer à aimer notre métier, et surtout le faire aimer aux générations futures de médecins pour lui permettre de perdurer.
Nous pensons que c’est possible.
Sortir du modèle centré sur l’hôpital
La réforme de 1958 a lancé l’hôpital universitaire moderne. C’était une bonne chose qui a permis à la médecine française d’atteindre l’excellence, reconnue internationalement.
Pour autant, l’exercice libéral s’est trouvé marginalisé, privé d’enseignants, coupé des étudiants en médecine. En 50 ans, l’idée que l’hôpital doit être le lieu quasi unique de l’enseignement médical s’est ancrée dans les esprits. Les universitaires en poste actuellement n’ont pas connu d’autre environnement.
L’exercice hospitalier et salarié est ainsi devenu une norme, un modèle unique pour les étudiants en médecine, conduisant les nouvelles promotions de diplômés à délaisser de plus en plus un exercice libéral qu’ils n’ont jamais rencontré pendant leurs études.
C’est une profonde anomalie qui explique en grande partie nos difficultés actuelles.
Cet hospitalo-centrisme a eu d’autres conséquences dramatiques :
– Les médecins généralistes (MG) n’étant pas présents à l’hôpital n’ont eu accès que tout récemment et très partiellement à la formation des étudiants destinés à leur succéder.
– Les budgets universitaires dédiés à la MG sont ridicules en regard des effectifs à former.
– Lors des négociations conventionnelles successives depuis 1989, les spécialistes formés à l’hôpital ont obtenu l’accès exclusif aux dépassements d’honoraires créés en 1980, au détriment des généralistes contraints de se contenter d’honoraires conventionnels bloqués.
Pour casser cette dynamique mortifère pour la médecine générale, il nous semble nécessaire de réformer profondément la formation initiale des étudiants en médecine.
Cette réforme aura un double effet :
– Rendre ses lettres de noblesse à la médecine « de ville » et attirer les étudiants vers ce mode d’exercice.
– Apporter des effectifs importants de médecins immédiatement opérationnels dans les zones sous-médicalisées.
Il n’est pas question dans ces propositions de mesures coercitives aussi injustes qu’inapplicables contraignant de jeunes médecins à s’installer dans des secteurs déterminés par une tutelle sanitaire.
Nous faisons l’analyse que toute mesure visant à obliger les jeunes MG à s’installer en zone déficitaire aurait un effet majeur de repoussoir. Elle ne ferait qu’accentuer la désaffection pour la médecine générale, poussant les jeunes générations vers des offres salariées (nombreuses), voire vers un exercice à l’étranger.
C’est au contraire une véritable réflexion sur l’avenir de notre système de santé solidaire que nous souhaitons mener. Il s’agit d’un rattrapage accéléré d’erreurs considérables commises avec la complicité passive de confrères plus âgés, dont certains voudraient désormais en faire payer le prix aux jeunes générations.
Idées-forces
Les idées qui sous-tendent notre proposition sont résumées ci-dessous, elles seront détaillées ensuite.
Elles sont applicables rapidement.
1) Construction par les collectivités locales ou les ARS de 1000 maisons de santé pluridisciplinaires qui deviennent aussi des maisons médicales de garde pour la permanence des soins, en étroite collaboration avec les professionnels de santé locaux.
2) Décentralisation universitaire qui rééquilibre la ville par rapport à l’hôpital : les MSP se voient attribuer un statut universitaire et hébergent des externes, des internes et des chefs de clinique. Elles deviennent des MUSt : Maisons Universitaires de Santé qui constituent l’équivalent du CHU pour la médecine de ville.
3) Attractivité de ces MUSt pour les médecins seniors qui acceptent de s’y installer et d’y enseigner : statut d’enseignant universitaire avec rémunération spécifique fondée sur une part salariée majoritaire et une part proportionnelle à l’activité.
4) Création d’un nouveau métier de la santé : « Agent de gestion et d’interfaçage de MUSt » (AGI). Ces agents polyvalents assurent la gestion de la MUSt, les rapports avec les ARS et l’Université, la facturation des actes et les tiers payants. De façon générale, les AGI gèrent toute l’activité administrative liée à la MUSt et à son activité de soin. Ce métier est distinct de celui de la secrétaire médicale de la MUSt.
1) 1000 Maisons Universitaires de Santé
Le chiffre paraît énorme, et pourtant… Dans le cadre d’un appel d’offres national, le coût unitaire d’une MUSt ne dépassera pas le million d’euros (1000 m2. Coût 900 €/m2).
Le foncier sera fourni gratuitement par les communes ou les intercommunalités mises en compétition pour recevoir la MUSt. Il leur sera d’ailleurs demandé en sus de fournir des logements à prix très réduit pour les étudiants en stage dans la MUSt. Certains centres de santé municipaux déficitaires pourront être convertis en MUSt.
Au final, la construction de ces 1000 MUSt ne devrait pas coûter plus cher que la vaccination antigrippale de 2009 ou 5 ans de prescriptions de médicaments (inutiles) contre la maladie d’Alzheimer. C’est donc possible, pour ne pas dire facile.
Une MUSt est appelée à recevoir des médecins généralistes et des paramédicaux. La surface non utilisée par l’activité de soin universitaire peut être louée à d’autres professions de santé qui ne font pas partie administrativement de la MUSt (autres médecins spécialistes, dentiste, laboratoire d’analyse, cabinet de radiologie…).
Ces MUSt deviennent de véritables pôles de santé urbains et ruraux.
Le concept de MUSt fait déjà l’objet d’expérimentations, dans le 94 notamment, il n’a donc rien d’utopique.
2) L’université dans la ville
Le personnel médical qui fera fonctionner ces MUSt sera constitué en grande partie d’internes et de médecins en post-internat :
- Des internes en médecine générale pour deux de leurs semestres qu’ils passaient jusqu’ici à l’hôpital. Leur cursus comportera donc en tout 2 semestres en MUSt,
1 semestre chez le praticien et 3 semestres hospitaliers. Ils seront rémunérés par l’ARS, subrogée dans le paiement des honoraires facturés aux patients qui permettront de couvrir une partie de leur rémunération. Le coût global de ces internes pour les ARS sera donc très inférieur à leur coût hospitalier du fait des honoraires perçus.
- De chefs de clinique universitaire de médecine générale (CCUMG), postes à créer en nombre pour rattraper le retard pris sur les autres spécialités. Le plus simple est d’attribuer proportionnellement à la médecine générale autant de postes de CCU ou assimilés qu’aux autres spécialités (un poste pour deux internes), soit un minimum de 3000 postes (1500 postes renouvelés chaque année). La durée de ce clinicat est de deux ans, ce qui garantira la présence d’au moins deux CCUMG par MUSt. Comme les autres chefs de clinique, ces CCUMG sont rémunérés à la fois par l’éducation nationale (part enseignante) et par l’ARS, qui reçoit en retour les honoraires liés aux soins délivrés. Ils bénéficient des mêmes rémunérations moyennes, prérogatives et avantages que les CCU hospitaliers.
Il pourrait être souhaitable que leur revenu comprenne une base salariée majoritaire, mais aussi une part variable dépendant de l’activité (par exemple, 20 % du montant des actes pratiqués) comme cela se pratique dans de nombreux dispensaires avec un impact significatif sur la productivité des consultants.
- Des externes pour leur premier stage de DCEM3, tel que prévu par les textes et non appliqué faute de structure d’accueil. Leur modeste rémunération sera versée par l’ARS. Ils ne peuvent pas facturer d’actes, mais participent à l’activité et à la productivité des internes et des CCUMG.
- De médecins seniors au statut mixte : les MG libéro-universitaires. Ils ont le choix d’être rémunérés par l’ARS, subrogée dans la perception de leurs honoraires (avec une part variable liée à l’activité) ou de fonctionner comme des libéraux exclusifs pour leur activité de soin. Une deuxième rémunération universitaire s’ajoute à la précédente, liée à leur fonction d’encadrement et d’enseignement. Du fait de l’importance de la présence de ces CCUMG pour lutter contre les déserts médicaux, leur rémunération universitaire pourra être financée par des budgets extérieurs à l’éducation nationale ou par des compensations entre ministères.
Au-delà de la nouveauté que représentent les MUSt, il nous paraît nécessaire, sur le long terme, de repenser l’organisation du cursus des études médicales sur un plan géographique en favorisant au maximum la décentralisation hors CHU, aussi bien des stages que des enseignements.
En effet, comment ne pas comprendre qu’un jeune médecin qui a passé une dizaine d’années dans sa ville de faculté et y a construit une vie familiale et amicale ne souhaite pas bien souvent y rester ?
Une telle organisation existe déjà, par exemple, pour les écoles infirmières, garantissant une couverture assez harmonieuse de tout le territoire par cette profession, et les nouvelles technologies permettent d’ores et déjà, de manière simple et peu onéreuse, cette décentralisation pour tous les enseignements théoriques.
3) Incitation plutôt que coercition : des salaires aux enchères
Le choix de la MUSt pour le bref stage de ville obligatoire des DCEM3 se fait par ordre alphabétique avec tirage au sort du premier à choisir, c’est la seule affectation qui présente une composante coercitive.
Le choix de la MUSt pour les chefs de clinique et les internes se pratique sur le principe de l’enchère : au salaire de base égal au SMIC est ajouté une prime annuelle qui sert de régulateur de choix : la prime augmente à partir de zéro jusqu’à ce qu’un(e) candidat(e) se manifeste. Pour les MUSt « difficiles », la prime peut atteindre un montant important, car elle n’est pas limitée. Par rapport à la rémunération actuelle d’un CCU (45 000 €/an), nous faisons le pari que la rémunération globale moyenne n’excédera pas ce montant.
En cas de candidats multiples pour une prime à zéro (et donc une rémunération de base au SMIC pour les MUSt les plus attractives) un tirage au sort départage les candidats.
Ce système un peu complexe présente l’énorme avantage de ne créer aucune frustration puisque chacun choisit son poste en mettant en balance la pénibilité et la rémunération.
De plus, il permet d’avoir la garantie que tous les postes seront pourvus.
Ce n’est jamais que la reproduction du fonctionnement habituel du marché du travail : l’employeur augmente le salaire pour un poste donné jusqu’à trouver un candidat ayant le profil requis et acceptant la rémunération. La différence est qu’il s’agit là de fonctions temporaires (6 mois pour les internes, 2 ans pour les chefs de clinique) justifiant d’intégrer cette rémunération variable sous forme de prime.
Avec un tel dispositif, ce sont 6 000 médecins généralistes qui seront disponibles en permanence dans les zones sous-médicalisées : 3000 CCUMG et 3000 internes de médecine générale.
4) Un nouveau métier de la santé : AGI de MUSt
Les MUSt fonctionnent bien sûr avec une ou deux secrétaires médicales suivant leur effectif médical et paramédical.
Mais la nouveauté que nous proposons est la création d’un nouveau métier : Agent de Gestion et d’Interfaçage (AGI) de MUSt. Il s’agit d’un condensé des fonctions remplies à l’hôpital par les agents administratifs et les cadres de santé hospitaliers.
C’est une véritable fonction de cadre supérieur de santé qui comporte les missions suivantes au sein de la MUSt :
— Gestion administrative et technique (achats, coordination des dépenses…).
— Gestion des ressources humaines.
— Interfaçage avec les tutelles universitaires
— Interfaçage avec l’ARS, la mairie et le Conseil Régional
— Gestion des locaux loués à d’autres professionnels.
Si cette nouvelle fonction se développe initialement au sein des MUSt, il sera possible ensuite de la généraliser aux cabinets de groupes ou maisons de santé non universitaires, et de proposer des solutions mutualisées pour tous les médecins qui le souhaiteront.
Cette délégation de tâches administratives est en effet indispensable afin de permettre aux MG de se concentrer sur leurs tâches réellement médicales : là où un généraliste anglais embauche en moyenne 2,5 équivalents temps plein, le généraliste français en est à une ½ secrétaire ; et encore, ce gain qualitatif représente-t-il parfois un réel sacrifice financier.
Directement ou indirectement, il s’agit donc de nous donner les moyens de travailler correctement sans nous disperser dans des tâches administratives ou de secrétariat.
Une formule innovante : les « chèques-emploi médecin »
Une solution complémentaire à l’AGI pourrait résider dans la création de « chèques-emploi » financés à parts égales par les médecins volontaires et par les caisses. (1)
Il s’agit d’un moyen de paiement simplifié de prestataires de services (AGI, secrétaires, personnel d’entretien) employés par les cabinets de médecins libéraux, équivalent du chèque-emploi pour les familles.
Il libérerait des tâches administratives les médecins isolés qui y passent un temps considérable, sans les contraindre à se transformer en employeur, statut qui repousse beaucoup de jeunes médecins.
Cette solution stimulerait l’emploi dans les déserts médicaux et pourrait donc bénéficier de subventions spécifiques. Le chèque-emploi servirait ainsi directement à une amélioration qualitative des soins et à dégager du temps médical pour mieux servir la population.
Il est beaucoup question de « délégation de tâche » actuellement. Or ce ne sont pas les soins aux patients que les médecins souhaitent déléguer pour améliorer leur disponibilité : ce sont les contraintes administratives !
Former des agents administratifs est bien plus simple et rapide que de former des infirmières, professionnelles de santé qualifiées qui sont tout aussi nécessaires et débordées que les médecins dans les déserts médicaux.
Aspects financiers : un budget très raisonnable
Nous avons vu que la construction de 1000 MUSt coûtera moins cher que 5 ans de médicaments anti-Alzheimer ou qu’une vaccination antigrippale comme celle engagée contre la pandémie de 2009.
Les internes étaient rémunérés par l’hôpital, ils le seront par l’ARS. Les honoraires générés par leur activité de soin devraient compenser les frais que l’hôpital devra engager pour les remplacer par des FFI, permettant une opération neutre sur le plan financier, comme ce sera le cas pour les externes.
La rémunération des chefs de clinique constitue un coût supplémentaire, à la mesure de l’enjeu de cette réforme. Il s’agit d’un simple rattrapage du retard pris dans les nominations de CCUMG chez les MG par rapport aux autres spécialités. De plus, la production d’honoraires par les CCUMG compensera en partie leurs coûts salariaux. La dépense universitaire pour ces 3000 postes est de l’ordre de 100 millions d’euros par an, soit 0,06 % des dépenses de santé françaises. À titre de comparaison, le plan Alzheimer 2008-2012 a été doté d’un budget de 1,6 milliard d’euros. Il nous semble que le retour des médecins dans les campagnes est un objectif sanitaire, qui justifie lui aussi un « Plan » et non des mesures hâtives dépourvues de vision à long terme.
N’oublions pas non plus qu’une médecine de qualité dans un environnement universitaire est réputée moins coûteuse, notamment en prescriptions médicamenteuses. Or, un médecin « coûte » à l’assurance-maladie le double de ses honoraires en médicaments. Si ces CCUMG prescrivent ne serait-ce que 20 % moins que la moyenne des autres prescripteurs, c’est 40 % de leur salaire qui est économisé par l’assurance-maladie.
Les secrétaires médicales seront rémunérées en partie par la masse d’honoraires générée, y compris par les « libéro-universitaires », en partie par la commune ou l’intercommunalité candidate à l’implantation d’une MUSt.
Le reclassement des visiteurs médicaux
Le poste d’Agent de Gestion et d’Interfaçage (AGI) de MUSt constitue le seul budget significatif créé par cette réforme. Nous avons une proposition originale à ce sujet. Il existe actuellement en France plusieurs milliers de visiteurs médicaux assurant la promotion des médicaments auprès des prescripteurs. Nous savons que cette promotion est responsable de surcoûts importants pour l’assurance-maladie. Une solution originale consisterait à interdire cette activité promotionnelle et à utiliser ce vivier de ressources humaines libérées pour créer les AGI.
En effet, le devenir de ces personnels constitue l’un des freins majeurs opposés à la suppression de la visite médicale. Objection recevable ne serait-ce que sur le plan humain. Ces personnels sont déjà répartis sur le territoire, connaissent bien l’exercice médical et les médecins. Une formation supplémentaire de un an leur permettrait d’exercer cette nouvelle fonction plus prestigieuse que leur ancienne activité commerciale.
Dans la mesure où leurs salaires (industriels) étaient forcément inférieurs aux prescriptions induites par leurs passages répétés chez les médecins, il n’est pas absurde de penser que l’économie induite pour l’assurance-maladie et les mutuelles sera supérieure au coût global de ces nouveaux agents administratifs de ville.
Il s’agirait donc d’une solution réaliste, humainement responsable et économiquement neutre pour l’assurance maladie.
Globalement, cette réforme est donc peu coûteuse. Nous pensons qu’elle pourrait même générer une économie globale, tout en apportant plusieurs milliers de soignants immédiatement opérationnels là où le besoin en est le plus criant.
De toute façon, les autres mesures envisagées sont soit plus coûteuses (fonctionnarisation des médecins libéraux) soit irréalisables (implanter durablement des jeunes médecins là où il n’y a plus d’école, de poste, ni de commerces). Ce n’est certainement pas en maltraitant davantage une profession déjà extraordinairement fragilisée qu’il sera possible d’inverser les tendances actuelles.
Calendrier
La réforme doit être mise en place avec « agilité ». Le principe sera testé dans des MUSt expérimentales et modifié en fonction des difficultés rencontrées. L’objectif est une généralisation en 3 ans.
Ce délai permettra aux étudiants de savoir où ils s’engagent lors de leur choix de spécialité. Il permettra également de recruter et former les maîtres de stage libéro-universitaires ; il permettra enfin aux ex-visiteurs médicaux de se former à leurs nouvelles fonctions.
Et quoi d’autre ?
Dans ce document, déjà bien long, nous avons souhaité cibler des propositions simples et originales. Nous n’avons pas voulu l’alourdir en reprenant de nombreuses autres propositions déjà exprimées ailleurs ou qui nous paraissent dorénavant des évidences, par exemple :
- L’indépendance de notre formation initiale et continue vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique ou de tout autre intérêt particulier.
- La nécessité d’assurer une protection sociale satisfaisante des médecins (maternité, accidents du travail…).
- La nécessaire diversification des modes de rémunération.
Si nous ne rejetons pas forcément le principe du paiement à l’acte – qui a ses propres avantages –, il ne nous semble plus pouvoir constituer le seul socle de notre rémunération. Il s’agit donc de :
— Augmenter la part de revenus forfaitaires, actuellement marginale.
— Ouvrir la possibilité de systèmes de rémunération mixtes associant capitation et paiement à l’acte ou salariat et paiement à l’acte.
— Surtout, inventer un cadre flexible, car nous pensons qu’il devrait être possible d’exercer la « médecine de famille » ambulatoire en choisissant son mode de rémunération.
- La fin de la logique mortifère de la rémunération à la performance fondée sur d’hypothétiques critères « objectifs », constat déjà fait par d’autres pays qui ont tenté ces expériences. En revanche, il est possible d’inventer une évaluation qualitative intelligente à condition de faire preuve de courage et d’imagination.
- La nécessité de viser globalement une revalorisation des revenus des généralistes français qui sont aujourd’hui au bas de l’échelle des revenus parmi les médecins français, mais aussi en comparaison des autres médecins généralistes européens.
D’autres pays l’ont compris : lorsque les généralistes sont mieux rémunérés et ont les moyens de travailler convenablement, les dépenses globales de santé baissent !
Riche de notre diversité d’âges, d’origines géographiques ou de mode d’exercice, et partageant pourtant la même vision des fondamentaux de notre métier, notre communauté informelle est prête à prendre part aux débats à venir.
Dotés de nos propres outils de communication (blogs, forums, listes de diffusion et d’échanges, réseaux sociaux), nous ambitionnons de contribuer à la fondation d’une médecine générale 2.0.
(1) À titre d’exemple, pour 100 patients enregistrés, la caisse abonderait l’équivalent de 2 ou 2,5 heures d’emploi hebdomadaires et le médecin aurait la possibilité de prendre ces « tickets » en payant une somme équivalente (pour arriver à un temps plein sur une patientèle type de 800 patients).
______________________________________________________________________________________
Voilà, c’est fini.
Comme vous voudrez à tout prix télécharger ce texte, et comme je suis vraiment une mère pour vous, vous pouvez le trouver là en pdf : Médecine générale 2_0
Si vous voulez le soutenir et ajouter votre signature à la nôtre, c’est chez Dominique Dupagne.
Et vous pouvez aussi le trouver chez les copains :
AliceRedSparrow – Borée – Bruit des sabots – Christian Lehmann – Doc Maman – Doc Souristine – Doc Bulle – Docteur Milie – Docteur V – Dominique Dupagne – Dr Couine – Dr Foulard – Dr Sachs Jr – Dr Stéphane – Dzb17 – Euphraise – Farfadoc – Fluorette – Gélule – Genou des Alpages – Granadille – Matthieu Calafiore – Yem
Dark Passenger
2 juillet, 2012
Je connais cette patiente par cœur.
On a eu des débuts difficiles, on s’est beaucoup engueulées, et puis on s’est apprivoisées petit à petit. On s’est faites chacune au franc-parler de l’autre, et c’est maintenant presque cette mésentente initiale qui fait notre complicité.
Je la connais par cœur parce que c’est une de mes premières patientes-à-moi du cabinet du Dr Carotte. Elle venait toujours le vendredi, et elle gueulait toujours qu’elle tombait jamais sur le Dr Carotte, et qu’on pouvait plus jamais le voir, et que les remplaçants c’est bien beau mais que son médecin traitant c’est quand même lui.
J’y disais qu’elle avait qu’à arrêter de venir le vendredi, et deux semaines plus tard, elle revenait et elle prenait l’air offusqué de me voir encore, moi.
Ça pourrait être la femme du mec du hameau. Elle n’est pas très bonne élève : « Elle, la laitue, elle laisse ça aux chèvres ». Elle fume toujours parce que quand même, à son âge, je vais pas lui enlever ça, mais elle me jure qu’elle a levé un peu le pied sur le fromage. Au moins au petit-dej.
Bref, je l’aime bien, et je la connais par cœur. Je vois à son œil quand elle va me faire le coup des chèvres, je sais quand elle est disposée à prendre le prochain conseil qui sortira de ma bouche, que je choisis subséquemment avec soin. Je sais quand sa fille est là, je sais ses relations avec son gendre et ce qu’elle pense du prénom qu’ils ont choisi pour le petit dernier.
Je sais ce qu’elle gagne tous les mois, je sais sa marque de lessive, tous les combien elle change de chaussettes, je sais qu’elle attend toujours la dernière minute pour aller récupérer ses médicaments à la pharmacie, et qu’une fois sur deux elle manque du truc qu’il faut commander une fois sur deux.
L’autre jour, à la fin d’une consultation qui s’était passée particulièrement bien, fière qu’elle était des deux kilos en moins accusés par la balance, elle me charrie sur je ne sais plus quoi, sans doute mon Mont-Blanc, à base des docteurs-qui-s’emmerdent-pas-quand-même-avec-tout-le-fric-qu’ils-gagnent.
Elle me dit qu’elle aurait pu, elle, avoir un beau métier et gagner plein de sous, qu’il faut pas croire, qu’elle a de l’éducation et des diplômes.
Qu’elle parle 5 langues, même.
Elle a appris en prison.
Quand elle a fait dix-huit ans pour le meurtre de son premier mari, qui un jour, « l’avait poussée à bout ».
Par cœur mes couilles.
Y a deux autres patientes aussi que je suis depuis 3 ans et que j’aime beaucoup.
Elles ont mon âge, elles sont sympas, bourrées d’énergie, fraîches, saines, souriantes, avec plein de dents de partout ; on dirait des pub Narta. Y en a une qui a fait un AVC sur coke, l’autre qui sait pas du tout de qui elle est enceinte, parce qu’il y avait beaucoup de monde à cette soirée.
Y a cette patiente déprimée que j’ai vue si souvent. Le masque devant la terre entière, les épaules solides et les pleurs qu’elle ne s’autorisait jamais que devant moi, comme tant d’autres. Comme tant d’autres, elle m’engueulait de la faire pleurer, elle riait, elle remettait son masque, elle redressait son dos et elle partait.
J’ai mis 3 ans à savoir qu’elle picolait le soir, une fois les enfants couchés. Je me suis pourrie intérieurement de n’avoir jamais posé la question. Une déprimée que j’ai vue deux fois par mois pendant trois ans, bordel.
J’en ai mis un de plus à savoir que son mari lui cognait dessus.
La fille de M. Matrel n’est pas sa fille, M. Richard ouvre son imperméable aux sorties d’école, Mme Simon a élevé ses deux filles en arrondissant les fins de mois comme elle pouvait, l’adjoint au maire a deux maisons, deux femmes et deux séries d’enfants qui ignorent tout les unes des autres.
Pour un secret confié, combien sont tus ?
Qu’est-ce que c’est, de connaître un patient par cœur ?
Qu’est-ce que ça change, en définitive, que je sache que Mme Chèvre a fait dix-huit ans de prison ? Est-ce que j’aurais dû mieux chercher, ouvrir plus de portes ? Est-ce que c’est simplement venu quand ça devait ? Est-ce que ça a la moindre importance ?
Est-ce que je suis un meilleur médecin en sachant tout ça ?
Et moi, patients qui venez me confier parfois vos peines de cœur, vos péchés, vos secrets honteux, que savez-vous de moi ?
Vous qui n’avez « confiance qu’en moi », qui me racontez des choses en me faisant promettre de ne pas les dire au Dr Carotte, est-ce que ça changerait quelque chose si vous découvriez que j’adore la sodomie ?
Est-ce que vous changez de médecin si je mange mes crottes de nez ? Si vendredi soir, j’aurais pas dû mélanger le rhum et le cannabis et si j’ai vomi ? Si j’ai tué un chat parce qu’y sentait pas bon ?
Quand on se rencontre, autour de mon bureau, que vous pleurez et que je croise les bras, que je vous écoute en me frottant le nez ou en me mordillant les lèvres, c’est quelle partie de vous qui rencontre quelle partie de moi ?
L’amor y a
19 février, 2012
Je sais pas bien pourquoi je suis amoureuse comme ça des Martin.
Ils n’ont rien d’exceptionnel, les Martin, et pourtant à chaque fois que j’arrive au cabinet du Dr Carotte et que je les vois sur le trottoir, j’ai le petit chaud au cœur d’une journée qui commence bien. Faut dire qu’ils m’aiment bien aussi ; ils viennent toujours le vendredi maintenant. Et j’ai bien l’impression qu’ils s’illuminent un peu quand j’arrive.
Lui me fait un gros clin d’œil appuyé, elle sourit timidement en faisant un petit hochement de tête avec les yeux d’un gamin devant une boîte de cookies.
D’ailleurs avec le temps, j’ai développé une alarme à Martin. Sur la route du cabinet, quand je me dis « Tiens, ça fait longtemps que j’ai pas vu les Martin » , ça ne loupe pas, ils sont là. Métronome réglé sur trois mois.
Il ressemble à Obélix, elle ressemble à Bonemine après quinze ans de régime.
Il devient doucement frontal avec le temps. La deuxième ou troisième fois, alors qu’ils étaient venus un jeudi et que d’habitude c’est pas moi le jeudi, en me voyant ouvrir la porte il avait beuglé dans la salle d’attente « OOOH ! MAIS C’EST LEUH PETIT DOCTEUR AUJOURD’HUI !! ».
Ça m’aurait énervée d’à peu près n’importe qui, ça m’avait touchée dans sa bouche.
Ils viennent tous les trois mois, pour Monsieur. Madame pourrait allègrement venir tous les six, mais j’avais bien vu que ça l’avait contrariée quand je l’avais proposé. Va pour trois mois.
On commence par Monsieur, toujours. Je me fais rapidement une idée de l’ordonnance, en fonction de si je l’entends siffler de derrière mon bureau ou non. On passe dans la salle d’examen, il fait une blague ou deux, parfois à base de « Ah, si j’avais vingt ans de moins ! » (trente, tu seras gentil…), je l’examine, on discute, il refait une blague ou deux, il se rhabille pendant que je renouvelle son ordonnance devant Madame dans un silence concentré.
Il est gigantesque, sensiblement aussi large que haut, il est diabétique hypertendu BPCO, il a une voix de basse même si j’aurais préféré dire « de baryton » parce que le mot est super plus joli, et l’autre jour, alors que je le croisais dans la rue sur le chemin du cabinet, on a échangé deux mots, il a fait un bisou sur sa main et il a posé sa main sur ma joue.
De plus en plus frontal, mais je l’aime de plus en plus.
Ensuite, je m’occupe de Madame. Elle tremble de plus en plus, mais ça ne la gêne pas et ça n’inquiète pas le neurologue.
Elle a toujours 18 de tension, je la fais toujours se reposer 5 minutes, et elle a toujours 17 après.
Je mens, je lui dis qu’elle a 15, parce qu’on sait bien toutes les deux qu’elle a 13/7 chez elle.
« Je suis émotive, hein ! » , qu’elle me dit, à chaque fois.
« Bin forcément, vous venez de me parler de votre fils… » , que je lui réponds, à chaque fois.
Elle est contrariée, avec son fils. Toujours, pour trois fois rien. Il a pas appelé, ou il a pas rappelé. Elle m’en parle à voix basse tous les trois mois.
Et puis elle s’inquiète pour Monsieur. À voix encore plus basse.
Il ne peut plus l’emmener danser depuis quelques années déjà, elle qui aimait tellement ça. Elle se fait du souci pour lui.
Je retourne faire son ordonnance à elle pendant qu’elle essaie péniblement de se reposer pour faire baisser sa tension d’un ou deux points.
« Elle s’inquiète pour moi » , qu’il me dit à voix basse.
Faut que je me méfie, à trop les aimer. C’est le seul de mes diabétiques pour lequel j’ai oublié le contrôle bio pendant quasi dix mois. Dix mois sans hémoglobine glyquée. L’autre jour, je me suis rendu compte en remplissant un dossier administratif que je ne savais même pas s’il fumait. Un patient BPCO, que je vois tous les trois mois. Aucune putain d’idée de s’il fumait.
Par contre, je sais qu’ils ont marié leur fille en Normandie en mars, et je connais par cœur ses mains rugueuses.
Ce n’est pas bien, un jour je passerai à côté de quelque chose, fatalement, à bien les aimer comme ça.
Ils sont rentrés dans le cabinet côte à côte.
Jamais vus.
Indiens, ou Pakistanais, ou un truc du genre.
Elle m’a fait le grand sourire des femmes qui ne parlent pas un mot de français.
(Je suis pas dieu capable de vous expliquer pourquoi, mais le sourire « Je-fais-style-genre-je-parle-pas-français-mais-t-inquiète-pas-que-je-comprends-tout » et le sourire « Je-pigne-VRAIMENT-pas-un-mot » sont vraiment très distinctement reconnaissables.)
Il a pointé son ventre du doigt. Il a dit : « Elle bébé, et… Bébé. Nous pas vouloir. Pas pouvoir Bébé. »
Encore une consultation facile.
Ils sont arrivés avec 12 minutes de retard, parce qu’ils sont très occupés, et qu’à chaque fois on attend. Madame avait rendez-vous seule, mais elle vient avec Monsieur puisque ce sera rapide, et qu’il n’y a que des ordonnances à faire, et qu’ils vont me dire quoi.
Monsieur a juste besoin de faire « un bilan des cinquante ans ». Madame se tient à côté, raide comme la robe austère de la justice sous laquelle je vous raconte pas © . Dans le bilan, Monsieur voudrait aussi le test de la prostate, là.
Du coup, j’essaie d’expliquer que ce n’est pas si simple. À mesure de mon discours, que je tiens en regardant Monsieur bien dans les yeux, je sens Madame dans le coin gauche de mon champ visuel se durcir encore, comme si c’était Dieu possible.
La commissure de sa bouche se met à trembler de plus en plus perceptiblement.
J’accroche tout ce que j’ai d’ancres dans les yeux de Monsieur.
Erreur de débutante, aggravée sans doute par mon historique avec Madame, avec qui les consultations se passent toujours super mal.
Madame explose au milieu d’une de mes phrases. Parce que pardon, mais elle travaille au ministère, et si ce que je raconte avait un tant soit peu de bien fondé elle en aurait entendu parler quand même. Et c’est bien la première fois qu’elle entend « une chose pareille », et on se demande quel genre de médecin je suis, et que c’est criminel, de ne pas vouloir dépister un cancer à quelqu’un.
Je laisse l’orage passer en silence, j’attends qu’elle ait fini, j’ouvre la bouche enfin et je dis que la rombière, elle va la mettre en sourdine trois minutes et décaniller de mon cabinet, ou alors curer la prostate de son mari elle-même à la main puisqu’elle est si maligne.
Dans ma tête.
Dans ma bouche, telle le couard roseau, je propose des liens, un peu de lecture, qu’on est pas aux pièces et qu’on pourra en reparler la prochaine fois.
J’ai revu monsieur seul, un bon dix mois plus tard.
Il n’a pas fait le reste du bilan, pis il a paumé l’ordonnance, et d’ailleurs de toute façon dix mois plus tard elle est plus valable.
Je relance la question des PSA.
« Ah, oui, j’ai lu les trucs que vous m’aviez donnés… C’était intéressant, hein, c’est vrai que ça donne à réfléchir. »
Quelques secondes de silence, il ajoute « Moi je suis d’accord avec vous… »
Quelques secondes de silence, ses yeux partent en haut à droite, il examine un truc intérieurement et il souffle :
« Bah, faites-les moi pour Madame… »
Ils ont un accent espagnol à couper au couteau. Deux vaches espagnoles, mais des toutes petites vaches.
Des petites vaches mignonnes de 85 ans.
Ils viennent toujours à deux, même quand c’est seulement pour un.
Cette fois, c’est pour les deux. Ils vont bien, c’est juste pour remettre les médicaments, là.
On fera semblant d’oublier son cancer en veille cette consultation encore.
Il entre dans le cabinet en brinquebillant, la tête à hauteur des épaules et le menton sur le sternum, à cause de son dos qui se gondole. Elle le talonne. Ils sourient.
Lui il a un peu mal aux mains, il s’y est fait, mais quand même ça bloque et ça rouille le matin. Il a un peu de mal à écrire, même s’il écrit moins qu’avant. De toute façon c’est elle qui fait les chèques, il dit en se marrant et en lui jetant un œil en coin.
Pendant que je pose les questions d’usage à Madame, je le vois qui fixe quelque chose derrière moi.
Je me retourne, je regarde le tableau du Dr Carotte accroché derrière moi, je le regarde.
Son œil s’allume. « Non, mais… Je me suis toujours demandé, mais… Qu’est ce que C’EST que ça ? » Il se marre tout ce qu’il peut à l’intérieur. Il essaie faire sérieux, il essaie très fort de préparer une blague pince-sans-rire, mais sa malice diffuse de la lumière par tous les pores de sa peau. N’est pas anglais qui veut, et lui est décidément franchement espagnol.
« Non mais c’est un tableau ça ? C’est quoi, vraiment ? »
Il se marre comme un gamin.
Il fait semblant d’engueuler Madame qui ne retrouve pas la carte vitale, il peste, il fait mine, elle fait semblant d’être contrite et elle se marre avec lui.
Dans la salle d’examen, je revois son œil qui s’allume devant l’autre tableau du Dr Carotte.
Il me voit qui le vois, il sait que je sais qu’il prépare une blague, il ricane doucement et puis il dit « Non mais quand même, le Dr Carotte… Il a mal goût, hein ! »
J’éclate de rire. Je le fais répéter deux fois, juste pour savourer de l’entendre répéter.
Je repense à notre première rencontre, quand je l’avais trouvé odieux.
Agressif, inarrêtable, remonté contre la terre entière, disant tout le mal du monde du Docteur Carotte, des médecins du monde entier, et dans la foulée de moi qu’il rencontrait pour la première fois, exigeant des réponses, ne les écoutant pas. Une boule de foudre débaroulée en trombe dans le cabinet, antipathique au possible.
Madame était méchamment malade.
Ils viennent à deux. Trentenaires. Le rendez-vous est pour lui.
Je l’avais déjà vu quelques semaines auparavant pour une gêne au pénis, un truc qui le chatouillait un peu sur le gland, et comme elle avait eu des condylomes peu de temps avant, il s’inquiétait.
Il n’y avait rien à l’époque, un pénis parfait. J’avais expliqué que les condylomes, ça va ça vient, ça peut revenir d’une infection ancienne, comme l’herpès, que ça ne voulait rien dire.
Il s’inquiétait aussi d’avoir pu choper le VIH, parce qu’à quelques reprises ils avaient fait l’amour sans préservatif.
Ils avaient fait des tests récemment tous les deux, négatifs tous les deux. J’ai mis un moment à piger le sujet de son inquiétude. Il pensait que le VIH, ça s’attrapait comme un gamin : au hasard, comme ça, en faisant l’amour sans protection. Génération spontanée de VIH. Il ne savait pas qu’il fallait que le partenaire soit séropositif pour transmettre l’infection. Il avait été vachement rassuré.
Bref, entre-temps, un truc a poussé, là où ça le démangeait quelques semaines avant.
On passe tous les deux dans la salle d’examen, je jette un coup d’œil, et oui, y a pas à tortiller du cul, c’est un condylome.
Je suis encore penchée entre ses cuisses qu’il se met à beugler au-dessus de ma tête :
« AH ! TU VOIS ! T’ENTENDS ? »
La réponse hurlée parvient de la salle d’à côté : « BIN OUAIS, J’AI ENTENDU ! PARDOOON, J’T’AI DIT ! »
Ils sortent main dans la main pendant qu’elle lui explique à l’oreille comment on met l’Aldara.
J’aimais bien cette fille. Vingt-trois ans, fraîche comme la rosée, souriante, toujours polie, toujours contente.
Elle s’était assise devant moi, je l’avais reconnue (Je l’aime bien, elle) sans la reconnaître (Je sais plus son nom ni pourquoi elle était venue la dernière fois).
Elle m’avait déposé un test de grossesse sur le bureau avec un sourire radieux.
« Ça y est ! »
J’avais jeté un œil sur le dossier, la consultation précédente, une vague histoire de sinusite.
Quand elles me disent qu’elles sont en essai-bébé, la plupart du temps on en discute à mort, j’écris plein de trucs dans le dossier, je prescris de la Spéciafoldine, des prises de sang, tout ça.
Là, rien, une sinusite.
Je m’étais dit que sans doute, j’avais dû poser la question au moment de la prescription d’AINS, qu’elle avait dû répondre un truc elliptique genre « Pas encore » que je n’avais pas interprété aussi fermement qu’il avait été dit.
Bref, ça se finit par une première consultation de grossesse, avec plein de conseils et de paroles et de sourires.
Et puis quelques semaines après j’ai reçu ce type que je détestais. Un type que je détestais depuis longtemps. Sans raison valable en dehors de mon alarme-à-moi-que-j’ai. Vaguement chiant et hypocondriaque, mais j’ai plein de patients chiants et hypocondriaques que j’adore. Lui, il me faisait du froid dans le bide sans explication valable. Winter is coming.
Il me raconte que sa copine est enceinte, qu’elle ne se rend pas compte, qu’elle est trop jeune, qu’ils ne sont pas ensemble depuis assez longtemps, qu’elle ne veut pas avorter parce qu’elle a peur que ça la rende stérile à ce qu’elle dit, et il me demande les arguments médicaux qu’il pourrait lui opposer, ce qu’il pourrait lui dire pour qu’elle comprenne qu’elle peut avorter sans crainte de conséquences physiques.
Alors oui, forcément, vous vous avez déjà tout compris, alors que pour moi à l’époque ils n’étaient pas encore dans le même paragraphe d’une même histoire. J’ai dû prendre le temps de relier les deux personnes et les deux consultations dans ma tête. Ça m’a un peu secouée quand j’ai fait le lien.
La consultation d’homme-qu-on-déteste qui demande d’un point de vue médico-médical les arguments anti-crainte-de-l-IVG à donner à la fille-au-sourire-radieux de la semaine dernière dont on vient de se rendre compte qu’elle était en couple avec lui, laissez-moi vous dire que ça a été un vrai bonheur.
J’ai revu la fille la semaine d’après, en larmes.
La semaine suivante, et la semaine suivante, et les semaines d’après.
Et je vous passe les détails, je vous passe le sordide, les choses qu’il lui a dites juste avant et juste après l’avortement. Un pervers comme dans les livres.
Avec cette nuance près que je n’avais que sa version pour elle. Et, aussi, c’est vrai, mon alarme dès les premiers jours contre lui.
Je l’ai revue aussi 15 mois après. Avec exactement la même histoire, une IVG en plus, et la prochaine, peut-être, en préparation.
Autant la première fois j’avais tenu. J’étais restée derrière ma blouse, j’avais mis tout ce que j’avais de stéthoscope entre nous pour dire « Et, vous me dites que vous hésitez parfois à le quitter… Quelles seraient les raisons de rester ? … RIEN ? OH TIENS DONC HUM HUM HUM…. »
Cette fois-là j’ai craqué. J’ai entendu ma bouche dire « Non mais là faut PARTIR hein… »
Je crois qu’elle est partie. Je ne sais pas.
J’ai toujours la frousse de le revoir lui, pour un rhume ou une sinusite.
Je ne pense pas pouvoir être encore son médecin à lui, et je ne pense pas pouvoir lui dire que je ne peux pas sans rompre le secret médical que j’ai vis-à-vis d’elle.
On les tient à domicile depuis une dizaine d’années.
Elle a un Alzheimer grave, il s’occupe d’elle tout ce qu’il peut et on essaie tous de ne pas voir qu’il débute le sien lui aussi.
Il m’appelle régulièrement, tous les vendredis, en criant « C’EST RAYMOND ! »
Il s’offusque tous les vendredis que le Docteur Carotte ne soit pas là, il s’indigne tous les vendredis à seize heures trente que je ne puisse pas faire une visite à domicile là maintenant tout de suite parce que bientôt faudrait choisir quand on tombe malade, il m’explique tous les vendredis que là sa femme ça va plus du tout, et il raccroche tous les vendredis en disant « Bon, vous direz à Carotte que Raymond a appelé ! »
J’ai fini par réussir à les voir en vrai, à l’occasion de quelques visites programmables.
Il appelle toujours en urgence, et quand j’arrive, il ne sait plus du tout qui je suis, il est surpris de me voir là, et il ne sait plus du tout pourquoi il a appelé.
Elle, elle est toujours souriante, elle est toujours contente de me voir, elle ne sait plus trop pourquoi mais elle sait qu’elle m’aime bien.
Elle a cet humour des Alzheimers que j’adore, cette façon de faire une pirouette pour masquer l’oubli.
Le même humour que Monsieur Desfosses. L’année dernière, je l’ai reçu en consultation pour la troisième ou quatrième fois. J’avais mon T.Shirt bizarre noir, avec des manches longues, coupées au premier quart du bras, en haut, avec des épingles à nourrice qui relient le haut de la manche avec les trois quarts restants, sur un demi-centimètre de peau apparente. Je lui ai demandé s’il se souvenait de moi, je lui ai dit qu’on s’était déjà vus il y a quelques mois. Son regard s’est perdu un instant, puis il a pointé le haut de mon bras de l’index et il a dit : « En tout cas, vous avez bien grandi depuis la fois dernière ! »
Voilà, cet humour-là.
Bref, Raymond et sa femme, ils ne savaient encore plus pourquoi j’étais là.
La fois d’avant, elle se grattait, alors il lui avait mis des crèmes, mais elle se grattait encore. J’avais regardé la table basse, où étaient alignées les crèmes. Dexeryl, Locapred, Ketoderm, Huile de lavande, Amycor, Vaseline, Vinaigre balsamique.
Je jure que je n’invente rien. Il s’étonnait que ça gratte encore.
Bref, cette fois-là, j’y vais, en urgence. Ils m’accueillent d’un œil rond, ils n’attendaient personne.
Je demande ce qui ne va pas à Madame qui trottine depuis la salle de bains pour nous rejoindre au salon.
Elle se tait quelques secondes, empoigne son pantalon deux fois trop grand à la taille, et dit : « Ce qui ne va pas… Ce qui ne va pas… Bin mon pantalon, vous voyez bien. »
Je me marre. Elle se marre, contente que sa blague ait réussi. Monsieur finit par se marrer un peu aussi, mais il continue à avoir l’air inquiet.
Je reviendrai la semaine prochaine, pour voir.
Il est portugais, il est français.
Lui est bloqué à domicile, lui va plutôt bien.
Ils ont 65 et 68 ans.
Il vient me chercher au cabinet les ordonnances pour lui.
Il arrive difficilement à marcher, plus du tout à bander, ils supportent courageusement tous les deux.
Je me dis que ça n’a pas dû être facile pour eux il y a trente ans.
Elle rentre dans le bureau d’un pas lent et mesuré, dans sa robe bleu marine avec des gros boutons dorés.
Elle me serre la main, me sourit, elle s’assied face à moi.
Elle sort sa petite pochette qu’elle ouvre en deux. Dans la poche du bas, sa dernière ordonnance. Dans la poche du haut, séparée en deux, sa carte vitale et sa dernière prise de sang. Elles sont rudement bien pensées, ces pochettes.
Elle vient juste pour son renouvellement.
J’ouvre son dossier. Dernière consultation il y a trois mois. Un mot, il y a un mois : « Courrier : mari décédé (décomp cardiaque et pneumopathie d’inhalation) »
Je me bénis un peu intérieurement de faire ma maniaque des courriers et des dossiers tous les samedis.
Je prends des nouvelles doucement.
Elle va bien.
« Il faut bien faire aller, vous savez. »
Elle dort, elle mange, ses enfants sont présents.
Je demande combien de temps ils ont été mariés. Elle me dit qu’elle est contente que je pose la question. Elle souffle « Soixante-deux ans » avec un petit sourire fier.
Ils viennent à deux. Ils sont jeunes, il est noir, elle est blanche, ils sont magnifiques.
On dirait une pub Benetton, mâtinée de matinées Ricoré.
Elle est tombée dans l’escalier et elle a mal aux côtes.
Je l’examine, sous les yeux attentifs de Monsieur qui nous a suivies dans la salle d’examen.
Je raconte toujours que l’œil du médecin, ahahah, hyper professionnel, aucun sous-entendu, jamais, rien à voir, aucun lien entre les deux côtés de la barrière.
Elle, je m’en souviens comme une des deux fois dans ma vie où j’ai été troublée. Malgré moi, un machin non professionnel qui a surgi pendant que je l’examinais. Deux fois dans ma vie, hein.
Elle était vraiment, vraiment belle. Un corps et un ventre parfait, à rendre jalouse n’importe qui.
Il était vraiment beau, et ils étaient amoureux que ça transpire de partout et que ça t’emplit ton cabinet.
J’ai posé quelques questions, pour comprendre un peu comment elle était tombée, si ça avait cogné devant ou derrière, tout ça. Elle a rougi furtivement, elle a lancé un regard en coin à son amoureux.
Elle a dit quelque chose à voix basse à base de qu’y fallait me le dire, que c’était pas grave.
Il a acquiescé, doucement et sérieusement, qu’il valait mieux le dire. Il a regardé ses pieds.
Elle m’a dit en chuchotant qu’ils avaient fait l’amour trop fort et qu’elle s’était fait mal.
Il avait visiblement envie de mourir, d’avoir cassé son amoureuse.
Eux aussi, ils viennent en couple, à chaque fois, en se rythmant sur celui qui doit venir le plus souvent.
Je ne sais plus bien pourquoi, mais à elle, on lui fait des MMS régulièrement.
Pas « souvent », hein, mais régulièrement. Mettons une fois par an.
À leur demande à eux deux, je crois.
Et je le vois bien, qu’il lui a fait répéter, le matin même.
Quand elle ne sait plus, elle se tourne vers lui d’un quart, discrètement.
Il fait bouger ses lèvres, discrètement. Il lui souffle.
Ils trichent, main dans la main.
Je vois bien qu’ils trichent, et je lui mets à elle le score qu’ils ont obtenu à deux.
Sans remords, parce que c’est le score qui me semble le plus vrai.
A la fin de l’envoi…
30 décembre, 2011
Je suis troublée.
Dans la vie, je n’ai jamais été une grande toucheuse.
Parce que dans la vie, on le sait bien, y a grossièrement les toucheurs et les non-toucheurs. On a tous un copain comme ça (ou alors on est ce copain comme ça) qui ne peut pas s’empêcher de vous toucher, toutes les trente secondes. Il fait une blague, bam, il vous colle une tape sur l’épaule. Il commence une phrase par « Tu sais », paf, il colle sa main sur la vôtre. On a tous une grand-tante qui nous caresse les cheveux d’un air distrait en nous parlant. On connait tous quelqu’un qui ne peut pas s’empêcher de se mettre à 30 cm de vous pour vous causer. Envahissement d’espace vital, c’est juste insupportable.
Je ne suis pas de ceux-là. Sors de là, t’es dans mon cercle.
Et je me suis rendu compte que dans mon métier, j’étais une sacrée toucheuse. J’arrête pas. Je tripote mes patients à longueur de temps.
Genre je laisse une main sur leur épaule pendant que j’ausculte le dos.
Souvent, je m’assieds à côté des gens, pour l’auscultation pulmonaire. Ils sont assis sur la table en face de moi, et c’est quand même plus pratique. Alors je m’assieds à côté, à gauche, je pose ma main gauche sur l’épaule gauche, je me penche un peu et j’ausculte le dos de la main droite. Des fois, nos cuisses se touchent, du coup.
Quand ils sont couchés, je me penche. Parce que je sais pas. Déjà, si faut voir un truc, j’ai besoin d’avoir mes yeux à 5cm. Je suis myope comme une taupe, certes, mais à 30 cm avec mes lentilles, je vois quand même clair. Or, j’ai pas besoin de voir clair, j’ai besoin de voir GROS. Mes internes me reprenaient sans arrêt sur mes sutures, parce qu’au bout de 4 points je finissais systématiquement le nez collé sur la plaie.
Je regarde entre des orteils, je me penche. Nez sur le pied. Et je me dis que si j’étais patiente, j’aimerais peut-être moyen ça.
Et c’est la même chose si je regarde un pénis.
Quand ils sont couchés et que j’ausculte le cœur, je me penche aussi. Je suis mieux concentrée comme ça, allez comprendre. Si je passe sur le poumon gauche, celui le plus éloigné de moi, je me penche encore. Je suis quasiment collée au patient. « Respirez fort », je dis. Gentiment, les gens tournent la tête, parce que là, en respirant fort, ils me respirent direct sur le visage. Si j’étais patiente, je ferais pareil.
Quand ils se couchent, souvent, on dirait qu’ils s’imaginent que je vais leur sauter sur le bras pour prendre la tension. J’ai encore rien fait, j’ai rien dans les mains, je comptais pas commencer par ça, mais ils se couchent et ils me tendent leur bras raide à 45° au-dessus du lit. Sauf que la tension, je la prends au repos, avec le bras le long du corps, détendu. La tension c’est fiable si les gens sont décontractés ; pas au garde à vous, raides comme la justice, avec le bras tendu et le poing serré, et la frousse d’être chez le médecin. Du coup j’attrape le bras et je le repose sur le lit, doucement, et souvent je le caresse un peu dans la foulée.
Dans ma tête à moi, dans mes gestes, c’est une façon d’exprimer « Là, là, pose, détends, relâche, tout va bien. » Mais bordel, je me rends compte que je caresse le bras. De haut en bas, du plat de la main, sans aucune raison médicale valable.
Je peux pas commencer une consultation sans serrer une main. Même des touts-petits. C’est autre chose aussi, en plus ; c’est une façon de poser le contact, c’est une façon d’ouvrir la consultation, c’est un moment de sas entre la salle d’attente et la consultation qui commence. (Et puis les petits adorent ça, qu’on leur serre la main. Je m’agenouille, je me mets à leur hauteur et je serre la main. A deux ans, ouais. Ils adorent ça. Je pense que ça participe en bonne partie à tous les « Ohlala dis donc, vous êtes douée, hein, il est jamais sage comme ça d’habitude » que je récolte à la fin de mes consultations pédiatriques, mais c’est un autre sujet.)
Bref, tout ça pour dire que même nourrisson, même avant l’âge du serrage de main, j’ai besoin de toucher avant d’entamer ma consult. Un doigt sur l’épaule peut suffire.
Quand je vérifie des grains de beauté sur le dos, j’y vais au plat de la main. Genre comme si mes yeux suffisaient pas.
Pourtant dans la règle ABCDE, y a pas d’histoires de relief ou de texture, hein.
Quand j’examine un bébé, j’ai toujours une main qui traîne. J’écoute le cœur, j’ai une main sur la jambe. Je regarde les yeux, j’ai une main sur le ventre.
Dans ma tête à moi, dans mes mains, c’est « Là, là, tout va bien, moi-gentille. »
Je me suis rendue compte de ça effarée l’autre jour, parce que je pense que si j’étais patiente je le vivrais peut-être super mal.
J’ai réfléchi. Beaucoup. Pour savoir pourquoi je fais comme ça, pourquoi la non-toucheuse de la vie se transforme en toucheuse de la médecine.
Je n’ai pas de réponse. J’ai l’impression que j’ai besoin de ça pour mieux comprendre mon patient. Ça n’a pas beaucoup de sens, pourtant, je m’en rends bien compte.
J’ai besoin de le toucher, de le sentir, j’ai besoin de proximité, j’ai besoin de sentir sa peau sous ma peau.
Et la phrase « J’ai besoin de sentir sa peau sous ma peau », celle qui me vient spontanément des tripes quand j’essaie de comprendre, à la relire, je vois bien que ça sonne érotico-je-sais-pas-quoi. Et dieu sait que ce n’est vraiment, vraiment pas la question. C’est strictement la même chose pour un homme, une vieille femme, un nourrisson.
Je ne sais pas, comme si le toucher me permettait de mieux m’approprier la personne, de mieux la deviner, de mieux rentrer en contact avec elle.
Ça m’effraie un peu, parce que je me dis que c’est peut-être très mal vécu en face.
Dans mes moments d’optimisme, je me dis que les gens doivent bien le sentir, que ça n’a rien de déplacé, que c’est bienveillant, que c’est une question de contact au-delà du charnel. Que d’ailleurs, je n’ai jamais senti de malaise ou de frein, qu’on ne m’a jamais rien dit.
Dans mes moments de pessimisme, je me dis qu’on ne dit pas à son Docteur « Hey oh, hey, mon espace vital ! » . Qu’on rentre chez soi mal à l’aise et troublé en se posant des questions. Qu’il faut peut-être que je me force à me surveiller mieux.
Et puis, quand j’imagine me surveiller mieux, arrêter de toucher les gens, je n’arrive pas à m’imaginer faire du bon travail, j’ai l’impression que ça va me manquer, que ça ne sera « pas pareil » , qu’il me manquera quelque chose. Un sens, du sens.
Du coup je me tâte.
Mouahahah.
Le syndrome d’Under-Woman
23 mai, 2011
Ça pue la gitane sans filtre jusque dans le couloir.
Je suis fumeuse ; mon propre appart sent la clope froide en permanence, je suis un peu rodée. Mais là, même moi qui n’suis pas aussi chicandière, j’ai eu quelques secondes de suffocation en franchissant la porte.
C’est Madame qui m’ouvre. J’aperçois son sourire à travers le nuage de fumée, elle me tend une main décidée, elle m’invite à la suivre au salon qu’elle rejoint en boitillant d’un pas ferme. C’est le genre de femme à boiter d’un pas ferme.
Figé dans son fauteuil, Monsieur regarde par la fenêtre quand j’arrive. Il est en pyjama, il tient une canne dans la main. Je ne sais pas trop à quoi sert la canne, étant donné l’urinoir posé au sol et les débris alimentaires autour du fauteuil. Il est aussi sec qu’elle est ronde, blanc comme sa gitane qu’il finit par écraser dans le cendrier de la table basse. Il me serre la main en me jaugeant du regard. J’ai l’impression d’être un représentant qui vient lui vendre une encyclopédie dont il se cogne. Il marmonne une réponse à mon bonjour, puis tourne la tête à nouveau vers la fenêtre.
Madame s’assied à la table, joviale, face à son cendrier à elle.
La table ressemble aux tables des gens qui attendent la visite du médecin : des tas d’ordonnances empilées, un ou deux dossiers cartonnés, des enveloppes, un chéquier, deux cartes vitales, quelques boîtes de médicaments.
Il est difficile d’expliquer à quelle vitesse et sur quels indices on se fait une idée des choses et des situations.
Ça fait deux minutes que je suis là et j’ai déjà mon schéma en tête : lui, AOMI qui emmerde les médecins et que les médecins emmerdent, stade « du lit au fauteuil » , proche du stade « et puis du lit au lit », peut-être cancer.
Elle, au moins aussi malade que lui mais ne peut pas se permettre de boiter.
Tous les deux mal et peu suivis.
L’historique brouillonne que j’arrive à reconstituer avec Madame me confirme mes préjugés. Suivis par le Dr Carotte depuis très peu, puisqu’ils viennent d’arriver ici et qu’ils avaient un autre médecin là-bas.
Sur l’ordonnance de monsieur, du Symbicort qu’il ne prend pas, du Doliprane qu’il ne prend pas parce que « Ça ou rien c’est deux fois rien » , du Renutryl qu’il prend quand Madame le force, « parce qu’en dehors de ça il mange rien Docteur. »
C’est une ordonnance bien courte au vu de la gueule de Monsieur.
Bien courte aussi au vu de la gueule de ses dernières analyses biologiques, avec notamment une Hb glyquée à deux chiffres.
« Ah oui, il a été diabétique un moment, me dit Madame, il prenait du Glucor mais là il en prend plus le médecin avait dit que c’était plus la peine. Moi je suis diabétique, mais lui il l’était plus normalement. C’est moi, le diabète. »
Monsieur se laisse examiner de mauvaise grâce et répond monosyllabiquement à une question sur deux, me permettant de confirmer au moins l’AOMI, la BPCO et le rythme très espacé des toilettes.
La tension est correcte, parce qu’il faut bien sauver quelque chose.
Quand je retourne m’asseoir à la place qui m’a été attribuée autour de la table, il se tourne à nouveau vers la fenêtre et rallume une gitane. Ok. Marchons sur des œufs.
Parce que j’ai besoin de plus de temps pour décider de ce que je vais essayer de faire de tout ça, je passe à Madame.
Les analyses de Madame sont du même acabit, avec un diabète super déséquilibré, un cholestérol indécent.
Une ordonnance plus traditionnelle néanmoins, avec un peu plus de lignes. Elle fait ses piqûres d’insuline toute seule, mais le Glucophage elle a arrêté parce que ça lui chamboulait tout là d’dans.
Je lui demande si elle m’a fait venir uniquement pour le renouvellement, si tout va bien par ailleurs, si elle ne se plaint de rien.
« Ah si jvoulais vous montrer quelque chose » , elle dit.
Elle m’entraîne dans la chambre, elle s’allonge, elle remonte sa robe, elle baisse sa couche. Elle m’explique au passage qu’elle a des fuites depuis un moment, alors elle a acheté des couches. Ça ne semble pas lui poser de gros problème. Elle a des fuites, elle mets des couches, histoire réglée.
« Ça fait un moment, j’ai comme un abcès à l’aine, j’avais déjà eu ça mais là ça revient pis jme suis dit que ça allait partir mais ça part pas » , dit-elle en soulevant les fesses et en tirant la couche à ses chevilles.
L’odeur de la gitane ne masque pas celle du pus et de la macération. Effectivement, oui, y a comme un abcès.
Ça ressemble à une maladie de Verneuil, tellement y a comme un abcès. (Note aux lecteurs non médecins qui s’apprêtent à taper « Maladie de Verneuil » dans Google Image : attention ces images peuvent choquer.) C’est fistulisé de partout, ça s’étend sur tout le pli inguinal, ça suinte, c’est gonflé, c’est rouge, ça sent terriblement mauvais.
« Alors j’ai mis du Dakin pour désinfecter mais j’ai pas l’impression que ça s’arrange beaucoup. »
Tu m’étonnes qu’elle boite.
La résistance de la machine humaine et la tolérance des gens face aux transformations de leurs corps ne laissent pas de m’impressionner.
Bon. Donc, c’est Beyrouth.
On pourrait les hospitaliser quatre fois chacun.
Il faudrait tout reprendre, lancer des tas de médicaments pour monsieur, faire des tonnes d’examens, ré-adapter tout le traitement de madame, probablement l’opérer.
Bin j’ai fait rien.
Quasi rien. Un peu bougé le traitement de Madame, lancé des antibios et des soins locaux, renouvelé le Renutryl de Monsieur, serré les mains et suis partie.
Parce que je me méfie du syndrome de Wonder Woman.
La jeune médecin qui débarque, tourbillonne dans une jolie tornade, sort son lasso doré pour taper sur les doigts de Monsieur parce qu’il faut absolument arrêter de fumer parce que c’est pas possible et que ça lui pourrit les artères, et qu’il faut prendre des médicaments pour le diabète, et qu’il faut prendre son Symbicort parce que c’est pas bien de pas le prendre et que d’ailleurs depuis combien de temps il a pas vu un pneumologue pour ses poumons et qu’il a pas fait un doppler.
Parce que je ne comprenais pas tout de la situation, qui existait bien avant que je ne vienne poser ma mini-jupe rouge sur cette chaise sale.
Parce que peut-être, par exemple, que Monsieur a aussi un cancer du poumon et que les précédents médecins ont jugé préférable de lui foutre la paix.
Parce qu’un type qui a fumé trois gitanes sous mon nez pendant les 50 minutes de ma présence chez lui n’a probablement pas attendu que je surgisse dans sa vie pour lui apprendre que fumer c’est trop mal.
Parce que ce type-là, il va sans doute falloir négocier en douceur le moindre médicament supplémentaire sur son ordonnance si on veut avoir une toute petite chance qu’il le prenne.
Parce qu’il y a forcément une raison à cette sous-médicalisation à outrance, qu’il va falloir la comprendre pour essayer de rouler avec.
Parce qu’on n’est pas à une semaine près, parce qu’on ne change pas les choses d’un coup de baguette magique aussi enthousiaste soit-il.
Parce que ces gens ne me demandaient rien et ne se plaignaient de rien.
J’ai fait mon Under Woman.
J’ai cru lire dans l’œil de Monsieur un poil d’intérêt et un poil de respect quand il a vu que je ne poussais pas des hauts cris et que je ne le sermonnais pas. J’ai eu l’impression de partir en ayant posé de bonnes bases pour pouvoir peut-être commencer à faire un peu de médecine à la visite suivante.
Et le bon équilibre, ce qu’il aurait fallu faire, jusqu’où il aurait fallu bousculer les choses, franchement, je ne sais pas.
Peut-être que j’ai pris cette décision aussi un peu parce qu’elle était plus facile et plus confortable pour moi.
Peut-être j’ai voulu faire ma frimeuse à la je-vais-vous-montrer-que-je-suis-pas-comme-les-autres-médecins-et-que-moi-je-vous-respecte-et-vous-allez-voir-un-peu-comme-je-suis-la-reine-de-l’établissement-du-lien-de-confiance.
Peut-être que je me suis trouvé de bonnes raisons de ne pas savoir quoi faire, que j’ai collé un alibi à mes couettes.
Peut-être que l’argument « Oui non mais je sais qu’il est mort Msieur l’Juge, mais vous comprenez j’ai pas voulu le bousculer avec sa gueule de non-compliant… » n’est pas super solide.
La semaine dernière, j’ai réussi à ajouter un antidiabétique, de l’aspirine et un antalgique sur l’ordonnance de monsieur, avec moultes précautions oratoires.
A un moment, quand j’expliquais ce que je proposais d’ajouter et pourquoi, il a brandi sa canne pour me menacer avec, mais son œil souriait. On verra bien comment ça va se passer.
Elle, son pli inguinal ne s’était pas franchement amélioré. Elle m’a appris entre deux phrases sur autre chose qu’on lui avait « enlevé un naevus à cet endroit-là il y a quelques années ». Je n’aime pas bien ça.
A la prochaine étape, il va sans doute falloir quand même finir par hospitaliser Madame, et gérer la situation de Monsieur qui ne peut pas rester seul à la maison.
Ils m’ont demandé si ça pouvait attendre leur retour de vacances, ils partent dans le sud pour voir leurs enfants et leur nouveau petit-fils.
J’ai dit oui.
Je ne sais pas si j’ai bien fait et j’ai la frousse.
Le poinçonneur des Lilas
31 mars, 2011
1) Je m’occupe de Coralie depuis le début de mon remplacement chez le Docteur Carotte. Quelques années, donc.
J’aime bien Coralie. Elle est souriante, agréable, courageuse.
Elle est en bonne santé. Elle a seulement un problème sur lequel on s’est penchées pendant plusieurs consultations : des règles hyper douloureuses. Ça dure une demie-journée, parfois une entière, toujours le 2ème jour des saignements. Elle a super mal, elle vomit, elle transpire. Et puis ça passe. Ce n’est pas non plus une partie de plaisir les autres jours, mais c’est assez supportable pour mener une vie normale et sortir du lit.
On n’a pas trouvé de maladie sous-jacente, pas de signes d’endométriose, rien. Du bon utérus de compet.
La pilule, pour une fois, n’a pas vraiment arrangé les choses. Les anti-douleurs la soulagent partiellement. Reste un jour par mois, pas tout le temps, tous les deux ou trois mois, où vraiment elle morfle. Elle fait avec.
Je l’ai trouvée dans ma salle d’attente un vendredi après-midi, avec la gueule de quelqu’un qui vient de passer 3 heures assise dans le bruit et dans les microbes en ayant super mal et envie de vomir et envie de s’allonger.
« C’est le deuxième jour de mes règles », elle a dit.
Je l’ai examinée, c’était comme les autres fois. Un ventre souple, de bonnes constantes, juste super mal.
Les médicaments, elle en avait encore et elle les avait pris comme il faut.
Mais elle n’avait pas pu aller au boulot, et il lui fallait un arrêt de travail. Juste pour aujourd’hui, elle savait que demain ça irait mieux.
Ça s’est passé comme ça 3 ou 4 fois dans l’année. On en profitait pour discuter un peu, pour compléter le dossier, pour prendre des nouvelles du bébé. Je ne crachais pas dessus ; c’était des consultations reposantes, qui me faisaient rattraper un peu de temps quand j’étais en retard, et ce n’était pas les 22 euros les plus durement gagnés de ma vie. Mais bon, au bout d’un moment, le dossier d’une femme de 32 ans en bonne santé, même avec les antécédents familiaux sur trois générations, ça se complète.
Depuis quelques mois, elle m’appelle. Je lui fais un arrêt de travail de 24h après l’avoir eue au téléphone. Elle passe le prendre le lendemain sur sa pause de midi au boulot.
2) Tout à l’heure, j’ai vu M. Diarrhée. M Diarrhée a vu le Docteur Cerise en début de semaine pour son fils qui va dans une crèche où les trois-quart des gamins ont eu des diarrhées et qui, surprise, a eu des diarrhées aussi. Et M Diarrhée a eu des diarrhées à son tour.
Je l’examine, il va bien. Un ventre souple, de bonnes constantes, juste des diarrhées.
Je lui demande s’il a pris des médicaments.
Oui, il a pris des anti-diarrhées, vu que le Docteur Cerise avait senti le coup venir, et avait prescrit en début de semaine des anti-diarrhées-pour-adultes aux deux parents du bébé diarrhéique, au cas où.
Mais il a dû quitter le boulot à 11h ce matin, et il lui faut un arrêt de travail.
3) Hier, j’ai eu ma sœur au téléphone. Son fils avait une gastro, elle croyait qu’elle avait encore des médocs mais sa fille a tout bouffé lors de sa dernière gastro à elle. Son médecin était absent, les deux autres médecins du coin étaient complets, son gamin lui vomissait dessus avec toute la fougue d’un enfant de son âge, et la pharmacienne bien désolée ne pouvait pas lui filer son traitement habituel sans ordonnance.
« Je vais quand même pas l’emmener aux urgences pour une gastro ! », qu’elle a dit, ma sœur.
J’ai convenu que ce serait ballot. On a bricolé un truc à base d’Iphone, de scanner, de mail et d’imprimante.
4) Quand j’étais petite, à la maison, il y avait des règles que j’aimais bien.
Celle de la sonnette d’alarme, et d’autres qui mériteraient à mon avis un article à part entière même si c’est à la frontière de la médecine, tellement c’est de la santé publique. Bref.
A partir de mes 12-13 ans, une règle s’est ajoutée à la liste : « Droit à un faux par an. »
Dans une vie où je n’avais jamais réussi à extorquer à ma mère le moindre mot-d’excuse-des-parents de complaisance, même si j’avais pas fait mes devoirs, même si je jouais hyper bien la fille qui a trop mal au ventre, même si on devait partir en vacances et qu’un jour de plus aurait arrangé tout le monde.
Une fois par an, pour un jour, le jour de mon choix, je pouvais demander un faux mot-d’excuse à ma mère. Je pouvais me planifier une journée DVD-bonbons, je pouvais la prévoir à l’avance ou à l’arrache, j’en faisais ce que je voulais. (Bon, ça comptait pas s’il y avait un examen ou un truc important, quand même.)
C’était ma journée, et c’était une fois par an. J’en étais responsable.
J’ai de très intenses souvenirs des soirées de jeux-de-rôle de la grande sœur, quand j’assistais émerveillée à la partie d’ AD&D, qu’il fallait aller se coucher tôt parce que demain y avait école, que là, non, là vraiment non j’avais trop envie de rester et que je finissais par lever le poing en criant : « Je prends ma journée !!! »
Et bin j’ai jamais séché les cours plus d’un jour par an, même grande, même au lycée. Quand l’envie me prenait, je savais que j’avais mon jour, j’y réfléchissais, et puis si ça valait pas le coup je reportais.
Redoutable d’efficacité.
Je rêve d’un monde où on prendrait les adultes pour des gens responsables, et où on ne les enverrait pas plusieurs heures dans une salle d’attente juste pour avoir le passe-droit du médecin.
Parce que le type qui vient me voir en disant « Depuis hier soir j’ai fait 40 passages aux toilettes, j’ai pas dormi de la nuit, je suis pas allé bosser » , figurez-vous que j’attends pas qu’il me vomisse dessus pour lui faire son arrêt de travail.
Au risque de décevoir, je n’ai ni détecteur de mensonges ni scanner au bout des doigts.
Mon arrêt de travail, c’est juste qu’au lieu de « Patron, j’ai une gastro, je peux pas venir bosser », je dis : « Cher Patron de M Diarrhée, M Diarrhée me dit qu’il a une gastro et qu’il a pas pu aller bosser. »
Pendant que je rêve de ce monde là, j’ai cru voir passer une loi parlant de suppression des allocs en cas d’absences scolaires non justifiées, mes patients se tordent dans la salle d’attente pour avoir mon sésame, et la sécu pleure des larmes de sang.
Alors oui, je sais, machin, abus, confiance, absentéisme tout ça.
Je ne sais pas, je n’ai pas de réponse facile, mais j’imagine…
J’imagine des « certificats d’aptitude parentale » qui permettraient de certifier que Mme Machin et ses neurones sont aptes à décider de se faire délivrer du Tiorfan et du Vogalène pour le petit, dans la limite de x boîtes par an.
Des certificats de « dysménorrhées chroniques », qui autoriseraient la patiente à poser d’elle-même un jour de congé, dans la limite de 1 jour par mois et de x jours par an.
Des certificats qui diraient « M. Machin est un grand garçon pas flemmard, travailleur, qui a le droit d’avoir une gastro deux fois dans l’année, bisous. »
Du pistil ! Du pistil ! On-veut-du-pistil ! *
28 décembre, 2010
(*Jeudi, une manif de fleurs.)**
Je continue ma croisade pro-pénis.
Après le salutaire message « Foutons la paix aux prépuces des petits garçons », je voudrais le dire : « Foutons la paix aux pénis des grands ».
Messieurs, révoltez-vous contre la gent féminine qui froisse le nez. Vous n’avez pas à vous laver les mains après avoir fait pipi.
Voilà. La peau de la verge, c’est pas plus dégueu que votre cuir chevelu. Sans doute moins dégueu, même.
En terme de microbes, j’entends, hein.
En terme de sensibilité, après, tout le monde fait avec la sienne.
Mais d’un point de vue purement médical :
– l’urine, c’est stérile. Sauf si vous avez une infection urinaire, mais passons. Et par ailleurs, si vous vous débrouillez correctement, vous n’êtes pas censés vous pisser sur les mains.
– la peau du pénis, c’est à peu près autant couvert de microbes que la peau tout court de n’importe où ailleurs.
– la peau du pénis, c’est beaucoup moins plein de microbes que l’anus ou le vagin qui sont de façon naturelle et non pathologique pleins de microbes qui vivent en harmonie en se roulant dans la rosée du matin sur fond de symphonie pastorale (sauf si vous avez une infection, encore une fois : ça devient tout de suite beaucoup moins harmonieux, mais passons.)
– la peau du pénis, c’est beaucoup moins plein de microbes que votre salive ou votre nez.
Donc :
– on se lave les mains avant de manger (pour pas bouffer les microbes qu’on a forcément paluchés à un moment ou l’autre)
– on se lave les mains après avoir fait caca, ou après avoir fait pipi si on est une femme (cause que c’est pas loin du vagin)(si y restait du papier toilette et qu’on s’est essuyé)
– on se lave les mains super souvent si on est malade (on se mouche, on tousse, on se gratte le nez : on se couvre les mains de microbes)
– on se lave les mains un coup de temps en temps en temps normal parce que la vie c’est les microbes et qu’y en a partout de toute façon.
– on se lave les mains dans les toilettes publiques, rapport que la poignée est pleine de femmes et de gens qui font caca. (et après on sort des toilettes, donc on re-rentre pour se re-laver les mains, puis on ressort et on re-re-rentre, et à la fin on bouffe sa bavette-échalotes froide. Donc on commande un tartare, et on chope un ver solitaire. En fait y a pas d’issue, nous sommes cernés.)
Si Madame vous les brise, exigez d’elle qu’elle se lave les mains à chaque fois qu’elle se touche la joue, qu’elle se remaquille ou qu’elle s’entortille les cheveux autour des doigts.
C’était un message de santé publique. (mais y a un autre post un peu moins stérile (uhuhuh) qui devrait venir dans pas longtemps)
Et les liens des gens qui l’ont dit bien avant moi :
– sur Tatoufaux, la perle qui recense les idées reçues de tout poil.
– pour le décalottage : Winckler ici, et Naouri là.
– Le marron c’est la terre du chemin.
PS : oh, et tant que j’y suis : on se lave pas l’intérieur du vagin non plus. Sinon on fout le bordel dans la symphonie pastorale, on met le chaos dans le bel équilibre microbien et on se colle une infection qui serait jamais passée par là si on avait pas été autant flippée d’en avoir une.
** J’ai des références obscures si je veux.
Toinette et Argan
22 novembre, 2010
Je vous avais déjà parlé de la prise rituelle de la tension artérielle, ce truc inutile sept fois sur dix mais auquel il faut quand même faire semblant de s’intéresser, sinon le docteur « il m’a même pas pris la tension ».
Et bien sachez que son équivalent pédiatrique existe. Pardon si je fais un peu monomaniaque de la pédiatrie en ce moment, mais il fallait que j’en parle.
Chez les petits, on est dispensé de tension, soit, mais il faut s’occuper DES DENTS.
Semblerait que les Dents, c’est le truc qui réveille les parents la nuit. J’imagine que c’est la compet’ à la sortie de la crèche. « Moi il vient de faire sa quatrième. Et le vôtre ? »
Les Dents, c’est l’explication ultime de tout et n’importe quoi, et c’est l’obsession des mamans.
J’ai deux problèmes principaux avec les dents.
Le premier, c’est que ça passionne les parents, et que moi, ça m’intéresse à peu près comme un sketch d’Elie Kakou.
Que les choses soient claires et nettes dès le début : je ne sais pas prédire l’éclosion d’une Dent deux semaines et demi avant. Pire que ça : je n’ai pas envie d’apprendre. Je m’en cogne. On s’en cogne de savoir si votre petit a une, deux, quatre ou six Dents en préparation. Vous avez déjà vu un adulte chez qui les Dents n’ont jamais poussé ? Bin voilà, moi non plus. Elles vont pousser, ses Dents. Il va finir par en avoir un nombre honorable, comme tout un chacun.
Quand une mère me dit : « J’ai l’impression qu’il fait une Dent, au milieu en haut y a un petit point blanc, vous pourrez vérifier ? » ou « Il est grognon en ce moment, la nounou m’a dit qu’il devait faire une Dent, vous me direz ? », je me transforme illico en homme politique qui essaie de vous expliquer pourquoi vous croyez que vous payez deux fois plus d’impôts que l’année dernière mais qu’en fait non.
« Ouiiiiiiiiiiii, effectivemeeeeeeeent, il y a un petit quelque chose, mais bon on ne sait pas quand ça va sortir, hein, parfois c’est trompeur, ça peut être dans deux jours comme ça peut être dans deux semaines ou deux mois… Ça varie beaucoup d’un bébé à l’autre vous savez… »
J’ai rien senti, hein. Votre mioche, il a ouvert la bouche deux secondes trois quart, et j’étais occupée à chercher une fente palatine. Je ne saurais même pas à quel âge on est censé avoir sa première dent si ma sœur doublement mère ne m’avait pas rencardée. D’ailleurs, entre le moment où elle me l’a dit et le moment où j’écris ces mots, j’ai oublié.
J’ai bien l’impression que certains médecins savent, au demeurant. Quand je vois dans les carnets de santé « Deux dents », sérieux, je suis épatée. Je ne vois que trois hypothèses :
– soit le type a menti, comme moi, mais c’est quand même beaucoup plus gonflé de l’écrire noir sur blanc que d’embrouiller oralement les parents de circonlocutions hasardeuses et contradictoires,
– soit le type a répété ce qu’a dit la mère « Il a fait sa troisième Dent la semaine dernière ! » pour crâner devant les collègues qui liront le carnet de santé après lui,
– soit y en a vraiment qui savent compter les dents, et qui le font. Mon plus grand respect à eux.
Mon deuxième problème Dentaire, c’est les mythes et les légendes que des siècles d’incompétence relationnelle médicale ont fait fleurir autour des quenottes.
C’est trop compliqué probablement, de dire à des parents qu’on ne sait pas exactement pourquoi le petit a de la fièvre / de la diarrhée /le nez qui coule / les joues un peu rouges / les fesses un peu rouges / une tendance à être grognon depuis quelques jours. Qu’il y a des tas de virus qui donnent un peu de fièvre, que l’examen est rassurant, qu’on ne peut pas dire ce que c’est exactement mais qu’on sait tout ce que ce n’est pas, et que c’est souvent bien suffisant en médecine. Qu’il y a des tas de moments où le transit se dérègle un peu et que c’est la vie. Que l’érythème fessier du nourrisson, des fois ça vient, des fois ça part, que c’est comme ça, que ce n’est pas forcément expliqué ou causé par quelque chose.
C’est chiant, hein, de dire qu’on ne sait pas.
Alors on sait. C’est les dents.
Fastoche, implacable, rapide, efficace. Les parents vous gonflent avec une question un peu naïve au sujet d’un truc sans importance ? Y a du monde dans la salle d’attente ?
C’EST LES DENTS, vous dis-je !
Et puis moi je passe derrière, à essayer de dire aux gens que la fièvre, c’est très fréquent, que les dents, c’est à un moment ou l’autre inévitable, qu’inévitablement des phénomènes courants vont être amenés à survenir simultanément, et que la simultanéité et la causalité, c’est pas tout à fait la même chose, le tout en essayant de garder intactes l’image de – et la confiance accordée à – mon prédécesseur dentophile.
Alors oui, bien sûr, c’est pas un bien gros drame, de dire aux gens que c’est les dents. C’est un petit mensonge, c’est parfois pour la bonne cause, c’est parfois parce qu’on sait que les parents vont mieux comprendre cette explication et en être davantage rassurés qu’avec mes envolées lyriques de sauveuse du monde qui est meilleure que tout le monde sur la simultanéité et la causalité.
Moi aussi, j’ai mes petits mensonges (ne serait-ce que vingt lignes plus haut, quand je n’arrive pas à me résoudre à dire « Je sais pas compter les dents et jm’en fous »), j’ai mes petits raccourcis faciles, et je ne me permettrai pas de jeter la pierre.
Mais voilà, fallait que ça sorte, bordel : c’est pas les dents.